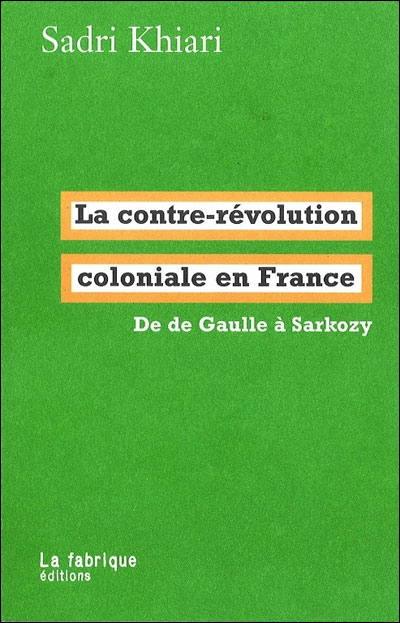La question biologique (les races existent-elles dans la nature ?) ne nous intéresse pas. Du reste, elle n’intéresse pas non plus vraiment les racistes. Quoi que dise la science sur le sujet, ils restent persuadés de l’existence des races. Les réflexions morales, anthropologisantes et psychologisantes sur le racisme, comme expression perverse et mortifère du rapport à l’Autre, ne nous concernent pas plus. Si elles font le bonheur des mordus de la méditation prépuceculaire, elles n’ont aucune pertinence pour le militant. Ces réflexions sortent, en effet, du politique et de l’histoire pour revenir à une prétendue nature éternelle de l’Homme, à ses écarts, à ses aberrations ou à ses pathologies. Ou alors elles resserrent l’explication du racisme sur les représentations et l’imaginaire. L’idéologie, la fausse conscience et autres mauvaises influences deviennent la vérité ultime de la réalité sociale. Dans ces paradigmes, le racisme pourrait, certes, se métamorphoser à travers l’histoire et les peuples, changer de cible ou se manifester sous des formes singulières (intolérance religieuse, nationalisme, culturalisme, biologisme, etc.) mais, en dernière instance, il serait l’avatar d’un invariant, l’hétérophobie fondamentale de l’Homme. Le postulat non dit de ces théories est que le racisme est engendré par les dissemblances réelles et l’hétérogénéité propres à l’humanité et non par les relations sociales inégalitaires qui valorisent ou fabriquent et fétichisent ces disparités. L’« antiracisme » se réduit, dans cette perspective, à promouvoir la « tolérance », à « ouvrir les esprits », à modifier les représentations, à bousculer les normes, à enseigner la diversité humaine, pour que l’Homme accepte l’Autre dans sa Différence. Il n’est plus question ici de politique – de rapports de forces, de luttes pour bousculer ou culbuter l’État –, mais de pédagogie morale.
Qu’importe, en vérité, que la haine de l’Autre soit universelle et atemporelle ou presque !
Que des phénomènes similaires, dans certaines de leurs formes, au racisme blanc aient pu exister en Inde, au Japon, dans certaines régions d’Afrique, du monde arabo-musulman ou d’ailleurs, ne dit rien sur les rapports de domination que la planète blanche exerce sur les autres peuples depuis des siècles. Il est vain de gloser sur la généralité – et la contamination réciproque – des formes d’essentialisation, de naturalisation, d’infériorisation, de rejet, de mépris, d’intolérance ou de peur de l’Autre qui accompagnent le déploiement du racisme – comme elles accompagnent la plupart, sinon la totalité, des relations entre individus ou groupes d’individus dans les sociétés inégalitaires, voire, tout simplement, dans les rapports entre communautés et sociétés différentes. La suprématie blanche n’existe que dans ses singularités historiques. Le racisme n’est qu’une modalité – idéologique – d’existence de la lutte des races sociales. En ce qui nous concerne, donc, il ne nous intéresse pas de savoir si les races existent ou pas en dehors des relations sociales et politiques qui en ont tissé la trame à travers un espace-temps bien déterminé. La question qui nous importe exclusivement est celle-ci : qu’est-ce qui spécifie la relation sociale qui produit et oppose, dans le même temps, des groupes sociaux hiérarchisés qui se pensent et s’opposent comme races, délimitées par des différences imaginées et réifiées ? À travers quelles logiques sociales, quelles confrontations politiques, l’illusion des races dénoncée par les antiracistes recouvre-t-elle une réalité sociale tout à fait concrète, la lutte des races sociales ?
Ainsi, parler de races sociales, c’est d’abord pointer la singularité du lien social médié par ces différences ; c’est appréhender les modalités à travers lesquelles il a pris la forme d’une polarisation sociale spécifique délimitant, en termes de race, des groupes statutaires. J’entends par là des groupes sociaux dont les relations hiérarchisées sont l’expression de dispositifs d’assignation et de contrainte principalement politiques, de l’imposition de normes et autres distinctions symboliques, autrement dit par un statut plus ou moins explicitement institutionnalisé, qui ne relève pas nécessairement de l’ordre économique. Les groupes statutaires se distinguent ainsi des classes sociales dans leur acception marxiste. Ou, plus exactement, dans leurs formes premières (les castes, les ordres…), les classes sont également des groupes statutaires dans la mesure où elles sont imbriquées dans les rapports de «dépendance personnelle» (Le Capital) qui caractérisent alors toutes les sphères de la vie sociale et sont donc directement politiques. Dans le monde précapitaliste, les classes dominantes sont immédiatement constitutives du pouvoir politique et c’est en tant que telles qu’elles s’accaparent une partie des richesses produites par les classes dominées. Ainsi, « la structure hiérarchique de la propriété foncière et de la suzeraineté militaire qui allait de pair avec elle confèrent à la noblesse la toute-puissance sur les serfs[1] ». Dans la démocratie égalitaire capitaliste, l’État s’est (relativement) autonomisé, les classes n’en sont plus directement parties prenantes, l’extorsion des richesses se réalise à travers la logique propre du Capital. La constitution des races, se caractérisant principalement par leurs statuts respectifs dans l’ordre politique et symbolique, suit, on le verra, un cheminement inverse.
Comme le Capital produit les classes, comme le Patriarcat produit les genres, le Colonialisme européen-mondial produit les races. Il constitue un mécanisme de différenciation et de hiérarchisation de l’humanité entre un pôle doté, en tant que race, de privilèges, invisibles ou manifestes, et un pôle racial dont la soumission à toutes sortes de violences, invisibles ou manifestes, garantit les privilèges du pôle dominant. L’existence d’un individu racialisé est déterminée ici par son statut racial, c’est-à-dire par son appartenance à un groupe délimité comme race inférieure ou supérieure. Le premier pôle est le monde blanc dont le Pouvoir blanc constitue la dimension politique, plus souvent institutionnalisé qu’inorganisé; le second pôle est le monde indigène dont la Puissance politique indigène constitue la dimension politique, plus souvent virtuel, inorganique, émietté qu’institutionnalisé. Être blanc, ce n’est pas nécessairement avoir la peau blanche; c’est être partie intégrante du monde blanc et être reconnu comme tel; c’est jouir de privilèges statutaires garantis par l’État. Être indigène, ce n’est pas nécessairement avoir la peau noire ou le regard fuyant; c’est exister socialement comme condition de possibilité et de réalisation du privilège blanc.
Parler de races sociales, c’est donc aussi mettre en évidence l’unité d’un processus historique, en l’occurrence cette relation de domination/résistance inscrite dans un même continuum historique, progressivement mondialisé, sous les formes de l’esclavage des Noirs, de la colonisation, puis des différentes formes d’apartheid et de ségrégation dont les descendants d’esclaves et de colonisés ont continué à faire l’objet et contre lesquelles ils résistent encore. Car c’est bien dans la colonisation du monde, forme historique concrète qu’a prise la mondialisation économique, politique et culturelle, à partir du début de l’expansion européenne en Afrique et de la « découverte » des Amériques, qu’il faut voir la production des races sociales, c’est-à-dire l’émergence de la suprématie blanche ou encore la structuration d’un champ politique mondial articulé autour de l’affrontement entre le Pouvoir blanc et la Puissance politique indigène.
Précisons d’abord ceci : il y a colonisation et colonisation. Les conquêtes d’Alexandre le Grand ou les différents empires musulmans ou chinois n’ont pas grand-chose à voir avec la mondialisation coloniale européenne, enracinée notamment dans les bouleversements qu’a connu l’Europe à partir de la Renaissance avec l’expansion progressive du Capital et la formation heurtée des États-nations. Toute expansion territoriale, toute oppression d’un peuple n’a pas été racialisante comme a pu l’être la colonisation européenne. Il en est de même de l’esclavage qui n’est pas, en soi, racialisant. La notion générique d’esclavage est en effet trompeuse, suggérant un lien social de même nature entre le maître et l’esclave dans des sociétés pourtant souvent incomparables. Être « propriétaire » d’un être humain ne peut absolument pas avoir la même signification dans le cadre de communautés où la forme « propriété » recouvre des logiques et des relations sociales différentes. Dans les premiers temps, l’institution de relations esclavagistes en Amérique s’est enracinée dans les pratiques habituelles de l’Europe du Sud depuis plusieurs siècles[2]. L’esclavage des Indiens et des Noirs n’est pas, à l’origine, plus racialiste que ne l’a été l’esclavage dans l’Antiquité, la traite arabe, ou l’esclavage tel qu’il a été pratiqué par presque toutes les sociétés que nous connaissons, y compris africaines. Ainsi, dans le monde arabe, ce n’est pas d’emblée parce qu’ils étaient noirs que les peuples d’Afrique subsaharienne ont été réduits en esclavage. Cependant, en se développant comme moment du processus colonial contemporain, le mouvement esclavagiste a changé progressivement de nature. La déportation des Noirs et leur réduction en esclavage ne peuvent être qualifiées de raciales que dans la mesure où elles ont participé de la mise en place de relations sociales instaurant une hiérarchie entre un groupe statutaire défini comme blanc et un autre défini comme noir (avant d’embrasser l’ensemble des « indigènes »). De ce point de vue, dans le nouveau contexte colonial, l’esclavage a créé de toutes pièces cette réalité sociale que sont les races. Ni les races ni le racisme ne lui étaient antérieurs. Comme l’exprime parfaitement James Baldwin, «ils sont devenus blancs. Car ils ne l’étaient pas avant de mettre pied sur ce continent, pas plus que nous n’étions “noirs” en Afrique. Nous étions membres d’une tribu, d’une langue et d’une nation[3]». Et d’ajouter: «Les “Européens” – catégorie fourre-tout, qui exprime en réalité les fatalités conjuguées du Capital, du christianisme et de la couleur – les Européens, donc, sont devenus blancs, et les Africains sont devenus noirs. Pour des raisons commerciales[4]!» La relation coloniale étant aussi une relation de résistance à la colonisation, on pourrait compléter les formules de Baldwin en ajoutant ceci: le Noir est une création du Blanc et de la résistance du Noir. Le Blanc est une création du Blanc, comme il est le produit de la résistance du Noir. Le Noir n’est pas une couleur, il est un rapport social. Le musulman, aujourd’hui, n’est pas nécessairement un adepte de la foi musulmane, il est un rapport social. Et, bien sûr, le Blanc n’est pas non plus une couleur, il est un rapport social. Un rapport de lutte. Un rapport politique.
Sadri Khiari, membre du PIR
Extrait de son livre : « La contre-révolution coloniale, de De Gaulle à Sarkozy« , La Fabrique, 2009
Notes
[1] Marx/Engels, L’idéologie allemande. Marx dit substantiellement la même chose dans les Grundnisse et dans Le Capital.
[2] Autour de 1440, « le rapt d’esclaves, plutôt que leur achat, était tout sauf une pratique inhabituelle dans l’Europe et l’Afrique de ce temps là. Ces razzias, comme on appelait l’odieuse activité du vol d’êtres humains, s’étaient pratiquées tout au long du Moyen Âge en Espagne et en Afrique, à l’instigation de marchands musulmans et chrétiens. Les musulmans lisaient dans le Coran la justification de l’asservissement ; ces derniers les avaient initiés dans leur longue reconquête de l’Espagne » (Hugh Thomas, La Traite des Noirs, 1440-1870, Paris, Robert Laffont, 2006, p.5)
[3] J. Baldwin, Meurtres à Alabama, op.cit, p.52
[4] Ibid, p.53