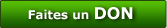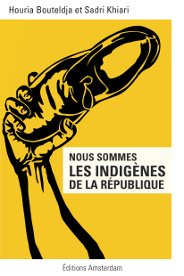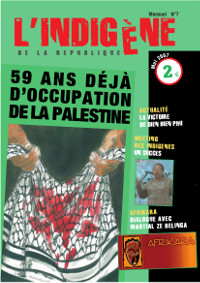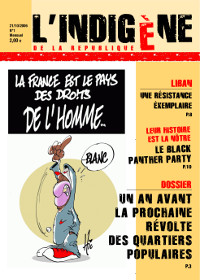Le Libéria et Israël sont souvent présentés comme des exemples équivalents de colonialisme de peuplement de diaspora. Cet article, publié dans la revue nigériane The Republic et empruntant son titre (« Canaans amers ») à l’ouvrage éponyme du sociologue afro-américain Charles S. Johnson sur l’histoire de la république du Libéria (Bitter Canaan : Story of the Negro Republic), présente les raisons pour lesquelles, malgré leurs éventuelles similitudes, la mise en équivalence de ces deux projets de colonialisme à destination de populations victimes du racisme et de la suprématie blanche est infondée.
Il est souvent oublié que les premiers penseurs sionistes alignaient consciemment leur projet sur les mouvements de libération noirs à travers le monde. Theodor Herzl, dans son roman utopique Altneuland (« Vieille Nouvelle Terre ») de 1902, appelait à la « restauration des Noirs » en Afrique sous le principe que « tous les hommes devraient avoir une patrie ». D’autres sionistes ont établi des liens entre les indignités auxquelles les Noirs sont confrontés et leur propre histoire juive. Dans les années 1910, par exemple, David Ben-Gourion, le fondateur de l’État d’Israël, se souvenait dans ses lettres à Itzhak Ben-Zvi d’avoir ressenti de la colère et de la honte face au système de ségrégation raciale qu’il avait vu aux États-Unis. Il l’appelait la « Zone de résidence des Noirs » en référence à la « zone de résidence » que les autorités tsaristes utilisaient historiquement pour cantonner les Juifs en Russie impériale. Dans un cinéma ségrégué dans le Tennessee, Ben-Gourion raconte avoir choisi de s’asseoir avec des spectateurs noirs, seulement pour qu’un employé lui demande de changer de place. L’expérience a laissé une impression durable. « Si j’avais été Noir, j’aurais été l’antisémite ultime », écrit-il dans son journal privé en 1940.
Après sa fondation, Israël a travaillé à cultiver des liens amicaux avec les nouvelles républiques africaines indépendantes dans l’espoir de gagner des votes aux Nations Unies et de cultiver des liens commerciaux. En 1957, Israël a établi des relations diplomatiques avec l’Éthiopie, le Libéria et le Ghana. Au cours des années 1960, Israël a envoyé des milliers de consultants, conseillers militaires et hommes d’affaires sur le continent, espérant démarrer des projets commerciaux communs et présenter les joyaux de son modèle développementaliste : les kibboutz et les moshav, les bataillons de jeunesse Gadna, les colonies de Nahal. Par exemple, après l’indépendance du Nigeria, l’Israélien Jerry Beit Halevi a été le premier entraîneur de football du Nigeria. C’est à cette époque que l’industrie naissante des armes d’Israël est également devenue un géant de l’exportation. En 1966, Israël exportait des armes vers dix pays africains, dont le Ghana, le Congo, Madagascar, la Tanzanie et le Bénin.
Aux Nations Unies, Israël est resté critique de l’apartheid sud-africain jusqu’au début des années 1970. Il a même envoyé une aide financière au Congrès panafricain sudafricain. En 1970, les diplomates israéliens qualifiaient encore l’État séparatiste minoritaire blanc de Ian Smith en Rhodésie de « régime illégal ». Et Israël a envoyé des armes au FNLA angolais qui combattait les Portugais. Comme l’a écrit Golda Meir dans son autobiographie Ma vie, « Comme [les Africains], nous avions secoué le joug étranger ; comme eux, nous avions dû apprendre par nous-mêmes comment récupérer la terre, comment augmenter les rendements de nos cultures, comment irriguer, comment élever des volailles, comment vivre ensemble et comment nous défendre. » Elle a présenté cette démarche comme faisant partie de la « mémoire partagée de la souffrance séculaire des Juifs et des Africains ». Sur tous ces fronts, l’Afrique est devenue une caractéristique indélébile de ce que Haim Yacobi appelle la « géographie morale » d’Israël. Cette époque a duré jusqu’à la victoire partielle de l’Égypte contre Israël dans la guerre d’octobre 1973, lorsque de nombreux pays africains ont rompu leurs relations avec Israël pour se ranger du côté de l’Égypte.
« Quelques centaines de milliers de Noirs »
Ces alignements – sentimentaux, économiques et politiques – étaient toujours quelque peu éphémères. Contrairement aux panafricanistes ou aux États postcoloniaux africains nouvellement indépendants, les penseurs sionistes se voyaient comme les défenseurs d’un projet colonial de peuplement construit contre la souveraineté indigène. Herzl, par exemple, écrivit au colonialiste britannique Cecil Rhodes en le suppliant de soutenir financièrement l’implantation juive en Palestine, un projet qu’il qualifiait de « quelque chose de colonial ». Plus tard, Vladimir Jabotinsky, le sioniste révisionniste, écrira en termes très vifs en 1923 sur la nécessité pour le Yishuv juif en Palestine de construire un « Mur de fer » contre les habitants arabes autochtones, car « tous les indigènes résistent aux colons ». Il était clair dans ce qu’il désignait par « colons » : son propre public sioniste.
Le choix de la Palestine par le mouvement sioniste s’appuyait sur des recherches préalables de colonies alternatives, nombre d’entre elles en Afrique. En 1903, par exemple, Herzl a présenté au sixième congrès de l’Organisation sioniste mondiale (OSM) le Plan Ouganda. Ce plan improbable, conçu par le diplomate britannique Joseph Chamberlain, visait à réinstaller les Juifs fuyant les pogroms de l’Empire russe sur le plateau d’Uasin Gishu, dans l’actuel Kenya, où les planificateurs coloniaux britanniques étaient désespérés d’attirer des colons et de récupérer les pertes du chemin de fer d’Ouganda, qui n’était pas rentable. Ce plan a échoué comme les autres tentatives des empires européens de promouvoir des alternatives « territorialistes » juives au sionisme. Nous pouvons rappeler le plan portugais de 1907 à 1913 pour attirer des colons juifs dans l’Angola colonial, la tentative risible du régime nazi de déporter les Juifs européens à Madagascar, ou les projets de Mussolini de réinstaller des Juifs dans l’Éthiopie occupée par l’Italie pour renforcer la nouvelle colonie de peuplement du régime fasciste.
Les sionistes ont-ils rejeté ces alternatives par souci de la souveraineté indigène africaine ? Non. Lire les lettres privées des dirigeants sionistes ou les procès-verbaux des réunions de l’OSM sur ces propositions revient à lire une litanie de plaintes pratiques : opposition des colons blancs existants, coûts de la relocalisation et attrait persistant de la Palestine en tant que site des anciens royaumes hébraïques. En particulier, après la déclaration Balfour de 1917, le choix de la Palestine par le sionisme était devenu un fait accompli. Des éléments pragmatiques du mouvement sioniste ont même collaboré avec les autorités nazies et fascistes italiennes pour faciliter l’émigration des Juifs en Palestine.
En 1933, par exemple, la Fédération sioniste d’Allemagne et la Banque anglo-palestinienne ont signé l’Accord Ha’avara avec la dictature hitlérienne, permettant aux Juifs de quitter l’Allemagne nazie et de transférer une partie de leurs avoirs à l’étranger. Le pacte a violé un boycott mondial anti-nazi et a déchiré l’opinion juive (un de ses négociateur en chef, Haim Arlosoroff, a été assassiné plus tard). Mais il a duré six ans jusqu’à l’invasion nazie de la Pologne, illustrant comment la priorité sioniste de construire un important Yishuv juif en Palestine pouvait fonctionner de manière perverse en tandem avec l’objectif nazi d’une Europe judenfrei, « purifiée » des Juifs.
Le mouvement « Back to Africa »
Comment alors comparer les ambitions colonisatrices du discours sioniste avec les courants intellectuels qui ont historiquement mobilisé les peuples africains ? Considérez un candidat potentiel, le mouvement Back To Africa. Au cours des XIXe et XXe siècles, des centaines de milliers de personnes noires ont quitté les Amériques ou débarqué des navires négriers pour se réinstaller dans ce qui est aujourd’hui la Sierra Leone, le Ghana, la Côte d’Ivoire et le Libéria, ce dernier étant son exemple le plus politiquement réussi.
À l’instar de la constitution d’Haïti de 1816 et de la Loi du Retour d’Israël pour la diaspora juive, le Libéria a inscrit dans ses lois sur la nationalité le principe d’asile pour les « gens de couleur libres ». Les soutiens du Libéria, tels que Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois ou Edward Blyden, pouvaient voir dans ce mouvement atlantique un parallèle avec le sionisme – une entité politique établie par des émigrés, dont la base de parenté et d’identité nationale commune était fondée par l’exclusion et l’exploitation expérimentés à l’étranger.
À l’instar de la collaboration des sionistes juifs avec les nazis, les panafricanistes se sont parfois retrouvés eux aussi avec des alliés étranges. Les planteurs blancs, pour beaucoup venus de Virginie, aimaient eux aussi l’idée d’expédier les « noirs pauvres » vers une prétendue patrie africaine. Le retour en Afrique, tel que compris par le propriétaire d’esclaves, promettait de retirer une caste « racialement inférieure » de l’Amérique. De manière pratique, cela éviterait les problèmes d’intégration des Noirs libres, le tout sous « le couvert d’une philanthropie feinte », écrivait Jermain Loguen avec acidité en 1853.
Pour ces raisons, les abolitionnistes de l’esclavage (blancs et noirs) s’opposaient généralement aux sociétés de colonisation, tout comme la grande majorité des Noirs ordinaires. On retrouve leurs arguments récapitulés dans Thoughts on African colonization de William Lloyd Garrison (1832), The Colonization Scheme de Frederick Douglass (1852), et les lettres de Gerrit Smith ou James Forten. Le discours sur le retour en Afrique préfigurait les polémiques contre un État-nation juif en Palestine faites par des juifs non-sionistes, tels que le rabbin réformiste Judah Leon Magnes ou le Bundiste polonais Marek Edelman. Leur défi au sionisme ressemblait au défi abolitionniste au retour en Afrique. Comme le disait un ancien slogan du Bund ouvrier juif, « Là où nous vivons, là est notre pays ! »
Cependant, au-delà de cette ressemblance superficielle dans le paysage discursif, pensée sioniste et panafricaniste partageaient peu en termes d’histoire et d’objectifs. Pour commencer, aucune idée panafricaine avancée par un de ses défenseur sérieux n’a, selon les mots de Michael W. Williams, « revendiqué une terre en dehors ou à l’intérieur de l’Afrique qui nécessitait l’expulsion ultérieure ou la subjugation politique et économique de ses habitants indigènes ». Cela témoigne à la fois des engagements égalitaires du projet panafricain et du fait que l’émigration n’était tout simplement jamais un objectif central pour son succès politique. Des centaines de millions d’Africains vivaient sur le continent, contrairement aux Juifs en Palestine ottomane et mandataire. Voici Garvey en 1923 : « Il ne s’agira pas d’aller en Afrique dans le but d’exercer une suzeraineté sur les indigènes, mais il s’agira d’une… coopération fraternelle qui rendra les intérêts de l’indigène africain et des Noirs américains et antillais identiques ». Revenir en Afrique signifiait que les émigrés noirs devaient accepter les traditions et les peuples du continent, et non les remplacer.
Nous pouvons mettre en contraste cet appel avec les nombreuses déclarations des sionistes, variant dans leur racisme explicite, sur la nécessité de remplacer les habitants arabes de Palestine par des émigrés juifs. Herzl, par exemple, écrivait sur les Arabes de Palestine dans son journal : « Nous devons essayer de déplacer la population sans le sou vers la frontière… En lui niant un emploi dans notre propre pays ». Lord Balfour, le secrétaire aux Affaires étrangères qui a déclaré le soutien officiel de l’Empire britannique à la cause d’un État-nation juif en Palestine, affirmait en 1922 que le sionisme était « d’une importance bien plus profonde que les désirs et les préjugés des 700 000 Arabes qui habitent aujourd’hui cette terre antique« . Pour Chaim Weizmann, la Palestine contenait « quelques centaines de milliers de Noirs [כושים], mais cela n’avait pas d’importance ». Un défi pour les sionistes était de savoir quoi faire avec ces « Noirs » palestiniens. Deux options étaient envisageables, soit le transfert des Arabes non juifs de Palestine ailleurs, soit leur domination dans les limites d’un État juif territorialement contigu — cette option menant à une situation que Ben-Gourion en 1967 et Yitzhak Rabin en 1976 ont prophétiquement désigné comme un « apartheid ». Laquelle choisir ?
Canaan amer
Jusqu’ici, les analogies avec les États coloniaux de peuplement en Afrique (et non, et c’est à noter, ses mouvements anti-coloniaux) étaient utiles. En 1941, le chef du Fonds national juif, Menachem Ussishkin, fait remarquer à propos de l’Afrique du Sud : « les Noirs représentent 80% et n’y ont aucun droit… Comment voulez-vous que les Juifs qui représentent 20% règnent en Palestine ? » Il écarte cette option, espérant que l’émigration juive donnera finalement aux Juifs du Yishuv une majorité : « Un État juif d’abord, des droits égaux pour les Arabes ensuite, et troisièmement le transfert des Arabes seulement s’ils y consentent, comme l’a écrit M. Ben-Gourion, c’est essayer de résoudre un problème impossible. C’est impossible ».
Parmi ces trois options, les sionistes on choisi la première — un État juif dirigé par une majorité juive. Des formulations alternatives, telles que la proposition de Martin Buber pour un État binational et fédéral en Palestine, sont restées en marge du discours sioniste. Pourtant, parce que le Yishuv ne bénéficiait pas d’une masse critique de Juifs, créer et maintenir un État juif en Palestine nécessitait des actes créatifs d’ingénierie démographique et de gouvernance.
La pratique a suivi la théorie ici. En 1948, plus de 85 % des Arabes chrétiens et musulmans de Palestine dans les frontières de l’État déclaré d’Israël ont été expulsés en tant que réfugiés apatrides. Ceux qui sont restés, nombreux dans des villes du nord comme Nazareth et Haïfa ou chez les Bédouins du sud, ont vécu sous un régime militaire jusqu’en 1966. Après avoir remporté la guerre de 1967 contre ses voisins arabes, Israël a ensuite occupé le Sinaï, les hauteurs du Golan, Gaza et la Cisjordanie — soumettant de grandes populations urbanisées de Palestiniens dans ces deux dernières régions à un régime de domination militaire qui dure maintenant depuis plus d’un demi-siècle. Depuis les années 1970, le gouvernement israélien a également permis (et encouragé par ses diverses subventions) l’expansion d’un mouvement de colonisation juive dans les territoires occupés. Des membres du Gush Emunim des années 1970 à l’espace politique contemporain de la Knesset (Tkuma, Otzma Yehudit, HaBayit HaYehudi), les voix les plus influentes dans la politique de la colonie adoptent une vision irrédentiste, messianique, théocratique et d’extrême droite de la suprématie juive à tout prix. Les colons vivent sous des lois différentes, détiennent des cartes d’identité différentes, circulent sur des routes différentes, fréquentent des écoles différentes et votent lors d’élections différentes de leurs voisins palestiniens.
Il y a eu quelques accrocs dans cet arrangement, bien sûr. La péninsule du Sinaï, par exemple, a été échangée contre la paix avec l’Égypte en 1978. En 1980, Israël a formalisé son annexion de Jérusalem-Est, conférant aux résidents palestiniens de Jérusalem un statut spécial les privant du plein exercice de la citoyenneté et du droit de vote. En 1981, Israël a annexé le Golan. Avec les Accords d’Oslo des années 1990, Israël a externalisé la gouvernance des principales villes palestiniennes dans les territoires occupés à la nouvelle Autorité palestinienne, mais a conservé environ deux tiers des terres, appelées Zone C, pour ses propres entreprises militaires et de colonisation. Après 2005, l’armée israélienne a construit un mur de séparation à travers la Cisjordanie, détachant les banlieues palestiniennes de Jérusalem-Est du cœur de la ville. En 2005, Israël, sous le feu de Hamas, s’est également retiré de Gaza, échangeant une occupation terrestre directe contre un blocus écrasant par voie aérienne, terrestre et maritime.
Les objectifs du Mur de séparation et du désengagement de Gaza étaient nombreux, mais comprenaient la création d’une architecture de sécurité qui permettrait à Israël de diviser et de conquérir la Cisjordanie et Gaza, d’empêcher l’émergence d’un État palestinien et de réprimer toute résistance sérieuse à son règne. Ainsi, les 20 dernières années d’occupation enregistrent ce qu’analyste Tareq Baconi a appelé un « équilibre violent ». Israël maintient une occupation indéfinie et un système d’apartheid de plus en plus raffiné, ponctué par des guerres périodiques et dévastatrices à Gaza. Le pari implicite des dirigeants d’Israël était que les coûts de ces guerres seraient suffisamment faibles pour être ignorés par le public israélien. Il reste à voir si l’attaque de Hamas le 7 octobre et l’invasion de Gaza ont laissé cette illusion intacte. Ou si le conflit est effectivement entré dans un territoire inexploré.
Si l’entreprise panafricaine était différente du sionisme dans les discours, elle l’était certainement également en pratique. Le Libéria, par exemple, avait sa propre histoire d’oppression, mais il se distingue pourtant d’Israël tant en degré qu’en nature. Il est vrai que les colons américo-libériens formaient une élite dirigeante, qu’ils se mariaient rarement avec les peuples africains indigènes, qu’ils ont mené des escarmouches périodiques contre les tribus environnantes, et qu’ils ont adopté la langue anglaise, les vêtements occidentaux, des maisons de style plantation et le christianisme évangélique. Les peuples Kru et Grebo étaient exclus de la citoyenneté jusqu’en 1904. Même Du Bois conseillait aux colons afro-américains de garder « le dessus » sur les indigènes, de peur que « les chefs tribaux ne prennent les choses en main ». Décrire le Libéria comme un État colonial de peuplement selon les lignes sionistes pourrait donc sembler exact, comme de nombreux défenseurs panafricains du Libéria l’ont clairement indiqué. Edward Blyden, par exemple, dans ses traités From West Africa to Palestine (1874) et The Jewish Question (1898) faisait volontiers l’analogie entre sionisme et le projet colonial libérien.
Mais le Libéria, comme la Sierra Leone, était également une colonie de ressources pauvre au service des intérêts capitalistes américains et britanniques, où près de la moitié des émigrés étaient morts de maladies. Comme l’écrivait avec acuité le panafricaniste américain Martin Delany en 1852, le Libéria était une « pauvre et misérable farce — une parodie de gouvernement — une dépendance pitoyable » de la société de colonisation « esclavagiste », dont le « but fondamental » était d’« exterminer les gens de couleur libres du continent américain ». Pendant une grande partie de son histoire au XXe siècle, le Libéria a fonctionné comme un État de facto à parti unique sous la suzeraineté des États-Unis, qui y ont obtenu une base navale en Afrique de l’Ouest tandis que la Firestone Tire Company transformait le Libéria en un vaste fief de production de caoutchouc travaillé par la sueur et le sang d’une main-d’œuvre non libre. Le « Sion noir », comme le nommait I.K. Sundiata dans son livre, était aussi un « esclavage des noirs ». L’exploitation du travail des indigènes, et non leur éradication par des formes ethno-nationalistes de nettoyage ethnique, était au cœur de l’entreprise coloniale du Libéria d’avant la guerre civile.
Mais la discrimination légale dans le « Canaan amer » du Libéria n’a pas pu persister au niveau de l’occupation israélienne actuelle — ni dans son intensité bureaucratique, son échelle au niveau de la population, ni dans sa durabilité. Le règne américo-libérien a pris fin brusquement avec un coup d’État dans les années 1980, après quoi de nombreuses dynasties familiales de colons du Parti True Whig — les Tolberts, Tubmans, les Coopers et les McGills — se sont relocalisées à l’étranger. Pour ces raisons, comparer le Libéria et Israël comme des exemples de colonialisme de peuplement, une comparaison faite par Mahmoud Mamdani, Joseph Massad et plus récemment Ralph Leonard, revient à comparer une baie flétrie depuis des années à une grosse calebasse encore en train de gonfler sur sa vigne. La baie et la calebasse sont toutes deux des fruits ; tant Israël que le Libéria étaient des tentatives d’empires pour résoudre le racisme domestique (la « question juive » ou la « question nègre ») par l’exportation coloniale. Pourtant, cette analogie néglige l’échelle, le type et l’histoire des projets.
Le degré auquel le Libéria a évolué sous le patronage des initiatives philanthropiques et de colonisation particulières des États-Unis et de la Grande-Bretagne en fait un bien étrange représentant de la tradition panafricaine. Le panafricanisme implique bien d’autres choses. Un esprit de résistance à l’impérialisme irrigue l’héritage panafricain, que les puissances atlantiques ont cherché à réprimer. Cette posture est évidente dans les discours enflammés de Thomas Sankara, la poésie de Léopold Sédar Senghor et le mouvement de la Négritude, la vie de Julius Nyerere ou de Malcom X. De même, l’histoire de l’attitude de l’Occident envers les panafricanistes et les mouvements du Black Power est une histoire de répression ; des espions américains et belges ont aidé Mobutu à assassiner Patrice Lumumba au Congo. La CIA a frustré les grands projets de Kwame Nkrumah pour le Ghana. Sur le plan national, Steve Biko en Afrique du Sud et les Black Panthers aux États-Unis ont été impitoyablement persécutés par la police, et ainsi de suite.
Les sionistes, en revanche, avaient tendance à s’attacher à la protection et à la bienveillance d’une grande puissance : d’abord les Ottomans, puis les Britanniques, et maintenant les États-Unis. Le seul épisode où les sionistes sont entrés en confrontation ouverte avec les autorités impériales s’est produit pendant les dernières années du mandat britannique dans les années 1940, lorsque des milices sionistes comme l’Irgun et la Haganah ont tenté de saboter les autorités britanniques et de défier leurs restrictions sur l’émigration juive hors de l’Europe fasciste. Cette époque, maintenant beaucoup mythifiée, était l’exception à la règle. Les directions sionistes n’empruntent que rarement aux courants anti-coloniaux de la tradition panafricaine ou de la tradition radicale noire.
Considérons un exemple significatif, les Black Panthers israéliens, un mouvement qui s’est formé en 1971 parmi les Juifs mizrahis et séfarades pour protester contre les violences policières, la discrimination urbaine et les inégalité de revenus. Inspirés par leur prédécesseur noirs américains, les panthères ont renommé un quartier marocain de Jérusalem « Harlem ». Ils se sont brièvement présentés lors des élections israéliennes, remportant moins d’un pour cent des voix. L’histoire de leur disparition est instructive. Au début des années 1980, les partis de droite Likud et Shas avaient facilement approprié la rhétorique et la base électorale du ressentiment des Mizrahis de la classe ouvrière. La direction des panthères, privée d’une plateforme distincte, s’est fondue à nouveau dans la gauche israélienne et le camp des défenseurs des droits de l’homme. Kochavi Shemesh, par exemple, a intégré ce qui restait des Black Panthers dans ce qui est devenu le Hadash de gauche (maintenant principalement représenté par des citoyens palestiniens d’Israël). Reuven Abergel a plus tard créé la Coalition Arc-en ciel démocratique mizrahie.
Ces groupes peuvent être caractérisés comme séculiers et non sionistes, car ils ne s’engagent pas explicitement à maintenir Israël comme un État et une société qui privilégie les Juifs. Hadash, par exemple, cherche à promouvoir la justice sociale pour toutes les personnes qui vivent en tant que citoyens sous l’État israélien, qu’elles soient juives israéliennes, musulmanes, chrétiennes palestiniennes, druzes ou autres. Ce serait donc déformer le sens des mots que de dire que les Black Panthers israéliens représentent la preuve d’une marque de la tradition politique noire sur la pensée sioniste, et encore moins sur la politique israélienne au sens large.
Des diamants et des armes
Les liens plus que ténus entre le sionisme et la libération noire deviennent encore plus clairs dans les relations réelles d’Israël avec les peuples noirs et africains. Ici, l’histoire est accablante. À aucun moment dans la première décennie et demie de son existence, Israël n’a sérieusement publiquement dénoncé les lois Jim Crow de son patron hégémonique, les États-Unis. Au lieu de cela, il a armé l’homme blanc. Ignorant les sanctions internationales, Israël a vendu des armes au gouvernement minoritaire blanc de la Rhodésie pendant la guerre du Bush (1964-1979). Israël a collaboré avec l’armée française et le groupe terroriste de colons d’extrême droite OAS en Algérie coloniale. Dans les années 1970, Israël a défié un embargo mondial sur les armes imposé à la dictature portugaise pour lui vendre des armes dans ses guerres coloniales en Angola et au Mozambique.
En 1977, Israël, avec le Likud de Menachem Begin à la tête, avait enterré les réticences antérieures et à demi-sincères de Tel Aviv concernant les dirigeants blancs afrikaners d’Afrique du Sud (qui avaient été enthousiastes pour les nazis allemands) et avait gagné le titre douteux de plus grand fournisseur d’armes du régime d’apartheid. Malgré un embargo sur les ventes d’armes, Israël a promis un soutien militaire pour les campagnes de Pretoria en Namibie et en Angola, comprenant des avions de combat, des bateaux de missiles et presque un milliard de dollars de mitrailleuses, de munitions anti-chars et de munitions air-air. Il semble probable qu’Israël ait aidé l’Afrique du Sud à réaliser un test de bombe nucléaire dans l’océan Indien en 1979. L’antipathie d’Israël envers le Congrès national africain n’a fait qu’augmenter après l’ascension fulgurante de Mandela en 1994, malgré le rôle historique des Juifs sud-africains dans la lutte anti-apartheid de l’ANC.
On parle beaucoup du soutien israélien aux rebelles biafrais au Nigeria, mais des milliers de câbles diplomatiques récemment déclassifiés dans les archives israéliennes racontent une histoire plus cynique. Selon une récente révélation de Haaretz, l’approche du ministère israélien des Affaires étrangères envers le Biafra était celle d’un marchand d’armes confronté à un problème de relations publiques. Pressé sur les fronts national et international d’aider les Igbo (l’activiste israélien pour la paix Abie Nathan et le président de la Côte d’Ivoire Félix Houphouët-Boigny ont été, par exemple, spécifiquement nommés), Israël espérait également éviter de froisser le gouvernement fédéral nigérian.
Sa solution était de jouer un double jeu. En plus d’envoyer une aide alimentaire au Biafra, les diplomates israéliens ont remis 200 000 dollars en espèces à au moins deux reprises à des représentants biafrais et les ont connectés avec des marchands d’armes privés. Ils ont même, dans un incident improbable en novembre 1967, fait entrer clandestinement un navire marchand israélien dans le Biafra transportant « des bombes, des explosifs, des armes, des munitions légères, des camions et 150 vaches ». Le ministère des Affaires étrangères a également orchestré discrètement ce qu’un diplomate israélien a appelé le 23 mars 1969 une « campagne de propagande à grande échelle pour le Biafra », qui comprenait le placement stratégique d’articles d’opinion dans la presse occidentale présentant le blocus fédéral nigérian comme équivalent à un génocide. L’objectif, comme l’a écrit une directrice du ministère des Affaires étrangères, Yael Vered, dans un câble à l’ambassade israélienne à Londres, était non seulement d’apaiser les pacifistes, mais de « détourner une partie de la sympathie pour les Palestiniens vers ce peuple opprimé » et à attirer l’attention sur le « rôle meurtrier des Arabes » — une référence aux pilotes égyptiens mitraillant le Biafra en collaboration avec l’armée nigériane. Dans le même temps, Israël a cultivé des relations cordiales avec Lagos. Il a vendu des armes au régime de Yakubu Gowon et a planifié l’ouverture d’une école de parachutisme israélienne au Nigeria, même si ses câbles documentaient méticuleusement les atrocités de l’armée nigériane et l’ampleur de la corruption et de la fraude qui impliquaient des entreprises israéliennes.
L’épisode biafrais reflète un portrait plus large de la « diplomatie » des armes entre Israël et l’Afrique. Au Cameroun, Israël soutenait le dirigeant de longue date Paul Biya et a formé sa milice personnelle. Après que la junte congolaise et des responsables belges aient brutalement assassiné Patrice Lumumba, Israël a joué un rôle crucial dans la formation des espions et des parachutistes de la dictature de Mobutu. Au cours des années 1980, le ministère des Affaires étrangères israélien a offert à la junte des millions de dollars en matériel militaire et a même avalé ses réticences concernant l’antisémitisme virulent de Mobutu pour envoyer des conseillers israéliens gérer sa plantation personnelle. Ces liens étroits se sont finalement révélés être une voie utile pour aider Israël à exploiter la vaste richesse minérale du Congo — son cobalt, son cuivre, son or, son étain et ses pierres précieuses.
Considérez les diamants. Les diamants taillés sont le plus grand secteur d’exportation d’Israël, à hauteur d’environ 288 milliards de dollars de 2001 à 2021. Cela représente presque un quart du commerce total d’Israël au cours de ces deux décennies, au cours desquelles ont émergé quelques barons miniers israéliens tels que Daniel Gertler et Beny Steinmetz. Selon le Trésor américain et des groupes anti-corruption comme Congo is Not for Sale, Gertler et Steinmetz ont fait croître leurs fortunes corpulentes grâce à des concessions minières « opaques et corrompues » au Congo et en Guinée, volant les caisses publiques des peuples africains de milliards de dollars. Leurs activités leur ont valu une tape sur les doigts — des sanctions périodiques, des amendes, une brève assignation à résidence. Il n’est pas évident que ces mesures punitives aient sérieusement entravé leur capacité à accumuler de la richesse à travers la forêt trouble des sociétés écrans et des paradis fiscaux qui font des barons du diamant israéliens ce qu’ils sont.
Pourtant, le cœur du problème va bien au-delà des manigances financières que nous pouvons tirer des Paradise Papers ou des Panama Papers. Le capital israélien récolte des profits démesurés de ses investissements dans les mines de diamants et de cobalt au Congo, où des enquêteurs comme Siddarth Kara trouvent des preuves flagrantes d’exploitation sévère des travailleurs, de travail des enfants, d’évictions de paysans, de destruction des écosystèmes, et de décès et blessures au travail généralisés. Le pillage du cobalt, la terre rouge du Congo, à hauteur de plusieurs millions de tonnes de minerai chaque année, a gonflé les profits de quelques-uns au prix de l’appauvrissement continu de la population congolaise, où un enfant sur dix meurt avant l’âge de cinq ans. En tant qu’investisseur précoce et éminent dans le secteur minier congolais, l’industrie israélienne du diamant est profondément impliquée dans cette tragédie.
Pendant ce temps, au Libéria même, des câbles israéliens révèlent qu’Israël a construit le palais somptueux du régime de William Tubman, tandis que le Mossad a aidé à établir son service de sécurité. Israël a systématiquement soudoyé les fonctionnaires libériens pour voter avec Israël aux Nations Unies. Lorsque Tubman a été renversé lors d’un coup d’État par Samuel Doe en 1980, Israël a rapidement armé la junte avec des centaines de milliers de dollars de munitions et a aidé à former l’une des unités les plus abusives de Doe, l’Unité spéciale anti-terroriste (SATU). De même en Éthiopie, où le Derg marxiste est arrivé au pouvoir en 1974, des armes et des conseillers israéliens ont continué à affluer, alors qu’Israël espérait écraser le groupe rebelle érythréen ELF et acheter la coopération tacite de Mengistu Haile Mariam pour relocaliser les derniers Juifs d’Éthiopie et du Soudan en Israël.
Juifs africains contre réfugiés africains
L’intérêt démographique pour l’émigration africaine avait bien sûr ses limites. Depuis 1973, lorsque le Grand rabbin séfarade d’Israël a statué que les membres de la communauté juive éthiopienne étaient les descendants halakhiques de la tribu perdue de Dan, aucun autre grand groupe juif africain n’a bénéficié de droits comparables à l’émigration. Le rabbinat ne reconnaît ni les Juifs Igbo au Nigeria ni les Abayudaya de l’Ouganda comme de véritables juifs. Même les Falasha Mura restants d’Éthiopie (Juifs convertis de force au christianisme) ont fait face à une pression anti-immigrants croissante. « Cela ouvrira la porte à une extension sans fin d’une chaîne familiale venant du monde entier », écrit le membre du cabinet d’extrême droite Bezalel Smotrich sur la décision du rabbinat en 2021 d’autoriser mille Falasha Mura à entrer en Israël. Pendant ce temps, l’extrême droite ne soulève aucune objection aux plusieurs centaines de convertis afrikaners blancs qui ont émigré en Israël ces dernières années, dont beaucoup vers des colonies en Cisjordanie.
Les demandeurs d’asile en Israël venant du Soudan, d’Érythrée et du Congo (RDC) font face à un accueil encore plus froid. Moins de 0,15 % de leurs demandes d’asile sont acceptées, l’un des taux les plus bas du monde occidental. Selon les lois actuelles, les migrants irréguliers sont détenus jusqu’à un an. Des milliers sont déportés vers le Rwanda, une tactique que des gouvernements de droite successifs auraient arrangée en soudoyant le régime de Kagame. Quiconque a visité la prison de Holot en Israël sera attristé par la vue. Des hommes à barbes blanches languissent solennellement. Des histoires de persécution soigneusement racontées, des récits de vies déracinées, une sous-caste humiliée, vilipendée et contrainte aussi cruellement que les cibles de l’archipel carcéral ICE au Texas ou du système FRONTEX de l’UE. Visiter Holot ou voir une file d’hommes noirs « volontairement » monter à bord d’un avion pour Kigali à l’aéroport de Tel Aviv, c’est voir des humains brisés. Leur dignité défigurée.
La logique de l’Etat colonial d’Israel
Au bout du compte, l’idéologie sioniste a très peu en commun avec les luttes pour la liberté des Noirs ou des Africains. Même l’analogie Israël-Libéria est contredite par les disparités significatives entre les deux projets. Il est bien plus facile de soutenir que le sionisme est d’abord apparu comme un projet restaurationniste chrétien dès l’époque des Puritains anglais ; qu’il a pris de l’ampleur parmi certains Juifs européens (mais pas initialement ceux du Moyen-Orient ou d’Amérique) en réponse à des vagues croissantes d’antisémitisme en Europe à la fin du XIXe siècle. Qu’il a avancé sous l’égide de quelques intellectuels bourgeois, avec des garanties impériales, en collaboration avec le capital de la diaspora, et qu’il a été antagonisé par les courants idéologiques nationalistes romantiques, en particulier en Allemagne. Une fois établi, Israël s’est comporté comme un jeune État colonial de peuplement, désireux d’assurer l’immigration continue de co-ethniques et adoptant une politique d’élimination envers les indigènes, comme son ancien État colonial protecteur, les États-Unis.
Israël, au grand dam de ses éléments de gauche et humanistes, n’a eu aucune hésitation à travailler avec des dictatures africaines pour faire avancer ses intérêts commerciaux, démographiques et diplomatiques en tant qu’État colonial ethno-national juif. Cet État avait besoin d’alliés. Il avait besoin de propagande pour détourner l’attention humanitaire de son occupation. Il avait besoin de clients pour son industrie d’armement et de mines pour ses barons du diamant. La guerre du Biafra est un exemple utile de cette logique cynique. Israel a maintenu secret son soutien militaire aux séparatistes Igbo afin de ne pas froisser le régime fédéral de Lagos tout en envoyant de l’aide humanitaire pour apaiser les préoccupations des citoyens israéliens et des alliés régionaux, ce qui lui a permis de détourner l’attention mondiale des nouveaux territoires occupés par Israël en Cisjordanie et à Gaza, et de vendre des armes à quiconque serait prêt à les acheter.
Richard Solomon