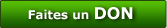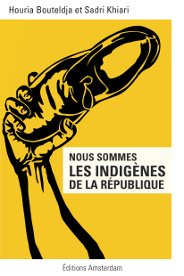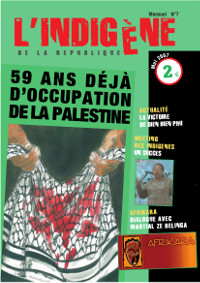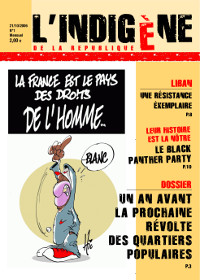J’écris pour dépasser la paralysie provoquée par tant d’images de douleur, et par le fait de savoir que, peu importe le degré d’exposition publique et de documentation de cette douleur, rien ne l’arrêtera. Des milliers d’autres mourront. J’écris pour ne pas accepter que ces personnes soient déjà mortes, même si je sais que c’est vrai.
La seule réponse raisonnable à ces images qui en promettent inévitablement d’autres, face à cette grotesque production en chaîne de la souffrance, c’est le choc et la rage. Dans les villes en dehors de Palestine, qui regardent, la rage est canalisée vers l’extérieur, mais aucune protestation, aucune mobilisation, aucune action organisée ne parvient à la contenir, rien ne permet de faire face à l’accumulation quotidienne des informations et des images, ou de faire face à l’absence d’images.
Pour certains d’entre nous, ceux que l’on voit à l’image sans ceux qui leurs sont chers à leurs côtés, une partie de la rage va se retrouver déviée, latéralement ou intérieurement, et paralyser ou obstruer notre pensée, notre capacité à fonctionner.
Mais puisque cette souffrance et une grande partie de son flux d’images sont produits par des systèmes qui s’auto-perpétuent – des relations coloniales qui se manifestent dans les ventes d’armes, les lignes éditoriales des médias traditionnels, les algorithmes qui veulent altérer nos consciences –il est important de traiter ce que laisse cette rage, ce surplus non canalisé que nous portons tous en nous, parfois comme une pierre dans la poitrine, pire qu’un deuil, un chagrin plus gros que la nature puisse supporter. Peut-être qu’en y regardant de plus près, nous pouvons éviter la fossilisation de cette rage, sa transformation en amertume, ou sa transmutation en sentiments tels que la culpabilité ou la honte, qui s’enfouissent inutilement à l’intérieur.
Il est peut-être temps de parler des enfants. Les plus visibles, ceux dont on parle le plus parmi les victimes. Le scandale du nombre de leurs morts, qui choque de moins en moins. En termes de psyché collective, arrivés à 5 000 enfants morts, le souffle de ceux qui regardent la Palestine depuis l’extérieur de la Palestine s’est coupé. Pour recommencer à respirer à nouveau, la société a dû s’adapter aux conditions de ce monde. Et c’est ainsi qu’il y a eu 13 800 morts, et que d’autres ont été tués depuis. Et ce ne sont pas seulement les morts massives d’aujourd’hui ou d’hier qui risquent d’être normalisées. Les morts futures participent déjà de la production du moment présent, ici à Londres, à New York, à Paris, à Berlin, au Caire.
Au cours des premières semaines, j’ai pensé que la douleur et la colère viscérales que je ressentais dans chacune de mes cellules, qui atteignaient souvent leur paroxysme ou trouvaient leur expression dans les moments où je m’occupais de mes propres enfants, seraient un état partagé, animant politiquement des milliers ou des millions d’autres personnes. Et c’est peut-être ce qui s’est passé. Peut-être que la leçon à tirer est que cela n’a pas d’importance – que même l’empathie peut tomber du ciel comme des paquets d’aide entre deux bombes, toutes deux tuant des enfants.
Nous ne parlons plus d’hypocrisies, de contradictions révélées. Tout a été révélé, encore et encore. La véritable bataille à laquelle nous devons faire face n’est pas seulement – seulement ! – le sionisme et ses récits, mais comment trouver et maintenir une discipline de travail politique en dépit de l’enchevêtrement de nos contradictions, qui sont plus enracinées que jamais auparavant. Je veux parler ici de l’enchevêtrement de contradictions qui accompagne le fait, dans ce monde capitaliste, d’être une personne consciente [1].
Lorsque nous sommes révoltés par des titres de journaux refusant de nommer les assassins des enfants palestiniens, nous devons réfléchir à notre propre cadre de compréhension de ces meurtres de masse. L’armée israélienne ne tue pas des enfants par mégarde ou par vengeance. Elle tue tant d’enfants parce que, comme l’ont explicitement déclaré des responsables passés et présents, et comme le démontrent les faits sur le terrain, elle en a l’intention[2]. Nous devons réfléchir au pourquoi.
Nous devons affronter et réfuter l’hypothèse selon laquelle il serait aberrant pour Israël de tuer des enfants dans le cadre de sa guerre d’élimination. Le meurtre d’enfants n’est pas aberrant. Il est central, fondamental, axiomatique. Israël tue des enfants palestiniens parce qu’il le veut, parce qu’il en a l’intention, parce qu’il le prévoit [3]. Ce n’est que lorsque nous comprendrons qu’il s’agit d’un meurtre avec préméditation que nous pourrons commencer à comprendre ce que cela signifie à Gaza, pour ce monde qui autorise et partage ce moment historique, et pour ceux d’entre nous qui essaient de répondre à ce que ce moment exige de nous.
Dans « Lettre de Gaza », son auteur Ghassan Kanafani invite un ami à retourner à Gaza, à prendre part à la lutte, à voir la jambe amputée d’une jeune fille, à apprendre d’elle, afin qu’il puisse comprendre « ce qu’est la vie et ce que vaut l’existence ». La plupart d’entre nous n’aura pas ce privilège. La plupart des habitants de Gaza qui partent ne pourront pas revenir. Mais que pouvons-nous encore apprendre si, à l’instar de l’universitaire palestinienne Orouba Othman[4], nous prenons cette douleur comme un point de départ, au lien de l’appréhender comme une condition à consommer ou à rejeter ?
Les enfants vous imposent l’avenir. En s’occupant d’eux, on est obligé de penser à administrer la vie de demain, de la semaine prochaine, ou du mois prochain. Si vous faites partie des chanceux de ce monde, vous pouvez penser à l’année prochaine. Ils vous obligent également à envisager l’avenir du monde au-delà de votre propre vie, de sorte que vos efforts présents aient un impact sur leurs vies futures. Ce futur en puissance peut être une force pour le conservatisme comme pour le radicalisme.
Le monde dans lequel Israël nous a plongés est un monde où il peut mener une guerre contre les enfants parce qu’ils sont à la fois une représentation de l’avenir et la continuation du passé, deux dimensions qu’il refuse aux Palestiniens. Pour Israël, les Palestiniens ne peuvent exister que dans le présent, dans le temps et la temporalité de la domination.
Nous avons vu des centaines, des milliers d’enfants à Gaza, nous les avons vus et entendus pleurer, mourir, appeler à l’aide, jouer, mendier de la nourriture, insister sur le fait qu’ils ne quitteront jamais la terre, souhaiter rentrer chez eux, chanter, pleurer, être incapables de pleurer, grelotter, trembler, ou regarder les adultes autour d’eux perdre la raison, jusqu’à dire aux caméras qu’ils auraient souhaité que leurs propres enfants meurent rapidement plutôt que d’être affamés. De nombreuses personnes ont vu des enfants subir des amputations sans anesthésie. Aujourd’hui, nous voyons des enfants mourir de faim.
*
Si nous ne pouvons pas nous rendre à Gaza, que nous apprennent-ils encore ? Qu’y a-t-il à apprendre à leur contact et celui de leurs membres amputés, au plus près de leur point de vue et de leur expérience, à défaut de leur présence physique ? Au contact de ceux qui ont survécu à la perte, ou qui n’ont pas survécu, et des maisons détruites, des membres déchiquetés et des êtres chers disparus, face à tout ce qu’ils ont perdu ?
La colère et la douleur ressenties par le monde pour et au nom des enfants sont souvent liées à l’idée d’innocence. Les enfants sont protégés en tant que catégorie parce qu’ils sont présumés innocents des crimes et des méfaits des adultes ; plus encore, ils sont en quelque sorte présumés hors de notre monde. Cette catégorie, telle que définie, s’avère cependant inopérante pour les enfants palestiniens lorsqu’elle est appliquée de l’extérieur à leur situation de membres d’une population occupée et assiégée. Pour Israël, toute vie palestinienne est terrifiante, et tuable. Israël a montré au monde ce que tous les génocides ont montré auparavant : lorsque les hommes sont tuables, les enfants et les femmes le sont aussi. Telle est la logique de la violence exterminatoire mise en œuvre par la force sioniste : tuer, terroriser et dominer afin d’éliminer les Palestiniens de leur terre.
Du point de vue du colonisateur, l’innocence des enfants colonisés est impossible, car l’innocence signifierait qu’ils ignorent la domination qui conditionne déjà leurs vies. Pensez au jeune enfant qui fait face à une arme à feu alors qu’il est réfugié dans une école et qu’il est sur le point d’être tué, à la terreur de cet enfant. Cette terreur n’est pas innocente – c’est une terreur qui s’appuie sur une connaissance, tout comme la terreur de l’enfant qui assiste à l’exécution de son père ou à l’effondrement de sa maison. Ou l’enfant qui sait qu’il ne peut pas voyager à cause du sionisme, que sa famille est réfugiée à cause du sionisme, qu’il n’a pas assez de nourriture à cause du sionisme. Cette connaissance réfute le type d’innocence sans connaissance que le monde semble exiger des enfants : ils sont déjà bien au-delà de cela. Ils sont des sujets politiques, des sujets dotés d’un pouvoir d’action et inscrits dans le temps historique. Même les bébés en couveuse, dépourvus de langage, contiennent la puissance politique du temps, de l’avenir, et sont ainsi rendus tuables.
Parmi les nombreuses personnes tuées et celles qui souffrent, les enfants suscitent des sentiments plus vifs, plus clairs et plus dramatiques que les adultes parce qu’ils sont plus clairement et plus dramatiquement puissants dans la manière dont ils nous convoquent autour d’eux dans la société. Observez l’effet produit par un bébé dans n’importe quelle assemblée ou par un enfant de huit ans sur une scène. Ils appellent notre attention parce qu’ils ont besoin de nous et en raison de tout ce que nous projetons sur eux : l’innocence, l’espièglerie, la tendresse et notre besoin de tendresse, les fantasmes de l’avenir, de ce que nous pouvons faire et de ce que nous pouvons contrôler. Les cerveaux et les inspirateurs israéliens de ce génocide le savaient, et c’est peut-être ce qu’ils voulaient dire lorsqu’ils déclaraient qu’il n’y aura de paix que lorsque les Arabes sauront aimer leurs enfants[5]: les aimer avec une autre vision de l’avenir, les aimer sans relation avec la terre, les aimer sans la Palestine, les aimer dans l’acceptation de la domination, ou encore les aimer ailleurs.
Une photo récente de Gaza montrait un garçon en pyjama étreignant un autre enfant, tous deux morts dans les décombres. Le pyjama du garçon était bleu, imprimé de parachutes ou de vaisseaux spatiaux, des références au ciel. La candeur et l’innocence de ce pyjama bleu rendaient la cruauté de la scène plus choquante, plus douloureuse.
Pendant ce temps, en Cisjordanie, des adolescents se lancent dans la résistance armée et des enfants plus jeunes disent aux caméras qu’ils veulent se battre contre leurs occupants[6]. Israël, qui accélère sa violence effroyable dans tout le pays, dira qu’ils n’ont jamais été innocents et qu’ils ne le seront jamais. Les forces d’occupation abattent des enfants et refusent de sortir leurs corps des morgues, où ils sont conservés sans être lavés, sans que leurs familles puissent faire leur deuil.
Mais ce sont tous des enfants : ceux qui sont tués en pyjama et ceux qui tiennent une arme ou tentent d’attaquer un soldat de l’occupation à un poste de contrôle. Pourquoi continuons-nous à exiger l’innocence de la vie, où que ce soit, mais surtout dans un endroit qui connaît une telle violence ? Que cache cette catégorie d’innocence ? Qu’est-ce qu’elle nous empêche d’apprendre, dans un monde où de telles scènes sont possibles ? Quels types de solidarités exclut-elle, et quelle violence supplémentaire permet-elle ?
Les Palestiniens ont l’habitude d’appeler les enfants « mama » ou « baba ». S’adresser à un petit enfant de la même manière qu’il s’adresse à vous va dans le sens d’une égalisation de la relation de pouvoir entre l’adulte et l’enfant, la personne qui s’occupe de l’enfant et celle qui est aidée. Les enfants ne vivent pas et ne meurent pas dans des catégories distinctes. Ils sont liés à notre propre capacité à être tués et à être colonisés. Les enfants le savent et nous devons le savoir aussi.
La douleur des enfants de Gaza doit être comprise comme faisant partie de la condition plus large de la société palestinienne dans laquelle ils sont systématiquement « exclus de l’enfance », comme l’écrit Nadera Shalhoub-Kevorkian[7]. Ceux d’entre nous qui ne vivent pas en Palestine doivent également réfléchir à leur propre regard sur les enfants, à leur point de vue situé à partir duquel ils les comprennent. Celui-ci est largement façonné par l’idée que les enfants sont l’objet de soins et relèvent de la propriété privée, au sens bourgeois du terme : ils appartiennent à des familles nucléaires ou élargies, des foyers qui vivent en privé, au moins en termes économiques. Les familles sont des réseaux discrets qui se nourrissent et se perpétuent de manière autonome, par le biais des liens du sang et de la propriété. Les enfants sont les nœuds de cette perpétuation et sont donc des aimants – des aimants qui agrègent à la fois notre plaisir (« il y aura un avenir ») et les divers pouvoirs que nous exerçons sur eux (« nous façonnerons, modèlerons, disciplinerons les enfants pour que l’avenir soit acceptable pour nous/nos intérêts/nos investissements »).
Cette vision propriétaire, que les féministes du monde entier considèrent comme un facilitateur des processus capitalistes [8], tant elle est liée à l’organisation privée et genrée du travail reproductif, nous pousse à penser que les enfants sont passifs et qu’ils ne nous concernent pas à moins qu’ils ne soient « nôtres » au sens familial du terme.
Les images de Gaza proviennent de lieux d’amour et de soins intimes : l’adolescent transportant les parties du corps de son frère dans un sac à dos, le père portant ses enfants dans un sac en plastique. Le garçon qui tremble sous la pluie, dans l’obscurité, en appelant son ami sous les décombres.
Ressentir la douleur de ces scènes n’est qu’une partie de la manière dont nous pouvons considérer et interpréter les personnes qui y figurent : l’humanité de ces actes d’amour réside dans le fait qu’ils disent Je ne t’abandonnerai pas. Même si vous êtes démembrés, je vous donnerai la dignité d’un enterrement dans ce génocide. Alors que le sionisme impose un paysage de mort, ces actes portent la force de la vie et la replacent dans le temps humain, c’est-à-dire politique : une tombe à visiter ou au moins à laquelle on pensera à l’avenir, pour nous souvenir du passé.
Le décalage entre notre société capitaliste qui s’auto-perpétue et la réalité des Palestiniens occupés nous empêche de comprendre les enfants palestiniens, et ce décalage sert le génocide. En ne percevant pas leur statut de cibles directes du génocide et de la violence coloniale sioniste en général, et en ne les appréhendant pas comme des membres actifs et vivants d’une société résistante, une société qui résiste par son existence même, nous plaquons sur les enfants palestiniens une définition de l’enfant qui nous est propre : un enfant innocent, passif, qui n’a pas encore été façonné. Cette catégorie est inefficace car elle est inadaptée aux enfants palestiniens. Et cela permet finalement aux sociétés occidentales de continuer à les mettre à distance, eux et leur douleur, comme étant hors de leur monde, hors de leur influence, hors de leur portée, alors même que c’est bien ce monde-là qui rend leur souffrance possible.
Yasmin El-Rifae
Article original publié en anglais dans Parapraxis Magazine
[1] Par exemple, les téléphones qui nous permettent de recevoir des rapports de journalistes palestiniens nous relient également à certaines des plus grandes entreprises du monde, sans doute les plus influentes sur le plan politique.
[2] D’innombrables rapports et témoignages de l’assaut actuel le démontrent, ainsi que des décennies de meurtres et d’abus documentés d’enfants palestiniens par les forces israéliennes.
Quelques publications récentes : Harsh Israeli rhetoric against Palestinians becomes central to South Africa’s genocide case, ‘Not a normal war’: doctors say children have been targeted by Israeli snipers in Gaza, Gaza: Israel’s Imposed Starvation Deadly for Children
[3] Gaza: Initial findings show Israeli army purposefully kills a child, uses an American-made missile to target her rescue crew
[4] Intervention de Orouba Othman à “Except Palestine: Gender and Genocide”, conference co-organisée par l’Université Bir Zeit (Palestine) and and l’Université Birkbeck (Londres), à Londres le 6 mars 2024. Traduit de l’arabe.
[5] L’une des déclarations les plus célèbres et les plus fréquemment citées d’un homme politique dans l’histoire du sionisme après 1948 est attribuée à Golda Meir : « Nous pouvons leur pardonner d’avoir tué nos enfants, mais nous ne pouvons pas leur pardonner de nous avoir fait tuer leurs enfants. La paix viendra lorsque les Arabes aimeront leurs enfants plus qu’ils ne nous haïront ». Cette phrase aurait été prononcée au National Press Club de Washington DC en 1957 et publiée à la dernière page de l’autobiographie de Meir intitulée « A Land of our own : An Oral Autobiography » (G.P Putnam’s Sons, 1973).
[6] Voir le film Jenin, Jenin de Mohamed Bakri (2002). Reportage récent. Travaux récents du photographe et réalisateur Sakir Khader en Cisjordanie.
[7] Unchilded dans le texte. Voir “Incarcerated Childhood and the Politics of Unchilding” [L’enfance incarcérée et la politique de privation d’enfance], Nadera Shalhoub-Kevorkian, Cambridge University Press, 2019
[8] L’utilisation de ce terme spécifique ici est empruntée à Sophie Lewis, intervenant sur le podcast The Ordinary Unhappiness, “The Fantasy of Family and the Meaning of Family Abolition” 16 mars 2024.