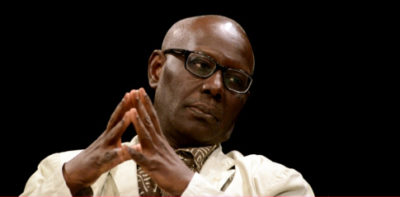L’une des tragédies humaines les plus horribles en ce début de XXIe siècle est incontestablement celle des migrants. Des millions d’hommes, de femmes, d’enfants africains, arabes, afghans se lancent à corps perdu par dizaines de milliers dans un périple auquel ils ne sont jamais sûrs de survivre. La fracture Nord–Sud – reproduisant les lignes de force d’une géographie coloniale et raciale plus tenace qu’il n’y parait – semble se réaffirmer plus que jamais à travers ces évènements. Beaucoup des discours et réactions qui se lèvent en Europe pour traiter cette question font froid dans le dos.
Je veux bien croire que les mots échappent à leurs auteurs, mais les images, elles, sont étroitement contrôlées et leur message est, comme vous dites, effrayant. On a le sentiment d’être dans ces formes de déni d’humanité annonciatrices des grands bains de sang. Mais il y a peut-être pire que cela et c’est le rien-à-signaler des médias. Pour les passeurs en Méditerranée, ce silence est d’or, il fait marcher les affaires et vaut aussi licence de tuer. L’Europe fait mine de les combattre (« des garde-côtes italiens ont sauvé X migrants clandestins »), mais en réalité elle voit ces passeurs comme une efficace force de dissuasion. Qui s’est jamais résigné à l’invasion des Barbares ? Mais vous savez, chaque fois que nous déplorons l’indifférence des médias, nous pensons à CNN, au New York Times ou à la BBC, leur conférant ainsi l’autorité de dire et de taire. Pourquoi n’en parlons-nous pas nous-mêmes ? Je veux dire : pourquoi n’y a-t-il pas eu par exemple une ligne dans la presse sénégalaise ou nigériane sur ce qui est arrivé à Pateh Sabaly en Italie ? Ce jeune Gambien s’est noyé il y a quelques mois dans le canal de Venise au milieu des quolibets et des cris de haine de braves gens qui ne voulaient surtout pas rater l’occasion de filmer sa lutte contre la mort ! Pour reprendre votre expression, ça fait froid dans le dos, ces images font soudain remonter à la surface un lourd passé de racisme occidental. Et au fond on peut avoir l’impression que sur la longue durée tout cela tourne en boucle : nous voyons parfois sur la Toile des scènes de lynchage dans l’Amérique d’avant, avec ici aussi des types ordinaires venus au spectacle, endimanchés et joyeux, et le spectacle ce sont des Nègres que l’on brûle vifs. Ce qui se manifeste aujourd’hui dans de tels comportements, c’est l’angoisse européenne d’une probable perte d’emprise sur le monde ; quand les suprémacistes blancs disent à Charlottesville il est hors de question de laisser l’Amérique nous échapper, c’est de tout l’univers qu’ils parlent. Il n’est dès lors pas étonnant que le Ku-Klux-Klan reprenne du service, que la croix gammée s’affiche sur les devantures des maisons dans l’Amérique profonde et que les néonazis siègent à Berlin. Il n’est plus question d’avancer masqué, on se lâche au contraire. La tragédie des migrants est en train de dissiper les dernières illusions sur le prétendu humanisme occidental.
Ce racisme-là et cette incroyable négation de l’humanité de l’Autre – celle du Noir ici – vous semblent-ils participer d’une certaine prégnance de cette idéologie coloniale et raciste européenne qui a si bien guidé et structuré l’expansion de la modernité occidentale aujourd’hui ?
On parle souvent de l’impact psychologique de l’expérience coloniale sur ses victimes. Il est indéniable, mais le colonisateur a presque autant de mal à s’en relever. C’est à se demander si cette haine affichée, quasi jubilatoire, de l’Arabe ou du Noir, n’est pas plutôt le refus d’assumer une histoire si violente, une sorte de confession de ses crimes face au miroir, sur le mode du ‘‘So what ?’’ Oui, on peut me reprocher d’avoir détruit à des degrés divers tous les peuples non-blancs. Et après ? Le paradoxe c’est que l’on espère guérir de cet aveu en ressassant à perte de vue sa propre générosité, un tyrannique respect du vivant. D’où l’hypocrite bavardage sur les droits humains, d’où ces opérations médiatisées de sauvetage de quelque panda ou bébé chimpanzé. Mais survient la noyade à Venise de Pateh Sabaly et l’Occident découvre, pour parler comme Brecht, que ‘’le ventre est encore fécond d’où est sortie la bête immonde’’.
Immonde oui… pourtant, face à cet Occident qui se replie, des milliers continuent d’affluer et des milliers meurent en chemin. Comment analysez-vous ces migrations et les immenses sacrifices qu’elles engagent pour tous ceux qui, au grand péril de leur vie, se lancent dans la si dangereuse aventure de cette traversée ?
On comprend ceux qui fuient la guerre, qu’ils soient Syriens, Afghans ou Irakiens, mais quid des jeunes Nigérians, Maliens ou Sénégalais ? Là, on se trouve face à une véritable énigme parce que même la certitude d’aller au-devant de la mort ne peut pas arrêter ces jeunes qui ont toute leur vie devant eux. Pourquoi travailler avec tant d’énergie à sa propre destruction ? Ceux qui commettent des attentats-suicide espèrent aller au Paradis ou alors choisissent de se sacrifier pour une cause qui les dépasse. Mais quelle est la motivation de ceux qui vont en Libye ? Ils auraient pu rester dans leurs pays et s’y battre contre ce qui les pousse à l’exil, car ils sont jeunes, courageux et d’une grande force de caractère. Peut-être bien que les difficultés sur le continent ne sont pas seulement politiques et économiques. Peut-être se heurtent-ils chez eux à une sorte d’impasse existentielle, ils se sentent pour ainsi dire ‘’sans importance sociale’’ aux yeux des leurs – il y a une expression en wolof, ñàkk a tekki, pour signifier cela – et on est ici dans l’ordre du symbolique, d’un imaginaire malmené. Cela incite à se penser d’abord comme individu, à s’infliger des souffrances parées de vertus rédemptrices : le problème c’est moi et non pas la société et je dois me faire violence pour donner du sens à ma vie. Et partout, y compris dans les pays du Maghreb où ils transitent, ils sont rejetés, maltraités et parfois assassinés. À ce propos, je pense qu’il convient de s’arrêter un moment sur le rapport très problématique des sociétés arabes à la peau noire.
C’est très juste. La façon dont certains migrants sont traités dans plusieurs pays arabes – au Maghreb notamment, mais pas seulement – est affligeante. La négrophobie y est aussi extrêmement virulente, et trop souvent ouverte, décomplexée. Peut-être même de plus en plus.
Absolument. Nous savons tous que c’est un sujet très embarrassant, pour toutes sortes de raisons, et nous n’avons jamais su par quel bout le prendre. Cela doit changer. Je me suis permis de fustiger il y a quelques semaines, sur le site sénégalais Seneplus, cette négrophobie tour à tour diffuse et brutale, voire meurtrière des sociétés arabes, parce qu’il est temps de crever l’abcès. Ce n’est pas seulement une affaire de conscience personnelle, l’actualité nous l’impose aussi. En décembre 2016 puis plus récemment, il y a eu des ratonnades – je n’utilise évidemment pas ce mot par hasard – négrophobes en Algérie. Et ce n’était pas un simple explosion de xénophobie populaire, on a entendu les propos abjects de cet officiel algérien proche des cercles dirigeants, un certain Farouk Ksentini – ironiquement, il préside la Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de l’Homme (CNCPPDH) ! – qui n’a pas hésité à justifier les arrestations massives de migrants subsahariens en les accusant de propager le sida, entre autres maladies sexuellement transmissibles. Si ce n’est pas de l’incitation publique à la haine raciale, c’est que les mots n’ont plus aucun sens. Ce qui doit nous faire réfléchir, c’est que dans la plupart des pays occidentaux de tels propos auraient suscité un tollé. Et que dire de la façon dont les migrants subsahariens sont traités dans la Libye dévastée par les nouvelles guerres impérialistes… ? Je m’en voudrais de généraliser, des voix continuent à s’élever dans le monde arabe pour dénoncer ce racisme, les pêcheurs tunisiens se sont mobilisés pour empêcher des groupes néonazis d’accéder au port de Zarzis, et l’on voit également d’humbles et nobles âmes à Medenine ramasser les corps rejetés par la mer pour leur donner, en toute humanité, une sépulture décente. En outre – c’est là une autre question de fond, d’ailleurs récurrente – on n’a rien entendu sur ce sujet du côté des politiques et des intellectuels d’Afrique subsaharienne… Même l’institution de marchés libyens aux esclaves n’a suscité le moindre intérêt de leur part. Considérons-nous ces jeunes comme d’authentiques êtes humains ? La question mérite d’être posée. Toutefois la prise de parole doit concerner autant les flambées de violence, une violence parfois extrême, comme en Libye, que le racisme ordinaire. Si le clivage entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne n’est pas nouveau, il avait au moins honte de s’exprimer il y a seulement quelques années. C’est de moins en moins le cas. De telles bouffées de haine nous desservent tous, leurs ressorts sont complexes, mais il nous faut à tout prix les affronter avec courage et dignité. Je cherche à provoquer un dialogue franc et constructif, pas une vaine controverse. C’est ainsi que je vois mon rôle d’intellectuel.
À ce propos, dans un article traitant de la négrophobie en Tunisie, Sadri Khiari analyse ce racisme comme étant, finalement, un racisme « blanc » qui se réfracte à travers l’identité frustrée et dominée de nombreux Arabes. Il dit notamment : « Les Arabes cesseront d’être racistes, quand les Arabes cesseront de se prendre pour des Blancs ». Qu’en pensez-vous ?
Je suis tout à fait d’accord avec Sadri Khiari. Ayant vécu quatre ans en Tunisie, je sais très bien de quoi il parle. Je dois préciser avant d’aller plus loin que je m’y suis senti chez moi, grâce à des personnes qui restent parmi les plus importantes rencontres de ma vie. Il faut cependant faire la distinction entre ce vécu amical, voire fraternel entre intellos, et ce qui vous arrive quand vous êtes seul au restau ou dans un magasin. C’est souvent assez lourd et vous avez tout le temps la confirmation que le racisme ordinaire est partout le fait des crétins et des frustrés, qu’ils soient éduqués ou pas. Khiari exprime cela avec la force de l’ironie, mais ici aussi la majorité reste hélas silencieuse. C’est le chœur des humains de bonne volonté qui nous permettra de trouver une issue et même d’envisager des solutions concrètes. Les États du Maghreb sont également interpellés, car la condamnation officielle du racisme peut faciliter l’éducation et marginaliser au moins le phénomène, faute de pouvoir l’éradiquer. Pour en revenir aux intellectuels subsahariens, leur mutisme a pu longtemps s’expliquer par une sorte de solidarité des opprimés, revêtant également une dimension religieuse – une solidarité qui n’est pas sans fondement d’ailleurs – dans une configuration où Noirs et Arabes refusent à l’Occident blanc le plaisir de voir ses victimes plus occupées à se taper dessus qu’à faire front contre lui.
Un autre point essentiel, c’est la connexion entre impérialisme et racisme. L’histoire moderne le prouve assez : la domination impériale n’est pas seulement productrice d’un ordre économique, social ou politique nouveau, elle agit également sur les références et sur les représentations qu’elle bouleverse et réorganise à son image. Le romancier sénégalais Cheikh Hamidou Kane fait poser à l’un de ses personnages une question qui donne presque le vertige, celle de savoir comment l’Occident a pu ‘‘vaincre sans avoir raison’’. Il s’agit en fait là d’une subtile interrogation sur les lendemains de notre défaite : la force militaire, la seule qui compte finalement, a fait de l’Occident l’étalon, le repère universel. Et cela a induit une hiérarchie raciale au sommet de laquelle on retrouve naturellement le Blanc. Le tragique, c’est bien le fait que cette hiérarchie, en dépit des grands discours humanistes, fasse en quelque sorte « système ». Il est donc pertinent d’analyser la négrophobie, si brutale dans les pays arabes, à travers le prisme de toutes les tares de la modernité occidentale (coloniale et impériale). Mais encore une fois il ne suffit pas de constater, il faut s’employer à guérir le mal.
Mais en dépit de ce racisme, d’une violence inouïe, qui les traquera tant sur leur passage dans les pays arabes qu’à leur arrivée, et en dépit – surtout ! – des demi-promesses de morts que leur fait la traversée : ils foncent. Comment expliquez-vous cela ?
Nous en avons parlé il y a un instant. La mort, les passeurs mafieux, le racisme, les tortures, les traitements inhumains, rien de tout cela ne les arrête… J’ai appris il n’y a pas longtemps que les passeurs libyens ont des relais dans certaines capitales africaines – on m’a parlé de Dakar et Abidjan. Ils appâteraient ces jeunes mal informés par de faux contrats de travail et une fois là-bas, c’est trop tard, ils sont purement et simplement vendus et leur statut de bétail humain leur vaut les pires sévices. Je veux bien croire qu’ils sont ainsi pris dans un piège infernal parce qu’on se surprend à leur en vouloir de se jeter ainsi dans la gueule de l’hyène. Cette histoire, il n’est pas facile d’en parler, on ne sait juste pas quoi en dire. Césaire, dans Cahier d’un retour au pays natal, évoque « le bruit d’un qu’on jette à la mer », en référence à ces esclaves malades ou peu dociles jetés aux requins durant la traversée. Ces scènes se répètent en Méditerranée aujourd’hui, sauf que les victimes investissent leurs maigres économies dans cette funeste aventure. Les raisons varient selon les pays, mais il est certain que beaucoup sont surtout fascinés par l’Occident, ils espèrent y échapper à la médiocrité. Seuls les plus chanceux, en nombre infime, arrivent au bout du voyage : une drôle de chance, d’ailleurs, que celle d’une vie précaire, celle des sans-papiers. Mais rien n’étant simple, il y a dans tout cela une générosité allant jusqu’au sacrifice suprême : après avoir vécu comme une tare son incapacité à aider les siens, le jeune migrant décide de tout tenter pour en guérir, quitte à tomber dans le piège d’une virilité suicidaire. De là-bas ils se privent pour les autres et bien sûr quand vous êtes supposé vous la couler douce dans l’Eldorado, vous ne pouvez dissuader personne de tenter sa ‘’chance’’, ce serait un aveu d’échec. En attendant que ça aille mieux, par miracle, on vit d’expédients et dans le mensonge.
Dans un monde postcolonial où l’Europe continue de piller, de bombarder, de (néo)coloniser… N’est-il pas aussi pertinent de regarder, en termes politiques, ces migrants comme étant des résistants ? Victimes d’un monde postcolonial qu’ils n’ont pas choisi, ils seront toutefois les acteurs courageux d’une résistance qu’ils choisiront. Je crois sincèrement qu’il est important que nous conférions à ces si tragiques mouvements de migrations leur part de dignité et de résistance. Ils ne sont pas que des victimes dignes de pitié. Ce qu’ils font ébranle la citadelle Européenne, même si tel n’est pas leur objectif bien entendu. Il n’empêche qu’ils font vivre ce mouvement de résistance.
C’est la thèse de Sadri Khiari, elle sort des sentiers battus et attire l’attention sur l’extraordinaire complexité politique de ce qui se joue en Méditerranée. Je dois avouer que son texte, récemment découvert, me fait beaucoup réfléchir en ce moment. Je me sens parfois un peu perdu parce que je ne trouve – par ignorance sans doute – rien de comparable dans l’histoire humaine. Le phénomène entre en résonance avec des soulèvements d’opprimés, y compris les soulèvements d’esclaves au temps de la Traite négrière, pour reprendre un exemple de Khiari lui-même. Mais très vite les différences sautent aux yeux. Ce qui est toutefois indéniable, c’est qu’il faut se démarquer, comme il nous y invite d’une certaine tendance à ne voir dans les migrants que des jeunes gens paumés, des objets de notre noble compassion et de notre colère. Cette auto-gratification petite-bourgeoise revient à dénier aux migrants toute dignité, toute vision claire de leur destin. Nous autres artistes avons tendance plus que quiconque à nous laisser submerger par nos bons sentiments. C’est bien que l’on nous ramène ainsi à la raison, au propre comme au figuré. Le simple refus de se résigner à un sort injuste est un acte de résistance et je l’avais déjà signalé dans La gloire des imposteurs. J’y parle en effet à Aminata Dramane Traoré de ces jeunes migrants installés dans une forêt de la frontière maroco-espagnole où ils ont créé une structure qu’ils appellent ‘l’Union Africaine’. Les ‘sommets’ qu’ils improvisent leur donnent l’occasion de parodier les égarements politiques du continent et surtout de taper furieusement sur les dirigeants africains qui les ont laissé tomber. Je vous l’ai dit il y a un instant, c’est en tant qu’individus que les migrants font, à partir de chez eux, un saut dans l’inconnu mais une fois dans les pirogues ou aux frontières ils se nourrissent de la conscience – éminemment politique – de constituer, au-delà de leurs différences de trajectoire, un bloc soudé, une force face à un ennemi commun, bien organisé et prêt à tout. Assis devant nos télés, nous ne voyons pas leurs visages et nous n’entendons pas leurs voix, car on ne les interroge jamais et cette ‘distance’, voulue ou non, incite inconsciemment à occulter les enjeux politiques. Quand cette histoire sera racontée, cette dimension de dignité et de volonté que Khiari est un des rares à mettre aujourd’hui en exergue apparaîtra plus clairement. Les damnés de la mer ne vont juste pas jouer les pique-assiette, ils veulent surtout reprendre leur dû des mains d’un Occident qui a tant pillé les autres nations.
La façon dont cette question capitale est posée en France actuellement laisse pourtant cruellement à désirer. Qu’il s’agisse des médias dominants ou des politiques, on y décèle la plupart du temps soit de l’opportunisme creux, soit une distance qui se garde bien d’appréhender ce drame d’envergure mondiale dans toute sa dimension humaine.
Faute de pouvoir retenir les migrants chez eux, l’Europe essaie de les bloquer en Afrique du Nord. Cela explique les atrocités en Libye et leur faible couverture par les médias occidentaux. En France, la phobie d’une invasion des Barbares ne date pas d’aujourd’hui et même au temps où la gauche existait, on avait du mal à voir en quoi sa vision des migrants différait de celle de la droite. Ce n’est pas parce qu’on se prétend le pays des droits de l’Homme qu’on va voir les migrants, d’où qu’ils viennent, comme des humains. Ce sont là des contradictions qu’Aminata Dramane Traoré est à ma connaissance une des rares à pointer du doigt. Elle organise ainsi chaque année à Bamako un événement dont le nom parle de lui-même – « Migrances » – et il a le mérite de faire circuler l’information ; les migrants de retour d’Europe ou du Maghreb y reviennent sur leur expérience et en décembre dernier l’une d’elles, coincée en Libye, s’est adressée à l’assistance par téléphone. Ces prises de parole ont un certain écho médiatique et c’est une alerte pour les jeunes Maliens moins enclins à tomber dans le piège des réseaux de passeurs. Aminata est une intellectuelle organique, femme d’action et de réflexion, ce dont l’Afrique n’a que trop besoin en ce moment. « Migrances » est aussi l’occasion d’interroger les contours géopolitique et économique du phénomène migratoire. On ne le sait sans doute pas assez, mais l’un des sujets les plus sensibles au Mali, ce sont les « accords de réadmission » à travers lesquels l’Europe aimerait systématiser l’expulsion vers leur pays d’origine de tous les sans-papiers indésirables sur son sol. Certains États africains, sous forte pression des capitales européennes, acceptent de les reprendre. Le Mali s’y est toujours refusé et Sarkozy l’a fait payer très cher à l’ancien président Amadou Toumani Touré. De fait, il est difficile d’imaginer Bamako se comportant autrement : le montant des envois des migrants vers le Mali est probablement supérieur à l’aide au développement et cela donne à sa diaspora un poids politique évident. Pendant sa campagne électorale, Macron a pris l’engagement de faire plier le président Ibrahim Boubacar Keita, mais on lui souhaite bien du plaisir. L’Union européenne est revenue à la charge en novembre 2016 via une manipulation assez grotesque du ministre néerlandais des Affaires étrangères. Mais son homologue malien Abdoulaye Diop s’est montré on ne peut plus clair en déclarant, lors d’une session de « Migrances » justement : « Nous n’avons jamais signé et nous ne signerons jamais ! »
Cette pression qu’exerce la France – et l’Europe en général – pour maintenir un contrôle toujours plus rigide sur ses frontières et l’entrée des migrants nous amène à une autre question essentielle : celle de la responsabilité des politiques et guerres occidentales dans cette immense tragédie.
Nous sommes tous devenus beaucoup plus timides quand il s’agit de nommer les choses, mais au cours de la dernière décennie l’Occident s’est mijoté de petites guerres d’agression impérialistes au nom, comme toujours, de ses grandes valeurs humanistes. C’est un constat d’évidence même s’il est difficile de savoir pourquoi il était soudain devenu si impératif de mettre l’Irak, la Libye et la Syrie à feu et à sang. Il ne faut donc pas s’étonner du pic démographique noté dans les migrations et du nombre beaucoup plus élevé désormais de Libyens, de Syriens ou d’Irakiens dans ces embarcations de fortune. Pour l’Occident, les guerres au loin c’est chouette, ceux qui y meurent ne sont que des chiffres même si parfois les grandes chaînes de télé s’y arrêtent parce que c’est si sensationnel… Dans le cas qui nous occupe, on n’avait juste pas prévu l’effet boomerang. Depuis bientôt quinze ans, tout ce qui se passe de pire dans le monde est plus ou moins directement lié à l’invasion de l’Irak. De manière assez ironique, Bush attaque l’Irak pour entre autres, ouvrir ce pays à la « démocratie » … et le résultat – après plus d’un million de morts civiles, c’est la naissance de l’État islamique, la peur sur les villes d’Occident, la montée en puissance des fascismes de plus en plus au centre du jeu politique et bien entendu comme vous l’avez dit des millions de réfugiés. J’ai envie d’ajouter : avec en prime un monsieur manifestement dérangé à la Maison-Blanche et à l’Élysée un jeune homme que personnellement je juge inconsistant et immature.
Pourquoi ces guerres impériales selon vous ?
C’est une vraie question. Il est vraiment difficile de savoir et s’il y a tant de théories dites du complot, c’est en raison du voile de secret sur ces événements. Mais l’Irak, ce n’était pas seulement une guerre des Bush, l’Amérique la voulait. Je me trouvais à Gainesville, en Floride, quelques jours avant l’invasion et l’opinion américaine y était très largement favorable, les grands médias aussi, qui poussaient inlassablement à la roue. Cela n’a guère été différent avec la Syrie et la Libye. Cette dernière reste un cas d’école, car peu de voix se sont élevées pour freiner Sarkozy. Que sont devenus les ‘‘révolutionnaires de Benghazi’’ ? Ils sont passés à la trappe. C’est en termes à peine voilés, avec un certain mépris, que le vaniteux BHL laisse entendre, dans La guerre sans l’aimer, qu’ils étaient ses marionnettes. À partir de là, on ne peut exclure aucune hypothèse : les contrats pétroliers et de reconstruction, le désir chez Sarkozy de faire taire pour de bon un Kadhafi corrupteur ou, dans une démarche plus stratégique, la nécessité de l’éloigner de l’Afrique subsaharienne. On va bien finir par savoir mais ce sera toujours trop tard pour les victimes de cette guerre impérialiste.
L’Afrique subsaharienne dans tout cela…
Contrairement à ce qu’on pourrait croire, elle a rarement été aussi présente sur un dossier international. L’Union africaine a multiplié les initiatives de paix, acceptées par un régime libyen aux abois il est vrai, mais vues par Sarkozy et Bernard-Henri Lévy comme ‘’le bouclier africain de Kadhafi’’ pour reprendre l’expression du second nommé. Il fallait casser cette dynamique solidaire et c’est ainsi que des « Mirage » français ont escorté Wade, le président sénégalais de l’époque, sur le terrain, en une mission assez triste et indigne d’interpellation publique de Kadhafi. Le continent a été présent d’une autre façon puisque tout au long du conflit les médias se sont fait l’écho de la propagande de Benghazi à propos des ‘‘mercenaires africains de Kadhafi’’. C’était distillé quotidiennement dans les journaux et sur toutes les télé, sur un ton détaché et prétendument neutre au moment même où Amnesty International et Human Rights Watch démentaient de concert l’accusation.
Mali et Côte d’Ivoire
La France s’accroche à son pré carré parce qu’elle se sent en nette perte de vitesse sur la scène internationale. Ses compagnies y reviennent en force, au Sénégal elles raflent tout, c’en est complètement indécent. À Abidjan la Force Licorne n’a pas hésité à défoncer les grilles du palais de Gbagbo pour le livrer à son rival Alassane Dramane Ouatara, qui se trouve être, par pur hasard n’est-ce pas, leur obligé. Elle est encore au Mali et ici il est intéressant de faire une petite comparaison : depuis l’indépendance de leurs anciennes colonies, le Royaume-Uni et le Portugal n’y ont jamais envoyé un seul soldat alors que les interventions françaises se comptent par dizaines ! Ces chiffres parlent d’eux-mêmes.
Pour revenir sur la Françafrique : comment percevez-vous, depuis votre situation africaine, les positions et réactions des acteurs politiques et médiatiques en France ?
J’invite souvent à propos de la politique africaine de Paris à ne pas faire d’amalgame entre l’État français et le peuple français. Survie, fondée par François-Xavier Verschave ainsi que d’autres groupes et personnalités abattent un travail considérable contre la Françafrique. Mais je dois aussi avouer que je suis parfois révolté de voir à quel point la société française dans son ensemble s’en accommode. Je parle ici des politiques de tous bords, des médias et du citoyen lambda. Voilà pourquoi la réputation de grand humaniste de Mitterrand reste intacte, en dépit d’une complicité avec les génocidaires rwandais que peu osent mettre en doute. Voilà pourquoi quand la revue XXI révèle que Védrine a demandé que soient réarmés pendant le génocide les assassins en déroute, personne parmi les belles âmes, même de l’extrême-gauche, ne pipe mot. Et finalement, de Madagascar au Rwanda en passant par l’Algérie et l’Indochine, la gauche française au pouvoir n’a jamais hésité à faire passer les intérêts de son pays avant le droit à la vie de millions de colonisés. Nous avons toutes les raisons de détester les idées nocives de Marine Le Pen, mais il arrive que nous nous demandions en quoi, dans la pratique, Sarkozy, Chirac ou Hollande sont différents d’elle.
Un débat de fond dans la société française sur la Françafrique ?
Peut-être ne faut-il pas rêver… Mais ne serait-il pas normal que des politiciens français soient comptables devant les citoyens français de ce qu’ils font en leur nom en Afrique ? C’est cela que j’entends par faire de la politique africaine de la France un sujet de politique intérieure. J’ai évoqué tout à l’heure Mitterrand. Il m’est également difficile de comprendre pourquoi, après ce qu’il a fait au Rwanda, Juppé a été à deux doigts d’être élu président. Il y a en France beaucoup de personnes de bonne volonté qui demandent lors des conférences : ‘‘Nous voulons aider l’Afrique, que nous conseillez-vous ?’’ Dans leur esprit, il s’agit de construire des postes de santé ou des écoles, mais cette démarche peut être, à leur insu, source de malaise. Une telle compassion est en effet, il faut bien le dire, assez problématique : ce n’est jamais plaisant de se rendre compte qu’on suscite de la pitié. Mais il y a surtout que j’ai envie de les inviter à sanctionner leurs élus qui mettent nos pays à genoux. Le Niger n’aurait pas besoin de leur charité si AREVA n’y pillait pas l’uranium et l’on peut en dire autant du Congo-Brazza et du Gabon avec leur pétrole. Quand vous dites cela, il y a toujours quelqu’un qui se gratte la tête avant de vous demander d’un air embarrassé si ce ne serait pas pire, les ressources du pays risquant alors d’être accaparées par la caste dirigeante… Le raisonnement est curieux parce qu’il consiste à dire : nous prenons vos richesses parce que vous ne saurez jamais en faire bon usage ! En fait le politique rejoint ici l’économique dans la mesure où, s’ils ne nous sont pas imposés par la force des armes, nos leaders se trouvent sous le strict contrôle de ceux qui les accusent d’être une vulgaire kleptocratie. Jusqu’à sa mort en juin 2005, une semaine après la sortie de Négrophobie, qu’Odile Tobner et moi-même avons cosigné avec lui, François Xavier Verschave a essayé de sauver l’honneur de son pays. De son vivant, les journalistes s’interdisaient d’utiliser le terme Françafrique dans le dessein avoué d’étouffer sa voix. Peine perdue, le mot est entré dans le langage courant et tout le monde sait hélas très bien ce qu’il signifie.
On fait toujours la même objection : n’est-ce pas trop facile de se défausser sur la France ? Et la responsabilité des Africains eux-mêmes dans cette situation ?
La question est importante, nous ne devons pas l’esquiver. Je veux bien croire qu’on est toujours un peu complice de son bourreau, mais si notre responsabilité est réelle, elle ne l’est pas, de mon point de vue, au sens où on l’entend habituellement. Je veux dire par là que ce n’est pas de notre faute si nous avons dû nous soumettre à une force militaire supérieure, cela est toujours arrivé dans l’histoire humaine. En revanche, nos élites ont été criminelles en acceptant il y a soixante ans une indépendance tronquée et truquée. Et ceux d’entre nous qui s’énervent aujourd’hui dès qu’ils entendent parler du franc CFA ou des langues nationales, eh bien pour moi ils se roulent dans la fange. Notre propre refus de nous dresser contre la Françafrique est, bien plus que tout autre facteur, ce qui lui permet de perdurer. En ce sens, oui, nous sommes totalement responsables de nos malheurs et ne pouvons reprocher aux citoyens français de ne pas mener à notre place le combat contre la Françafrique. Je trouve sidérant que nos plus brillants esprits ne puissent pas comprendre une chose aussi simple. Mais il est vrai que Césaire voyait déjà en eux des ‘‘élites décérébrées’’
La domination française en Afrique francophone ne s’exerce donc pas seulement sur les plans politique et économique, elle continue d’opérer une forte pression idéologique et culturelle.
Le formatage, la ‘‘décérébration’’ si j’ose dire de ceux qu’elle a cooptés, est l’arme essentielle de la France, le secret de sa domination anachronique. Le projet francophone, habile à dévoyer les imaginaires, veut aussi élargir outre-mer l’adhésion au roman national hexagonal. Celui-ci a ses fidèles gardiens, pour ne pas dire ses chiens de garde – exactement au sens où l’entendait Nizan – voués à la protection de son leadership idéologique. Au fil des ans, la francophonie n’a même plus jugé utile d’avancer masqué et tout le monde voit bien aujourd’hui quels intérêts politiques et économiques elle sert. Elle en prend d’ailleurs à son aise avec les chiffres en évaluant à des centaines de millions le nombre de locuteurs du français en Afrique. Cela s’appelle prendre ses délires pour la réalité, surtout au moment où du fait de l’effondrement de nos systèmes éducatifs le recul de la langue de Molière n’a jamais été aussi manifeste. L’égyptien Boutros-Boutros Ghali aimait se moquer de ce coup de bluff en disant : « Je suis le Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie mais je suis peut-être bien le seul à encore parler français en Égypte ! »
La perte d’influence de la France en Afrique…
Je dis très souvent dans mes entretiens avec la presse sénégalaise que les intérêts économiques et financiers de la France n’ont jamais été mieux servis dans notre pays que sous l’actuel président Macky Sall. On a découvert de très importantes réserves de gaz et de pétrole au Sénégal et Manuel Valls est venu déclarer publiquement : nous nous intéressons de près à ces nouvelles ressources naturelles. Et vous y voyez partout des enseignes commerciales françaises. Mais justement, c’est bien parce qu’elle se sent en perte de vitesse sur les marchés dits émergents que la France se replie sur son pré carré. Et même chez nous ce retour a des airs de cérémonie des adieux, c’est le début de la fin parce que les Sénégalais, surtout les jeunes, supportent de moins en moins une aussi indécente visibilité. Bien sûr, c’est d’une amère ironie d’être là à se dire, près de 60 ans après les indépendances : ‘‘Courage, les gars, on va bientôt être indépendants !’’ C’est un fait, mais il n’en est pas moins vrai que certains signes ne trompent pas.
Des exemples…
Le débat sur le franc CFA ne manque pas d’intérêt à cet égard. Pourquoi est-il devenu un symbole de notre servitude politique ? Il a toujours été perçu ainsi, mais jusqu’à présent les économistes qui la critiquaient étaient soit inaudibles, soit liquidés par la Francafrique. Ce fut le cas du Camerounais Joseph Pouemi, auteur en 1980 de Monnaie, servitude, liberté : la répression monétaire de l’Afrique, empoisonné par les services français, comme avant lui son compatriote Félix Moumié. Trois autres économistes, Demba Moussa Dembele, Kako Nubupkpo, Bruno Tinel et le sociologe Martial Ze Belinga, ont publié récemment Sortir l’Afrique de la servitude monétaire. Les langues se sont déliées et le fait que cela arrive à ce moment précis ne doit rien au hasard. Tout comme du reste l’émoi suscité par le simple geste de Kemi Seba mettant le feu à un billet de CFA. En d’autres temps, cela aurait fait les titres pendant quelques heures mais là il a donné lieu à un flot ininterrompu de commentaires et d’articles. Ce n’était pas trop tôt après un demi-siècle de silence sur un sujet aussi vital. Toutefois, au-delà de la question monétaire, c’est un combat plus large pour la souveraineté politique, contre la Françafrique, que mènent les nouvelles générations. Aucun parti politique n’a osé s’exprimer sur le sujet : Paris tient bien la plupart de ces gens, qu’ils soient au pouvoir ou dans l’opposition. En revanche la mobilisation des jeunes sans affiliation politique est large puisqu’à un moment donné elle a eu lieu simultanément dans des dizaines de pays, y compris au sein de la diaspora. Certains parmi eux ont appelé, à Dakar par exemple, au boycott des produits français. Cela a été une déclaration en l’air, mais à mon avis c’est une piste à explorer. Une campagne de boycott, circonscrite dans le temps et bien ciblée, pourrait n’avoir, concrètement, qu’un succès relatif, mais il aura eu le mérite d’envoyer le message qu’il y a bel et bien un problème entre la France et ses anciennes colonies. L’impact économique sera sans doute nul: 1%, voire moins. Mais l’impact politique pourrait être gigantesque : 99%, voire plus. En fait on nous demande d’accepter de crever la gueule ouverte et c’est quand même bizarre que ça dérange si peu de monde. Le boycott des produits français partout oû il peut être organisé, à Dakar, à Cotonou ou Abidjan, à Bamako etc… sans xénophobie ni rien de similaire, serait vraiment le bienvenu. C’est le symbole qui compte et je pense qu’il faudra de plus en plus s’orienter, la tête froide, vers ces formes alternatives de lutte, d’une grande signification politique. Un autre petit signe des temps, c’est qu’il a suffi au Sénégal qu’une statue de Faidherbe s’effondre sous l’effet de pluies diluviennes pour que les appels à ne pas la réinstaller se multiplient. La statue a été rapidement remise en place mais il est clair que ces appels ont été entendus par qui de droit. Il est en outre devenu aujourd’hui difficile d’ouvrir un journal ou un site en ligne sénégalais sans y trouver une analyse très sévère de la politique africaine de la France. Sur un autre registre, la popularité croissante de Paul Kagamé parmi la jeunesse africaine tient autant aux performances du Rwanda qu’à sa volonté d’indépendance, ceci expliquant du reste cela. On est en vérité à la croisée des chemins et si Paris est dans le désarroi, c’est qu’il ne voit pas très bien ce qu’il peut faire. Attention, je ne suis pas en train de dire que la libération est pour demain, mais grâce à tous ces jeunes bien décidés à ne plus courber le dos, plus rien ne sera comme avant. Assez curieusement, les aînés étaient supposés avoir libéré l’Afrique de la colonisation française pour le bien de leurs enfants et petits-enfants. Eh bien, ceux-ci se voient obligés aujourd’hui de repartir à la recherche du temps perdu…
Les grandes figures africaines de libération politique ou culturelle ont-elles encore un héritage qui porte et parle à la jeunesse africaine aujourd’hui ?
Le rapport de la jeunesse à nos grandes figures intellectuelles et politiques de résistance en dit beaucoup sur l’évolution de l’imaginaire africain. Les noms de martyrs comme Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou Amilcar Cabral restent connus et souvent évoqués. Il en est de même de Ruben Um Nyobe, dont l’histoire ressort peu à peu. Tous ont donné leur vie pour la libération de l’Afrique et les pouvoirs coloniaux en ont fait leurs cibles d’une manière ou d’une autre. Il me semble pourtant qu’il reste du travail de mémoire à faire. Les images et les visages d’une certaine époque se dissipent peu à peu, il n’en reste souvent qu’un halo tremblotant. C’est une frange de la jeunesse très minoritaire – mais ardente – qui garde le regard fixé sur ces repères. Les autres tendent à les perdre de vue, au propre comme au figuré, sans doute parce que le combat de ces martyrs était associé à une idéologie marxiste-léniniste triomphante à l’époque, mais aujourd’hui passée de mode. Il y a aussi que la mémoire des nouvelles générations ne se hasarde jamais à escalader notre Mur de Berlin à nous, érigé en 1885, lors du partage de l’Afrique entre puissances européennes. Cet événement est à l’origine d’une fracture linguistique – sur la base des langues coloniales – dont les effets se font sentir aujourd’hui encore au quotidien. En d’autres termes, si je suis un jeune Sénégalais mes héros vont parler français et c’est bien pour cette raison que Cabral, naguère une référence au Sénégal, y est complètement oublié à l’heure actuelle. J’ai la chance d’être en contact quotidien depuis trois ans avec des étudiants nigérians et je vois très bien ce phénomène à l’œuvre, vous ne pouvez pas mentionner les noms de Lumumba ou Sankara sans les assortir de longues explications. S’il y a une exception, c’est Mandela en raison surtout de la dimension internationale de la lutte contre l’apartheid.
Pour le cas du Sénégal, et sur un autre registre, le duel qui oppose les deux figures d’autorité que sont Cheikh Anta Diop et Léopold Sédar Senghor en dit long sur le sujet…
Senghor était un grand poète et je continue à penser – à l’inverse de nombre de mes amis – que notre pays a eu de la chance de l’avoir eu comme premier président. Je respecte pour ses qualités humaines et intellectuelles un homme si peu obnubilé par le pouvoir qu’il y a renoncé de lui-même ; après l’avoir beaucoup dénigré à l’époque, nous savons aujourd’hui qu’il était aussi d’une intégrité personnelle au-dessus de tout soupçon. Nous n’osons même pas le comparer sur ce plan avec ses successeurs, avec les deux derniers en particulier. Mais tout en étant bien conscient des qualités de Senghor, je n’en pense pas moins qu’il a causé d’immenses torts au Sénégal. C’est déjà un problème que de conduire votre pays à l’indépendance en conservant secrètement la nationalité du colonisateur et de vous retrouver sur le tard, toute honte bue, dans cette assemblée de gens gâteux et vaniteux appelée Académie française. Senghor reste aimé par la France pour les services qu’il lui a rendus et non pour son travail littéraire ou sa production théorique. Paradoxalement c’est au Sénégal, où il jouit toujours d’un respect sincère, que l’on continue à le lire et à se référer, de moins en moins souvent il est vrai, à son œuvre poétique.
En comparaison, l’héritage intellectuel, mais aussi politique, de Cheikh Anta est plus vivant que jamais, non seulement au Sénégal, mais dans le reste de l’Afrique et jusque dans sa diaspora. Diop souffre comme tout le monde de la fracture linguistique postcoloniale, mais à un degré moindre. Comme le montre Kemtiyu, le documentaire que lui a consacré l’an dernier Ousmane William Mbaye, il est une référence majeure aux Antilles, aux USA et je sais que depuis qu’il l’a découvert, tel chef d’État anglophone ne peut plus faire un discours important sans se référer à Antériorité des civilisations africaines, devenu son livre de chevet. Et ses thèses sont de nos jours un cri de ralliement pour les jeunes du continent ou du moins pour sa frange la plus politisée. Je viens de préfacer le premier ouvrage de l’un des plus brillants d’entre eux, Khadim N’Diaye, qui vit à Montréal. Dans Conversations avec Cheikh Anta Diop, il interroge la réflexion complexe de Diop, en recueille toute la vitalité et montre en quoi son esprit peut servir, aujourd’hui encore et plus que jamais, le progrès de l’Afrique. Pour reprendre un titre de Jean-Marc Ela, Cheikh Anta Diop, cela a été avant tout ‘‘l’honneur de penser.’’
En France pourtant, comme vous le souligniez, il n’a pas du tout la même popularité ni – osons le terme – la même respectabilité que Senghor.
Permettez-moi de revenir sur un point rapidement évoqué tout à l’heure : reconnaissance ne veut pas dire connaissance. En France, Senghor bénéficie de la première au double sens du terme. Il est facile de se l’expliquer. Il a encore une fois été au service de l’ancienne puissance coloniale et de sa langue. Il l’a fait en toute sincérité, mais là n’est pas la question. Quant à Cheikh Anta Diop, il a été combattu dès le départ. Lorsqu’il soutient sa thèse, le jury écrit noir sur blanc dans son rapport, okay on le laisse passer mais soyons bien clairs, il ne sera jamais permis à ce nouveau Docteur-ès-Lettres d’enseigner en Afrique. C’est rappelé dans Kemtiyu. Vous rendez compte ? Ce sont des professeurs de la Sorbonne qui en décident ainsi ! Et sur cette base, Senghor qui pour le coup s’est montré bien mesquin, lui interdit, dans notre pays supposé indépendant, de transmettre son savoir à des étudiants sénégalais. Le malentendu entre Diop et l’université française est toutefois plus profond : celle-ci ne voyait pas seulement en lui ‘‘un intellectuel qui ne nous aime pas’’ – il n’en manquait pas à l’époque ! -, elle lui reprochait surtout d’oser soutenir que l’Afrique est le berceau de l’humanité et la mère de toutes les civilisations et que la brillante civilisation égyptienne était négro-africaine. S’il s’était contenté de dérisoires vitupérations anti-impérialistes, on se serait débarrassé de lui d’un haussement d’épaules amusé. Mais lui prétendait avoir raison et s’efforçait de le démontrer en restant sur le strict terrain de la science. Et on voit bien aujourd’hui qu’il ne disait pas n’importe quoi puisque personne n’ose désormais douter du fait que l’homme est né en Afrique. Cela donne de la consistance à tout le reste – antériorité des civilisations africaines, africanité de l’Égypte ancienne – mais on peut presque dire que le propos de Cheikh Anta Diop, la ligne directrice de sa pensée, se trouvait ailleurs. En fait, même s’il n’avait jamais écrit une seule ligne sur l’Égypte des Pharaons, l’œuvre de Cheikh Anta Diop n’aurait pas été moins importante. Sa vision panafricaniste et son travail sur les langues africaines auraient suffi à en faire un modèle. Si moi-même j’écris aujourd’hui en Wolof c’est parce que Diop est passé par là.
En France, Cheikh Anta Diop nous apparaît effectivement, dans la sphère militante décoloniale tout du moins, comme une immense et incontournable figure de la dignité africaine.
Absolument. Prié un jour de dire ce qu’il lui doit, l’égyptologue congolais Theophile Obenga, son disciple et ami, a répondu : ‘‘En vérité, je ne sais même plus ce que je ne dois pas à Cheikh Anta Diop.’’ Nous sommes très nombreux en Afrique et dans la diaspora à pouvoir reprendre ces mots à notre compte. De ce continent soumis à la loi de l’étranger, exploité, piétiné il n’a jamais cessé de révéler la force spirituelle et les richesses Et même dans l’utopie il savait rester pratique, appelant par exemple l’Afrique à ‘‘basculer sur la pente de son destin fédéral…» ne serait-ce, ajoutait-il, que ‘‘ par égoïsme lucide’’. À l’époque où il proposait une armée continentale, répétant à l’envi que ‘‘la sécurité précède le développement’’ personne ne semblait savoir ce qu’il voulait dire par là. Depuis quelques années, au gré des interventions extérieures en Afrique l’idée est souvent reprise, mais on peut se demander si les carottes ne sont pas déjà cuites. Il faisait remarquer dans la foulée que ‘‘l’intégration politique précède l’intégration économique’’. Tout cela montre bien que loin d’être un passéiste, il était tourné vers l’avenir. Il incitait les jeunes auxquels il a parlé sa vie durant à « la reprise de l’initiative historique’’, à ce qu’il appelait aussi ‘‘la reconquête de soi ». Ce projet reste aujourd’hui encore le nôtre et c’est ce qui me fait dire parfois que si Senghor a des admirateurs, Diop lui, a des disciples, des continuateurs. C’est qu’il a semé bien plus profond que son éternel rival.
Puisque vous parlez de la « reconquête de soi », je me permets d’embrayer un moment sur la reconfiguration de la sphère de l’antiracisme en France aujourd’hui. Car sur les cendres du vieil antiracisme moral ultra subventionné par l’État façon « S.O.S racisme » ou « Licra » , on voit émerger depuis une dizaine d’années différentes organisations telles que Le Parti des Indigènes de la République, la Brigade anti-négrophobie, la Voix des Rroms et le CCIF ; des organisations composées en majorité par des issus de l’immigration postcoloniale et qui luttent toutes contre ce qu’elles identifient à juste titre comme étant un racisme d’État, c’est-à-dire un racisme qui fait système, qui est adossé aux structures de pouvoirs, aux institutions, et qui maintient les non-Blancs dans un statut d’infériorité à différents niveaux. Certaines de ces organisations prônent donc aujourd’hui une autonomisation de la lutte indigène, ce qui leur vaut d’être régulièrement taxés par de nombreux médias et politiques de « racistes ». Comment, depuis l’Afrique, voyez-vous cette évolution des luttes de l’antiracisme menées par les descendants de l’immigration ?
J’y suis tout à fait favorable, c’est la marche de l’histoire qui indique la nécessité d’une force indigène autonome, dotée de son propre espace de réflexion et d’action. Dans le monde tel qu’il va, vous ne pouvez pas dire cela sans vous attirer les foudres des hypocrites. Leurs grognements sont sans intérêt. Que tous les humains de bonne volonté rêvent d’un même avenir, je le veux bien, mais l’avenir est avant tout lieu de convergence, on ne se bouscule pas sur le même étroit sentier pour y accéder. Et dans le cas précis de la lutte antiraciste en France, la mémoire et les émotions sont essentielles, ce sont elles qui assurent le lien avec un passé africain non pas mythique, mais riche de souffrances et de combats anticolonialistes. C’est du reste par ce biais que le public pourrait être amené à débattre de la politique africaine de son pays. Cela dit, la question de la légitimité d’une riposte autonome est moins nouvelle qu’on se l’imagine. En 56, Césaire décide de quitter le PCF et voici ce qu’il écrit dans sa fameuse Lettre à Maurice Thorez : «Un fait à mes yeux capital est celui-ci : que nous, hommes de couleur, en ce moment précis de l’évolution historique, avons, dans notre conscience, pris possession de tout le champ de notre singularité et que nous sommes prêts à assumer sur tous les plans et dans tous les domaines les responsabilités qui découlent de cette prise de conscience.» Césaire dit bien : « hommes de couleur » et je ne vois personne oser l’accuser de racisme. Il rappelle au passage à Thorez le vote infâme du PCF en faveur des pleins pouvoirs à Guy Mollet sur l’Algérie avant d’ajouter – ce qui a vraiment du sens par rapport à notre discussion de ce matin – que les communistes Antillais et toute la diaspora ont les yeux tournés vers l’Afrique parce que la lutte des peuples coloniaux est d’une tout autre nature, beaucoup plus complexe, que celle de l’ouvrier français contre le capitalisme. Peut-on être plus clair ? À mon avis, l’autonomie d’action des marginalisés est encore plus pressante à notre époque si tentée par la résignation et le cynisme.
Entretien (première partie) réalisé par Soliman, membre du PIR.