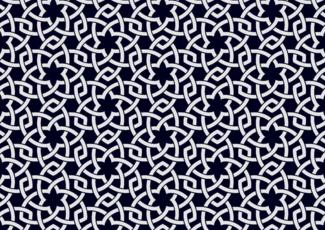Durant les trois dernières décennies, Wael Hallaq est apparu comme étant l’un des plus éminents spécialistes du droit islamique dans les universités. Il a apporté des contributions majeures non seulement à l’étude de la théorie et de la pratique du droit islamique, mais aussi à l’élaboration d’une méthode par laquelle les savants islamiques ont pu faire face aux défis auxquels la tradition juridique islamique est confrontée. Hallaq est donc idéalement placé pour aborder les questions globales touchant aux fondements moraux et intellectuels de projets modernes concurrents. Avec son travail le plus récent, The Impossible State (L’État Impossible), Hallaq met à jour les dynamiques de pouvoir et les processus politiques à l’origine de phénomènes souvent abordés sous le seul angle de la morale. Dans cette interview, la première d’une série en deux parties, Hallaq développe quelques-unes des implications de ces débats et les défis qu’ils posent pour l’avenir des engagements intellectuels à partir de diverses traditions. Il souligne en particulier l’échec des intellectuels occidentaux à s’engager auprès de chercheurs issus des sociétés islamiques, ainsi que les défis intellectuels et structurels auxquels sont confrontés les savants musulmans. Hallaq critique également le projet hégémonique sous-jacent au libéralisme occidental et l’adoption acritique de celui-ci par certains penseurs musulmans.
Hasan Azad (HA): L’un des débats qui fait rage aujourd’hui porte sur l’indifférence que les intellectuels musulmans rencontrent en Occident. On peut dire que, à quelques exceptions près, la présence musulmane moderne dans – ou la contribution à – l’univers intellectuel de l’Occident est proche de zéro. Dans les dernières pages de The Impossible State, vous mettez le doigt sur le fait qu’un engagement intellectuel solide entre les penseurs musulmans et leurs homologues occidentaux est essentiel, non seulement pour une meilleure compréhension occidentale de l’Islam, mais aussi pour l’élargissement du champ des possibles intellectuels dans le cadre de la pensée euro-américaine. Votre réflexion a, je crois, pour but de transmettre l’idée que la vision du monde et l’héritage islamique peuvent contribuer à enrichir nos réflexions sur le projet moderne, en Occident aussi bien qu’en Orient. Quelle est cette contribution, et pourquoi n’a-t-elle pas lieu? A quels obstacles fait elle face?
Wael Hallaq (WA): Parler de la contribution potentielle de l’Islam à une critique et à la restructuration du projet moderne est un défi de taille, qui doit venir à la suite d’un diagnostic de la condition moderne actuelle et de ses causes. Les obstacles dont vous avez parlé sont nombreux et à plusieurs niveaux, et proviennent des deux côtés de la barrière. S’il y a des obstacles, et ils sont nombreux en effet, ils ne peuvent pas être situés d’un seul côté. Le premier, et le plus évident, est bien sûr l’obstacle linguistique, le seul moyen de communiquer des idées. L’Occident (par lequel je désigne l’Europe, ses Lumières, ses institutions et sa culture typiquement modernes s’étendant à l’Amérique du Nord), considère ses deux ou trois langues principales si universelles qu’il ne prend pas la peine d’apprendre d’autres langues. Même l’Orientalisme, comme discipline universitaire, n’a pas réussi à produire une maitrise durable des langues islamiques1, malgré le fait qu’il a produit des individus dont la compétence linguistique dans plus d’une langue islamique était magistrale. Il n’en reste pas moins que ceux qui peuvent naviguer dans une langue ou un texte islamique sont une infime et insignifiante minorité dans les sociétés occidentales. Mais il y a un sens plus large à donner ici à l’Orientalisme. À bien des égards, le domaine de l’Orientalisme est entouré d’une couche externe, extrêmement vaste, consistant en d’innombrables voix influentes n’ayant jamais vraiment pris la peine de faire un solide travail intellectuel et philologique sur l’Islam. Et pourtant, ils se sentent tout à fait légitimes et confiants pour se prononcer sur l ‘«Orient», à la fois dans les salles de classe du monde universitaire ou en tant que soi-disant «experts» dans les médias. Cet orientalisme «périphérique» échappe à nos définitions habituelles de cette discipline, mais il constitue l’essentiel du savoir occidental commun et populaire sur le reste du monde, en particulier sur l’Islam. En tout cas, voici en quoi consiste à peu près l’obstacle linguistique.
HA: Diriez-vous qu’il s’agit d’un obstacle technique, relevant de la logistique, du dépassement des problématiques linguistiques-pédagogiques dans la transmission des idées?
WH: Cela peut commencer comme un problème technique bien sûr, mais en réalité, c’est beaucoup plus que cela. Accéder à une autre culture à travers le langage est un choix, que les puissances occidentales et leurs élites intellectuelles ont effectivement fait à un moment donné au service de leurs causes coloniales. A ce moment là, l’accès aux langues islamiques ne constituait pas une difficulté majeure, encore moins un problème technique. Le colonialisme a nécessité la production de l’orientalisme classique, car sans le premier, ce dernier n’aurait pas vu le jour dans la manière et la forme qu’il a finalement acquis et dans laquelle il continue à se développer. Dans la même veine, l’échec dans l’accès à une langue est fondamentalement une question de fond, pas strictement technique. Par exemple, ma décision d’écrire en anglais et non en indien ou en chinois, à imaginer que cela puisse relever de ma décision, est une question de fond complexe, liée directement à la relation entre le pouvoir et le savoir, entre mon expérience en tant que sujet colonisé et les faiseurs de cette histoire coloniale. Et rien n’est plus révélateur de la complexité de fond de la question de la langue que le professeur d’université occidental qui évoque l’ «Islam» sans ressentir le besoin de «le» comprendre par une fine étude textuelle, sociologique ou anthropologique de ce phénomène. Et tous ces efforts académiques, pour être véritablement engagés, exigent une maitrise décente de l’une ou l’autre des langues islamiques, voire de les parler et de les vivre. Le choix d’un professeur de ne pas s’encombrer de l’une de ces conditions (qui semblent être prises pour acquises dans presque n’importe quel autre contexte) est un problème lié à la constitution et à la structure du pouvoir, et non pas à une simple incapacité personnelle à maitriser une langue.
HA: Quel serait un autre obstacle majeur?
WH: Un autre obstacle très important à noter est que, à de rares exceptions près, les penseurs musulmans se basent sur des prémisses fondamentalement différentes de celles à partir desquelles les auteurs occidentaux partent, bien qu’ils imitent consciemment ou inconsciemment la pensée et l’écriture philosophique occidentale. Même les «utilitaristes» ou «quasi-utilitaristes» de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, tels que Muhammad Abduh et surtout Rashid Rida, pensaient dans un cadre adoptant comme point de départ deux choses: (a) un contexte religieux dont ils peuvent parler, et qui définit les limites, sinon les contours, de leurs récits, et (b) un contexte historique ou, plus précisément, un cadre historique de fond qui continue à être une source d’autorité pour légitimer les formes de la vie moderne. Et quand je dis ici «histoire» ou «historique», je veux dire un engagement historique assez prononcé qui convoque les nombreux siècles passés comme une source de connaissances et d’orientation, en essayant de constituer à partir de cette histoire, ou à travers elle, une interprétation se conformant à la vie dans le monde moderne (ce qui a évidemment entraîné des problèmes considérables que je pourrais j’espère aborder plus tard). Ou alors, on pourrait formuler cela autrement et dire que l’on ne peut trouver une manière d’aborder la modernité sans amener cette histoire et les textes religieux à assumer une signification particulière, très particulière, qui soit spécifiquement moderne.
Et ces deux engagements interconnectés, le religieux en particulier, se sont posés et continuent à se poser en violation d’un principe sacré dans le milieu intellectuel occidental moderne (et j’utilise le terme «sacré» à dessein). Pour être pris au sérieux dans ce milieu intellectuel qui est le nôtre aujourd’hui, vous ne pouvez pas adopter, comme prémisse fondatrice, une métaphysique traditionnelle, aussi intellectuellement sophistiquée soit-elle, quelle que soit la mesure dans laquelle elle approuve les doctrines et pratiques libérales (le cas échéant, cela implique des problèmes aggravés). Et même si vous le tentez (comme certains l’ont fait sans doute), votre argumentation n’aura pas d’audience à moins d’être sérieusement soumise aux conditions discursives d’un récit «laïque-rationaliste». Les défenseurs du droit naturel dans l’Occident contemporain sont un excellent exemple, mais ce groupe rencontre des obstacles relativement moins nombreux et moins importants que ses homologues musulmans. Deuxièmement, la conception de l’Histoire développée par les Lumières (dans laquelle nous continuons à vivre aujourd’hui), bien que profondément historique, nie paradoxalement certains aspects de l’Histoire. Par exemple, il y a une contradiction dans la théorie occidentale du Progrès lui-même, l’invocation d’un type particulier d’Histoire tout en se posant simultanément contre, quand ce n’est pas en la sapant, ce que nous appelons aujourd’hui l’histoire traditionnelle (que les Lumières et leur théorie du Progrès ont créé en premier lieu!). Donc, l’Histoire a toujours été une question problématique dans une modernité qui insiste sur l’adoption paradigmatique d’une théorie du Progrès. D’autre part, l’élite intellectuelle musulmane n’a commencé que récemment à identifier les significations profondes de cette vision du monde, ce qui, dans la façon particulière dont cela a été fait, n’est pas à mon avis une étape positive.
Le concept même de progrès est très problématique, et les intellectuels et historiens musulmans n’ont pas été en mesure jusqu’à présent de disséquer ses structures idéologiques internes. Et nous pouvons voir les effets de cet échec dans au moins un domaine important. Au cours des deux ou trois dernières décennies, une nouvelle tendance a émergé dans le monde musulman tendant à condamner l’histoire islamique comme «sombre et violente», en reproduisant presque exactement le récit européen de condamnation des abus de l’Église catholique et de l’absolutisme monarchique. La tendance (presque totalement ignorante de son propre héritage et de son histoire intellectuelle) a commencé à se manifester au début du XXème siècle, mais n’a gagné de l’élan que plus d’un demi-siècle plus tard. Comme beaucoup de valeurs et de doctrines libérales, avec lesquelles la théorie du progrès s’est coagulée, il a fallu un certain temps pour les intégrer dans ce qui est devenu un «discours indigène». Bien que les mondes historiques divers et multiformes de l’Islam et de l’Europe ne puissent être plus différents, «l’histoire islamique» commence peu à peu à ressembler aux âges sombres européens. En tant que récits d’oppression et de violence politique et «juridique», ils apparaissent, sans surprise, comme une identité proche. Peut-être vous expliquerai-je un peu plus tard comment cela se joue en ce qui concerne notre sujet de préoccupation.
Néanmoins, l’insistance sur les récits historiques et religieux comme constituant une tradition légitimée et légitimante reste la caractéristique fondamentale qui continue à séparer et opposer les penseurs des Lumières occidentales de leurs homologues musulmans (pour ne pas mentionner les difficultés épistémiques, politiques et idéologiques notoires auxquelles cette caractéristique a donné lieu). Les premiers déclarent la «raison» abstraite comme outil d’orientation par excellence pour l’humanité, tandis que les seconds, même les plus libéraux d’entre eux, invoquent ce récit historico-religieux à tout moment, même quand ils le condamnent. Il suffit de considérer les Muhammad Arkoun, Mohammed Abed al-Jabiri, Ali Harb, Hasan Hanafi, Muhammad Shahrur, même le chrétien George Tarabishi, et de nombreux autres des mondes iraniens, malais, et du sous-continent indien (eux et leurs pairs forment la majeure partie de la catégorie que je désigne comme intellectuels musulmans). En fin de compte, ils sont pour le moins incapables de faire sans le Quran. C’est à dire que ces écrivains ne peuvent jamais faire appel à une tradition séculière, radicalement non-scripturaliste telle que celle de la pensée dominante des Lumières occidentales.
HA: Il me semble, à en juger par certaines de vos conférences, que ce que vous dites à propos des fondements scripturaires n’est que le sommet de l’iceberg. Pourriez-vous vous attarder un peu plus sur ce thème?
WH: Bien sûr. Je tiens également à noter que la manière discursive dans laquelle les penseurs musulmans modernes se sont articulés et continuent à s’articuler n’est pas susceptible d’attirer l’attention et donc l’engagement, que ce soit des universités occidentales ou de la pensée occidentale dans son ensemble. Laissez-moi vous expliquer pourquoi. Grossièrement (très grossièrement) parlant, il y a deux camps ou tendances au sein de la pensée islamique et islamiste moderne (pour mes besoins spécifiques ici, «islamique» et «islamiste» ne sont pas très distinguables les uns des autres). L’une désigne une grande majorité qui a été trop longtemps à la poursuite d’un projet voué à l’échec, tant à l’interne qu’à l’externe; à savoir, l’entreprise de rationalisation de l’Islam (dans presque tous ses aspects) dans les termes de la philosophie libérale et des catégories de la pensée libérale. Une compréhension profonde de ce projet révèle les principales raisons de son échec inéluctable, mais ce n’est pas ma préoccupation aujourd’hui. Au lieu de cela, je tiens à souligner qu’en tant que système de pensée et de pratique, le libéralisme n’a pas encore été réapproprié par les grands intellectuels du monde musulman, à de rares exceptions près.
Cet échec dans la compréhension est en fait double: les intellectuels musulmans n’ont pas encore réussi à comprendre et à évaluer la critique acerbe, et parfois radicale, du libéralisme au sein de la tradition euro-américaine elle-même, libérale ou pas (Et ici comme ailleurs, «euro-américaine» comprend l’Australie, entre autres lieux, au vu de leurs contributions importantes à cet égard). L’autre tendance ou camp dans la pensée islamique moderne est réduite et émerge lentement, mais heureusement régulièrement et sûrement. C’est l’école islamique critique menée par le philosophe et logicien marocain Taha Abdurrahman, qui n’a pas succombé aux modes de pensée des Lumières2. Son approche critique constructive annonce un commencement innovant et prometteur à partir duquel une nouvelle voie de la pensée et une re-articulation peuvent commencer. Maintenant, je voudrais souligner ceci: aucun des deux camps n’est susceptible à court terme d’attirer l’attention des penseurs occidentaux en partie parce que les «libéraux musulmans» (qui sont l’écrasante majorité) seraient jugés par leurs homologues occidentaux comme des intellectuels de seconde, sinon de troisième main, comme des sortes d’imitateurs. Il n’y a rien dans la pensée et la pratique de ces libéraux musulmans qui n’ait de la valeur dans le vif débat sur le libéralisme faisant rage en Occident (aussi problématique et autocentré qu’il puisse être). Quoi qu’il arrive, leur position collective représente en fait une approbation des revendications et des valeurs libérales, ce qui a pour effet inévitable de renforcer, d’une part, ces revendications et de les rendre résilientes face à la critique et, d’autre part, de conférer une justification aux États libéraux pour qu’ils continuent à attaquer les pays islamiques sans remords. En outre, le sort de ces imitateurs ressemblera inévitablement au dédain avec lequel les mujtahids3 et aspirants-mujtahids musulmans pré-modernes considéraient les muqallids4. Et en cela, personne ne devrait blâmer les penseurs occidentaux. En tant que question de pratique juridique et morale, le taqlid peut avoir été utile, sinon nécessaire, mais dans le domaine de la pensée et de l’analyse critique, il ne peut jamais gagner aucun respect. Un muqallid est simplement quelqu’un qui n’a rien à dire, quoi qu’il ou elle puisse babiller. Et le sort du deuxième camp ne sera pas meilleur, au moins au court et prévisible terme. Cependant, je parie beaucoup sur l’attrait de ce camp sur le long terme, parce que je le vois comme l’expression d’un changement prometteur. Je trouve que les oppositions entre la voie générale des intelligentsia occidentales et des approches telles que celles de Abdurrahman sont trop grandes (bien que dans le cas de ce philosophe, il est significatif qu’il soit arrivé à son système de pensée après avoir assimilé beaucoup de la tradition philosophique européenne). Ainsi, même si la pensée occidentale dominante était amenée à constater ou à accéder à des œuvres du philosophe marocain et de ses pairs, je ne suis pas sûr qu’elle saura quoi en faire. Barrières linguistiques ou pas, les défis que ce camp soulève sont énormes à tous égards. Peut-être seront ils relégués à l’étagère des curiosités «orientales», comme on l’a fait avec tant de phénomènes islamiques. Le profond défi moral posé par Abdurrahman est tout simplement inassimililable pour le grand public occidental actuel.
HA: Cela ressemble à une impasse. Comment en sortir?
WH: Jusqu’à présent, cela a été une impasse, mais seulement dans le sens où les deux camps ne se sont pas encore rencontrés. L’engagement n’a pas encore eu lieu, quand ce sera le cas nous verrons s’il y a une véritable impasse. Mais pour l’instant, pas même un début d’échange n’a eu lieu. Je ne vois pas un Michael Sandel, un Alasdair MacIntyre, un Charles Taylor, ou toute personne de leurs calibres ou tendances dialoguer avec, par exemple, Taha Abdurrahman ou n’importe qui d’autre d’ailleurs. Très probablement, ces philosophes n’ont jamais entendu parler de lui, et franchement, je doute même que les pairs de Taylor émergent de leurs mondes et intérêts intellectuels immédiats pour engager un tel effort. Et si un tel groupe de philosophes n’est pas susceptible de s’engager dans un dialogue, alors il y a peu d’espoir que d’autres viennent s’y joindre. Dans « L’État Impossible », j’ai essayé de dégager certaines des questions auxquelles le monde musulman fait face d’une manière qui est, j’espère, compréhensible pour l’intellectuel occidental. Et j’ai appelé également, à la fin du livre, les intellectuels musulmans à essayer de faire au moins un pas en avant dans la formulation de leurs questions d’une manière qu’un public occidental, ou d’intellectuels occidentaux, puisse identifier. Mais cela n’est certainement pas suffisant en soi. Comme je l’ai dit plus tôt, il doit y avoir un corps qualitativement différent et critique de la pensée, d’un poids suffisant pour être entendu des intellectuels occidentaux. Le défi est prodigieux. Nous, académiciens et intellectuels, faisons tout notre possible pour anoblir l’image du Savoir comme quête sublime, mais c’est l’un des plus grands mythes modernes dans lequel nous vivons. Je comprends et accepte la véracité de cette image dans un contexte où la connaissance a été poursuivi à des fins morales, c’est-à dire l’éthique pratique, la façon, par exemple, dont les éthiques ghazaliennes5 ou aquiniennes6 ont été construites et interprétées dans leur propre environnement. Mais les transformations dans le monde moderne, et la complicité sans précédent entre savoir et pouvoir (qui s’avère finalement correspondre à la conception schmittienne du pouvoir7) en font ce mythe que je vois. Si la politique est la guerre par d’autres moyens, et c’est sans doute le cas, le savoir, y compris académique, est également la politique par d’autres moyens. L’apparition de la forme du savoir en tant que domaine de professeurs doux et de vieux chercheurs barbus, avec des étudiants passionnés poursuivant une «quête de savoir», ne doit jamais masquer ou modifier cette réalité crue. En fait, c’est l’une des plus grandes déceptions modernes. Les intellectuels musulmans et un nombre infini d’autres ont encore à saisir la puissance de cette écrasante métaphore.
Traduit de l’anglais par Azzedine Benabdellah, membre du PIR
Knowledge as Politics by Other Means: An Interview with Wael Hallaq (Part One)
Notes
1 L’auteur désigne par ce terme les langues dont le développement s’est opéré dans le cadre des cultures islamiques, comme l’arabe, le persan ou le turc.
2 Le Dr. Taha Abdurrahman est un philosophe islamique marocain. Logicien et philologue, il été amené à travers plusieurs travaux sur la philosophie du langage, les philosophies occidentales et islamiques à explorer les conditions de possibilités de différentes formes d’éthiques, et de modernité. Il préside le « Cercle de sagesse pour les penseurs et chercheurs » à Rabat, Maroc. Voir notamment son texte : « L’esprit de modernité et le droit à la créativité ».
3 Mujtahid : Savant juriste ayant la compétence de jugement (ray) et d’analogie (qyas) lui permettant d’exercer l’ ijtihad dans l’interprétation et l’application du Quran à des situations non explicitement encadrées par lui.
4 Muqallid : Juriste qui, a la différence du Mujtahid pratiquant l’ijtihad, exerce le taqlid consistant à reproduire les décisions juridiques antérieures, même dans un contexte inédit. Il est en cela considéré comme un « imitateur ».
5 Al-Ghazâlî (450-504 AH / 1058-1111 ap. JC) est un savant musulman ayant notamment intégré puis critiqué les thèses philosophiques de Al-Farâbî et Ibn Sīnā (Avicenne). Il tentera de développer une éthique du « juste » milieu entre poursuite de la connaissance et obéissance à la Révélation, notamment dans son oeuvre « Revivification des sciences du Din » (Ihyā’ulūm al-dīn)
6 Désigne l’éthique de Thomas d’Aquin (1224-1274 ap. JC), théologien dominicain et philosophe marqué par l’aristotélisme, qui développera une éthique tentant d’articuler la raison et la foi.
7 Carl Schmitt est un intellectuel catholique et juriste allemand, considéré comme le fondateur de la théorie du droit du régime nazi.