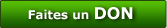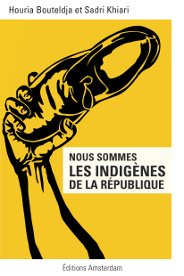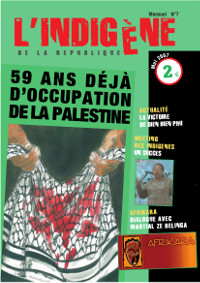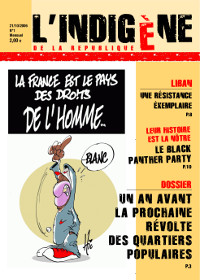Le 18 mars, les avions de guerre israéliens ont repris leur féroce bombardement de Gaza, tuant plus de 800 Palestiniens en quelques jours. Après neuf jours de reprise de l’offensive contre Gaza, des manifestants de Beit Lahia sont descendus dans la rue. Brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Non au génocide », certains ont également blâmé les factions armées palestiniennes, en particulier le Hamas. Dans les médias israéliens, ces images ont été immédiatement reprises et réutilisées : elles seraient la preuve que la campagne d’Israël fonctionne, créant un fossé entre la population et la résistance. Cette image de la protestation palestinienne – fragmentée, désespérée et ambiguë – est devenue centrale dans la stratégie de guerre d’Israël. Elle soutient un double récit, où l’assaut militaire est nécessaire et où les Palestiniens eux-mêmes en viennent à dire que la violence qui s’abat sur eux est de leur propre fait. La guerre à Gaza n’est plus seulement une campagne de destruction ; c’est une opération psychologique, visant à produire l’image de la défaite, des Palestiniens revendiquant la responsabilité de leur propre mort.
Cette image remplit également une autre fonction : elle légitime la consolidation interne du pouvoir en Israël. Les gros titres y parlent maintenant d’un gouvernement qui se reconfigure, poursuivant une double stratégie – le réaménagement de son architecture institutionnelle et la poursuite de sa guerre perpétuelle. Ces objectifs ne sont pas distincts ; chacun soutient l’autre. La campagne génocidaire à Gaza n’est pas un simple exercice militaire – elle offre la possibilité d’un nettoyage ethnique et de renforcer la volatilité de l’environnement régional, en ouvrant l’espace pour une confrontation avec l’Iran. En interne, le projet de la droite israélienne – marqué par des réformes du système judiciaire et de la citoyenneté – repose sur le maintien de l’état d’urgence. La guerre, à son tour, est rationalisée par le besoin de cohésion nationale, le récit d’une unité forgée sous le siège, et les signes d’une capitulation palestinienne ne font que servir ce récit plus large. Ensemble, ces dynamiques forment une boucle où elles se renforcent mutuellement.
Aujourd’hui, voici les gros titres en Israël : le limogeage du chef du Shin Bet Ronen Bar (pas encore en vigueur), le licenciement du procureur général de l’État (pas encore en vigueur) et l’adoption d’un projet de loi de réforme judiciaire qui entrera en application lors de la prochaine session de la Knesset. Tout cela se produit alors qu’Israël est censé être engagé dans une guerre d’expansion en Syrie et au Liban, une guerre visant à enterrer définitivement la question palestinienne, une guerre visant à s’affirmer comme le seul hégémon au Moyen-Orient. Un coup d’État à l’intérieur et une guerre sans fin.
Et pourtant, même ces manifestations – aussi fragiles et fracturées soient-elles – ne rétablissent pas la figure de l’innocence dans l’imaginaire israélien. Les manifestants de Beit Lahia qui appellent à la fin de la guerre, qui dénoncent le génocide palestinien et le Hamas, ne sont pas perçus comme des voix innocentes, comme des personnes aspirant à vivre sans la menace de la mort. Leur apparition n’interrompt pas le récit de la culpabilité collective palestinienne qu’Israël a soigneusement entretenu pendant cette guerre ; au contraire, elle le recode. Dans le discours israélien, ils sont présentés non pas comme des victimes mais comme des collaborateurs potentiels – des Palestiniens prêts à trahir les leurs, à avouer l’erreur de la résistance, à s’agenouiller devant le pouvoir. Le spectacle de la capitulation devient la preuve finale de la culpabilité : non pas la culpabilité d’avoir combattu, mais la culpabilité d’avoir toujours refusé de se soumettre. De cette façon, même la dissidence est instrumentalisée. Elle n’interrompt pas la guerre, elle en réaffirme la logique. Elle rend la violence non seulement justifiée mais nécessaire, confirmant que la reddition est possible, que la fragmentation est réelle et que la domination peut encore être perfectionnée.
La dissidence palestinienne
Depuis le déclenchement de la violence armée entre factions à Gaza en 2007, la société palestinienne – tant à Gaza qu’en Cisjordanie – a subi une profonde division interne, entretenue par la présence de deux factions politiques concurrentes, chacune ayant une position distincte sur la condition coloniale. La première, dirigée par Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne, prône la coopération, la collaboration et l’accommodement – une stratégie fondée sur la négociation, la construction de l’État et la coopération en matière de sécurité. La seconde, incarnée par le Hamas et d’autres factions de la résistance, insiste sur la confrontation, la résistance et la défiance, considérant la situation coloniale comme une lutte existentielle. Ce schisme n’est pas simplement institutionnel ; il a pénétré le tissu même de la vie politique palestinienne, structurant les affects, les discours et les conditions dans lesquelles la dissidence, la survie et l’espoir sont négociés.
Ce schisme a joué un rôle important dans le discours politique palestinien au lendemain de Tufan al-Aqsa, en polarisant progressivement le débat intellectuel et public autour de trois oppositions binaires interdépendantes : victoire ou défaite, responsabilité ou abandon, résistance ou survie. Ce discours n’était cependant pas entièrement interne. Il a également été façonné – sinon activement conçu – par une guerre d’information et une guerre psychologique soutenues, notamment par le biais de médias arabes (financés par les pays du Golfe) qui cherchaient à attribuer la responsabilité de la campagne génocidaire d’Israël à la résistance elle-même. Dans ces récits, la « défaite » n’est pas simplement un résultat mais une condition permanente – un horizon politique dans lequel les Palestiniens étaient censés s’installer, désarmés, désillusionnés et disciplinés.
Dans ce domaine, les voix de l’opposition organisée à Gaza peuvent être regroupées en trois grandes catégories sociales et politiques. Premièrement, les structures familiales traditionnelles – des clans puissants – qui considéraient la guerre comme une opportunité d’affirmer leur contrôle interne, de rétablir leur domination et de tirer un profit financier des aides et des efforts de reconstruction à venir. Deuxièmement, la grande base sociale des loyalistes du Fatah, en particulier ceux alignés sur Mahmoud Abbas ou Mohammad Dahlan, qui ont cherché à exploiter la situation pour affaiblir le Hamas en diffusant des éléments de langage et des récits qui imputaient les destructions à la résistance. Leur objectif était d’affaiblir politiquement le Hamas tout en se positionnant pour une éventuelle gouvernance dans un scénario d’après-guerre. La troisième était le désir désespéré, partagé par de nombreux Palestiniens ordinaires, de voir le génocide prendre fin, de voir la violence cesser, de voir quelque chose, n’importe quoi, qui puisse freiner la monstrueuse machine israélienne.
Le désir de voir la guerre se terminer, immédiatement, est devenu la marque de ce qui a été, à bien des égards, une campagne psychologique largement efficace où l’opposition organisée du Fatah s’est associée volontairement ou involontairement à la guerre de l’information et à la guerre psychologique israéliennes. Le discours d’auto-flagellation qui fait peser le poids de la responsabilité de la situation sur les épaules de la résistance est au coeur de cette campagne. Ainsi, le génocide n’est plus perçu comme un crime commis par son auteur, mais comme la conséquence de l’insoumission palestinienne. On demande aux Palestiniens de se sentir coupables d’avoir osé résister à leur assujettissement.
Mais au-delà de la construction discursive, l’efficacité de cette campagne découle également des enjeux de la situation présente – de la position insupportable d’être tenu en joue et sommé d’endurer. Telle a été la condition de Gaza : un lieu où la survie est toujours négociée, où les mots peuvent entrainer la mort, et où les discours de renoncement ne sont ni nouveaux, ni toujours volontaires. Ils sont produits sous le siège, sous les bombardements et sous la longue ombre d’un colonisateur qui exige la soumission ou la mort.
Le bombardement incessant de Gaza et la démolition à grande échelle de ses infrastructures ont produit une réalité radicalement transformée. Cette nouvelle réalité a eu deux effets. Elle a entraîné d’abord un affaiblissement sévère des structures de gouvernance et de la capacité des autorités palestiniennes à assurer les services essentiels ou à administrer la société – en particulier dans les domaines de la prévention de la criminalité et des règlements de compte personnels.
Elle a créé également un sentiment de vide politique et administratif, encore exacerbé par les assassinats ciblés par Israël de responsables gouvernementaux après sa rupture de l’accord de cessez-le-feu. L’érosion de la présence institutionnelle, à la fois physique et symbolique, a non seulement laissé derrière elle une crise des services publics, mais surtout une rupture dans l’idée même d’ordre – un environnement où l’autorité devient de plus en plus précaire et dans lequel des formes alternatives de contrôle et de pouvoir informel commencent à s’affirmer.
Gaza devient un terrain où des forces hostiles au Hamas ou à la résistance de manière plus générale tentent d’acheter de nouvelles loyautés politiques. Cela est dû en partie à l’épuisement des ressources financières et à la destruction des moyens de subsistance de la population. Mais ce qui est peut-être plus central, c’est le fait que Gaza n’est plus la Gaza qu’elle était avant la guerre, en raison des changements démographiques et spatiaux que cette dernière a entraîné.
La situation financière de la population, les déplacements et la réalité spatiale elle-même font que la politique locale à Gaza ne peut plus être interprétée sous les mêmes angles qu’auparavant. La guerre n’a pas seulement déplacé les gens physiquement, mais elle a également désorienté les tissus sociaux et les solidarités de quartier qui sous-tendaient autrefois la vie politique. Les zones autrefois identifiables par leurs orientations politiques – qu’elles soit le Hamas, le Fatah ou d’autres formations – sont maintenant dispersées, leurs populations fragmentées et déplacées, parfois à plusieurs reprises. Des familles de Beit Hanoun sont maintenant à Rafah, celles de Shuja’iyya sont dans des écoles transformées en abris à Deir al-Balah. Dans de telles conditions, l’idée même d’une « base locale » fixe perd toute cohérence.
Les affiliations politiques sont mises à rude épreuve par les urgences de la survie, et les logiques de représentation sont fracturées par l’effondrement de l’espace lui-même. On ne peut pas parler de politique locale au passé, mais seulement dans un temps de suspension – de communautés en transit, forcées de reconstituer des positions politiques sous le siège, le chagrin et l’épuisement. Ce qui en ressort n’est pas seulement une crise de la gouvernance ou de la résistance, mais une crise du politique lui-même. Il n’est pas de bon augure d’entendre des analystes dire que des localités comme Beit Lahia, où certaines de ces petites manifestations ont eu lieu, étaient autrefois des bastions du Fatah ou du Hamas.
Cependant, ce qui reste rien de moins que miraculeux, c’est qu’après dix-sept mois de guerre, la société palestinienne continue de faire preuve de profondes solidarités internes. En dépit de l’ampleur inimaginable des destructions, de la fragmentation de l’espace et de l’érosion de la gouvernance institutionnelle, les gens trouvent encore des moyens de partager, de faire circuler les ressources, d’être ensemble en commun. L’idée de communauté n’a pas disparu ; elle persiste, obstinément, même si les pressions de la guerre poussent de plus en plus les individus à rechercher leur propre salut ou celui de leurs familles. Dans un contexte de fragmentation, de dépossession et de violence constante, l’existence continue de la vie communautaire n’est pas simplement un résidu du passé – c’est une forme active de résistance, un refus de permettre à la guerre d’atomiser complètement le tissu social.
Le désir de certitude
La guerre est souvent décrite comme un tourbillon – un effondrement du passé, du présent et du futur en un seul moment indistinct. Elle suspend la chronologie, fragmente la cohérence et impose la désorientation, le désordre et l’incertitude. Dans la guerre, le temps cesse de se dérouler ; il implose. Le sens devient erratique, et les structures qui ancraient autrefois la vie – le rituel, la routine, la mémoire, l’anticipation – sont consumées dans l’immédiateté de la survie. Pour de nombreux Palestiniens, la certitude, même si c’est la certitude de la défaite ou de la reddition, est désirable.
Ces manifestations traduisent un désir de certitude – d’ordre, de cohérence, de tout ce qui pourrait stabiliser un monde qui sombre dans l’ambiguïté, en particulier l’insupportable incertitude de savoir si l’on va vivre ou mourir, si les amis et les proches vont passer la nuit. Il ne s’agit pas uniquement d’actes politiques, mais de suppliques existentielles : des tentatives de réaffirmer la lisibilité face au chaos, de s’accrocher à des fragments de sens lorsque le sens lui-même est assiégé. Et ce sont aussi les démonstrations d’une capacité d’agir – l’affirmation d’une forme de contrôle, même lorsque ce contrôle renforce malgré lui la machinerie même du massacre qu’on cherche à arrêter.
C’est aussi la tragédie de la vie au sein de cette réalité monstrueuse. Une vie dans laquelle l’Autre est omniprésent, hantant chaque souffle comme un ange de la mort – et pourtant, le seul visage vers lequel vous pouvez crier, objecter ou plaider est le visage qui reflète le vôtre, marqué par la même langue, les mêmes traits. La machine d’extermination a toujours prospéré sur de tels arrangements : elle fabrique les conditions de la nécrose, du fratricide, de la culpabilisation. Elle le fait en étant partout, tout en restant aussi hors d’atteinte, à la fois présente et absente. Elle rend la victime complice non pas dans les actes mais dans le désespoir, pliant la résistance dans l’auto-flagellation, et le chagrin dans l’auto-reproche. Et pourtant, ces cris, même de reddition, resteront tragiquement inaudibles, ou au pire, ne feront qu’alimenter davantage la machine de guerre.
Abdaljawad Omar
Abdaljawad Omar est un chercheur et théoricien palestinien dont le travail se concentre sur la politique de la résistance, la décolonisation et la lutte palestinienne. Article original publié en anglais sur Mondoweiss.