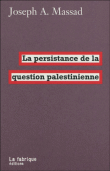En effet, Joseph Massad – qui enseigne les sciences politiques à l’Université de Columbia – déploie dans le premier article une thèse puissante, à contre-courant des idées reçues: la question palestinienne et la question juive sont une seule même question. Le sionisme apparait alors comme un antisémitisme qui, au lieu d’altériser les Juifs, a pris les Arabes pour cible. La résolution sioniste de l’antisémitisme européen dans la création de l’Etat d’Israël s’est donc opérée selon un déplacement du “sémitisme” – invention européenne du XIXème siècle dont Massad démonte rigoureusement les présupposés (racistes).
Le second article, qui s’intitule “Oublier le sémitisme”, montre plus particulièrement comment l’usage de la catégorie “abrahamique” au coeur des philosophies d’Emmanuel Levinas et de Jacques Derrida, autorise l’un à élaborer une éthique anti-palestinienne et l’autre à nier la violence du colonialisme israëlien – alors même que cette notion devait idéalement réconcilier les Gens du Livre.
Comment a pu s’opérer un tel transfert? Comment les victimes juives de l’antisémitisme européen ont-elle pu ainsi impunément recycler l’idéologie de leurs bourreaux – ces principes nationalistes européens qui allaient précisément permettre aux sionistes d’inventer Israël comme une nation possédant sa propre terre? S’il développe les raisons politiques d’un tel renversement, Massad passe trop vite sur ce point pourtant central de la transmission d’une haine de soi culturelle aux colonisés:
“Instruit par la Renaissance et les Lumières, le colonialisme européen allait transmettre à tous ses colonisés une semblable haine de soi culturelle, les invitant à prendre pour modèle la culture européenne éclairée.”
Sans doute le format du texte – un article publié dans une revue – ne permet-il pas de creuser cette piste, et de l’élargir à d’autres histoires coloniales.
Il n’en demeure pas moins que l’exposé de Massad est précis et rigoureux. Les thèses qu’il déploie sont systématiquement justifiées, illustrées par des sources elles-mêmes israëliennes. Ainsi, lorsqu’il avance que les sionistes ont épousé la vision antisémite des Juifs, il cite directement Theodor Herzl qui écrit dans son journal que les Juifs français ont “de gros nez difformes, des regards rusés et fuyants”. Cette description qui insulte les Juifs en tant que Juifs – et fait injure à l’humanité entière par ricochet – montre comment les sionistes ont voulu européaniser les Juifs, autrement dit les “civiliser”.
Dans Peaux noires masques blancs, Frantz Fanon cherche lui aussi à élucider cette haine envers les Juifs, identique à celle envers les Noirs ou envers les Arabes – ou envers une quelconque catégorie d’humains désignés comme “inférieurs”. Il montre qu’elle procède en fait d’un même mécanisme, où le dominant altérise les populations qu’il offre généreusement de hisser vers la civilisation.
Les sionistes prétendaient ainsi faire fleurir un “désert” – la terre déjà cultivée des Palestiniens désertifiée au préalable pour justifier leur entreprise d’expropriation. Cela n’est pas sans évoquer une nouvelle terrible du palestinien Ghassan Kanafani où il raconte l’histoire d’une fillette que son oncle aime à la folie. En voyage à l’étranger, l’oncle retrouve enfin l’enfant bien-aimée dans son village natal en Palestine. Celle-ci a été hospitalisée, à cause de la guerre. Il lui a acheté un présent: un très beau pantalon rouge. Au moment où il montre son cadeau, l’enfant soulève tristement sa couverture et dévoile à son oncle que ses jambes ont été amputées. Cette fillette amputée de ses jambes peut sans doute être perçue comme une métaphore de la Palestine amputée de ses terres. Kanafani ne nous raconte pas si un soldat de l’armée d’occupation a offert le pantalon à sa propre fille…
“L’image même du Juif comme vecteur de la civilisation européenne des Gentils dans une géographie barbare est constitutive de l’argumentaire politique sioniste. C’est dans ces termes que Haïm Weizmann formula le projet en 1930: ‘ (nous) souhaitons épargner aux Arabes autant que possibles les souffrances que subit toute race arriérée à l’arrivée d’une autre nation plus avancée.‘”
Massad énonce les fondements honteux de l’Etat colonial d’Israël, notamment en démontant ce qu’il appelle “l’opération palimpsestique” des sionistes, celle qui a consisté à renommer chaque lieu, à s’implanter sur les traces des vies et des mémoires palestiniennes. L’historien Tom Segev décrit ainsi le processus:
“Des hommes libres, les Arabes, partirent en exil comme de misérables réfugiés, les Juifs, s’emparèrent des maisons des exilés pour commencer leur nouvelle vie d’hommes libres.”
Chiasme douloureux de l’antisémitisme où les uns se réapproprient sans vergogne le patrimoine des autres. Récemment, un record a été enregistré qui a suscité parmi la blogosphère arabe des moqueries trop faciles: les Libanais ont produit le plat de hoummous le plus important du monde, détrônant ainsi Israël. Cette entreprise a effectivement quelquechose d’un peu ridicule et vain, elle peut prêter à sourire. Mais en même temps, c’est une petite victoire au niveau des représentations – pas tout à fait vaine, ni tout à fait grotesque, sauf peut-être pour ceux qui, n’aimant pas le hoummous, ont été écoeurés à la vue de cet énorme plat!
Comme l’écrit Massad:
Le sionisme “s’est approprié comme plats nationaux les traditions culinaires palestiniennes et pansyriennes, comme le hoummous, le falafel, le tabbouleh, le maftoul (plus connu aux Etats-Unis et en Europe sous l’appellation de ‘couscous israëlien’) et la salade villageoise palestinienne faite de légumes finement émincés (aujourd’hui appelée ‘salade israëlienne’ dans les ‘délis’ de New York).”
Le Guiness des records – tout profondément débile soit-il – participe aussi, comme tout le reste, de la politique. L’appropriation des terres, du patrimoine culturel et gastronomique ne seraient pas si efficace sans une appropriation de l’histoire. Car bien que les Palestiniens soient devenus, en quelque sorte, les Juifs des Juifs, ils n’en sont pas moins exclus de l’histoire hébraïque:
“L’appropriation sioniste de l’histoire des Hébreux palestiniens comme ancêtres des Juifs d’Europe devenus antisémites prive en réalité les Arabes palestiniens de toute connexion avec leurs antécédents hébraïques. Alors que les voisins égyptiens, jordaniens, libanais et irakiens disposent d’une histoire nationale remontant aux pharaons, aux Nabatéens, aux Phéniciens et aux Babyloniens, les Palestiniens ne peuvent rien revendiquer du passé de la Palestine. Récemment convertis à une judaïcité sans terre, ils ne peuvent accéder au passé d’une terre colonisée par des Juifs hébraïques antisémites, pas plus qu’ils ne peuvent revendiquer des ancêtres dont le sionisme a fait les ascendants exclusifs des Juifs. Cela n’est pas sans rappeler le processus par lequel les prophètes hébreux avaient été détournés par le christianisme.”
En conclusion de ce premier article, Joseph Massad énonce les exigences pratiques qui découlent de son analyse théorique. Selon lui, la résistance palestinienne doit exiger “la déseuropéanisation du Juif.” En ce sens, Joseph Massad semble assez proche d’Ella Shohat qui explique dans Le sionisme du point de vue de ses victimes juives (La Fabrique, 2006) que l’Etat colonial d’Israël repose sur un mythe orientaliste selon lequel le Moyen-Orient était “pré-moderne”. L’expression récurrente “Israël, seule démocratie du Moyen-Orient” participe de cette même mythologie eurocentrée qui représente les Arabes comme des brutes à civiliser.
Le deuxième article de Joseph Massad recadre en quelque sorte les thèses générales du premier dans le contexte particulier de l’histoire des idées – il les éprouve en les frottant au débat intellectuel. On peut mettre ce texte en perspective avec un autre article – celui d’Edward Said paru dans le Monde Diplomatique(septembre 2000), intitulé “Ma rencontre avec Jean-Paul Sartre”. Dans le papier très intéressant du Diplo, Said raconte comment le pape de l’existentialisme a éludé la question palestienne, comment il a – dans les termes de Massad – “oublié le sémitisme”. Le récit savoureux du séjour parisien d’Edward Said déboulonne au passage le mythe des intellectuels français, en voici un extrait:
“A mon arrivée, je trouvai à mon modeste hôtel du quartier latin un mot bref et mystérieux : « Pour des raisons de sécurité, disait le message, les réunions auront lieu chez Michel Foucault. » Dûment pourvu de l’adresse, je me rendis le lendemain matin au domicile de Foucault et je trouvai le vaste appartement déjà tout grouillant de monde – mais Sartre lui-même n’était pas là. Il n’y eut personne pour expliquer les mystérieuses « raisons de sécurité » qui avaient entraîné le changement d’adresse, même si, de ce fait, c’est dans un climat de conspiration dénué de toute nécessité que se déroulèrent nos discussions. Simone de Beauvoir était déjà là, avec son fameux turban, donnant à qui voulait l’entendre une conférence sur le séjour qu’elle allait faire à Téhéran avec Kate Millett, où elles prévoyaient de manifester contre le tchador. L’ensemble me frappa par sa condescendante stupidité, et malgré mon désir de savoir ce qu’elle avait à dire, je vis qu’elle était particulièrement imbue d’elle-même et particulièrement inaccessible à toute discussion à ce moment-là. D’ailleurs, elle partit une heure plus tard environ (juste avant l’arrivée de Sartre), et on ne la revit plus.
Michel Foucault était présent, mais il me fit rapidement comprendre qu’il n’avait rien à dire sur le thème du séminaire, et qu’il allait très vite partir, comme tous les jours, se plonger dans son travail de recherche à la Bibliothèque nationale.”
Le thème du séminaire qui semble ennuyer Michel Foucault, c’est la Palestine. La plupart des autres invités – qui sont de fervents supporters de la colonisation israëlienne – empêchent Said de développer son argumentation. Voici un autre passage du texte:
“Sartre est effectivement resté constant dans son philo-sionisme fondamental. Peur de passer pour antisémite, sentiment de culpabilité devant l’Holocauste, refus de s’autoriser une perception en profondeur des Palestiniens comme victimes en lutte contre l’injustice d’Israël, ou quelque autre raison ? je ne le saurai jamais. Tout ce que je sais, c’est que, dans sa vieillesse, il n’était guère différent de ce qu’il avait été jadis : la même amère source de déception pour tout Arabe, Algérien excepté, qui admirait à juste titre ses autres positions et son œuvre. Bertrand Russell assurément fit mieux : dans ses dernières années, où il fut pourtant orienté, et même, selon certains, totalement manipulé par mon camarade de classe de Princeton et ancien ami Ralph Schoenman, il prit effectivement des positions passablement critiques à l’égard de la politique d’Israël envers les Arabes.
Pourquoi les grands hommes, dans leur vieillesse, succombent-ils tantôt aux artifices d’un cadet, tantôt à une sorte de rigidité qui les enferme dans une conviction politique intangible ? C’est une pensée démoralisante, mais il y a de ça dans le cas de Sartre. A l’exception de l’Algérie, la justesse de la cause arabe ne lui fit jamais grande impression, peut-être à cause d’Israël, ou alors du fait d’une absence élémentaire de sympathie, liée à des raisons culturelles ou éventuellement religieuses, je ne sais. Dans ce domaine, il était radicalement différent de son idole, Jean Genet, son vieil ami, qui célébra son étrange passion pour les Palestiniens en séjournant longtemps parmi eux, mais aussi en écrivant l’extraordinaire « Quatre heures à Sabra et Chatila » ainsi que « Le Captif amoureux ».
Un an après notre brève et décevante rencontre à Paris, Sartre était mort. Je me rappelle très vivement avec quelle tristesse je pleurai sa disparition.”
L’attitude de Sartre vis-à-vis des Palestiniens est assez comparable à celle d’Emmanuel Levinas et de Jacques Derrida, telles que décrites par Joseph Massad. Emmanuel Levinas a singulièrement développé une éthique puissante en apparence, mais qui s’effrite sitôt éprouvée par le réel. Une éthique de l’infini qui trouve paradoxalement sa limite dans l’autre palestinien. En effet, Massad rapporte que lorsque l’on interroge le philosophe après les massacres de Sabra et Chatila, ce dernier élude d’une manière assez obscène la question, et qu’il va jusqu’à justifier ce qui est advenu aux “autres” Palestiniens. N’ont-ils pas eux aussi des visages? Dans Ethique et Infini (Fayard, 1982), Levinas écrivait: “La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue bien que d’une nudité décente: il y a dans le visage une pauvreté essentielle; la preuve est qu’on essaie de la masquer en se donnant des poses, une contenance.” La pauvreté essentielle des visages des Palestiniens réfugiés n’a manifestement pas touché ce penseur dont l’éthique, au final, est à géométrie variable – selon que vous serez juif ou musulman, les jugements des philosophes vous rendront blanc ou noir! L’autre discours que Massad déconstruit est celui de Derrida. Il montre comment “l’abrahamique” derridien est une notion orientaliste projetée sur l’Islam:
“Le Coran (…) ne fait aucune mention de religions ou de fois ‘abrahamique’ ou ‘abrahamanique’ selon le terme utilisé par Said dans l’Orientalisme, et l’invocation coranique ‘millat ibrahim’ qui embrasse tous les prophètes d’Abraham à Muhammad, souvent invoquée à l’appui de la notion de ‘religions abrahamiques’, n’était pas nécessairement, voire pas du tout un geste visant à inclure dans ce groupement le christianisme et le judaïsme en tant que religions (…) S’il est vrai que le Coran prend la relève des écritures du judaïsme et du christianisme, il n’appelle pas pour autant les musulmans à prendre la relève des juifs et des chrétiens, mais plutôt à les inclure en tant que peuple du Livre.”
La notion “abrahamique” ainsi développée permet d’oublier le sémitisme, Derrida refuse d’articuler la question palestinienne à la question juive. Le vol colonial sioniste s’apparente, selon lui, à la violence originelle propre à la fondation d’un Etat. Il minimise donc l’impact des violences sionistes, tout en imputant la faute à l’Islam – alors même que, comme le souligne Massad, “la lutte contre le sionisme a toujours été partagée par les musulmans et les chrétiens palestiniens et arabes (…)” Enfin, Massad offre une analyse intéressante du recours à la justice par Derrida, lorsque celui-ci refuse de critiquer le colonialisme israëlien – alors qu’il condamne sans la moindre hésitation l’apartheid en Afrique du Sud, ne s’inquiètant pas d’une “justice” entre ceux qui commettent la ségrégation et ceux qui la subissent:
“Ce n’est pas une notion de justice aristotélicienne ou marxienne qu’invoque ici Derrida, en vertu de laquelle la justice signifie traiter également des gens égaux et inégalement des gens inégaux. Il semble plutôt s’engager en faveur d’une conception bourgeoise libérale de la justice, selon laquelle il convient de traiter également les égaux et les inégaux.”
Force est de constater la justesse, l’utilité voire l’urgence de la critique déployée par Joseph Massad dans son recueil – car les effets d’une analyse aussi puissante vont au-delà des spéculations philosophiques. Chaque lecteur, chaque lectrice, dans son souci de démêler le vrai du faux, est convoqué et incité à ne pas céder à la facilité qui consisterait à dénigrer l’Autre sur la base de jugements racistes foireux. Il s’agit bien d’articuler politiquement la question palestinienne à la question juive – pour trouver peut-être une communauté dans la quête de justice.
mercredi 4 novembre 2009
—
Joseph Massad, La persistance de la question palestinienne (La Fabrique, 2009)