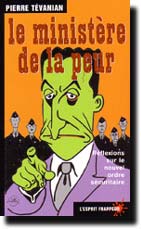Il existe depuis au moins dix ans un consensus sur « l’explosion de la violence chez les jeunes de banlieue » et sur le « laxisme de la justice » face à cette violence, ou du moins sur son « inadaptation » aux nouvelles générations de délinquants. Plutôt que de dénoncer au coup par coup les mesures de plus en plus brutales qui sont prises depuis plusieurs années au nom de ce discours, il vaut mieux prendre le problème à la racine et déconstruire ce qu’il faut bien appeler le mythe de l’insécurité. Il est en effet crucial de ne pas céder sur ce point : l’insécurité telle qu’elle est problématisée dans le débat public est un mythe. Il est indispensable de ne pas rallier, comme l’ensemble de la classe politique l’a déjà fait de longue date fait également sur « le problème de l’immigration » (Cf. Pierre Tevanian, Sylvie Tissot, Dictionnaire de la lepénisation des esprits, L’esprit frappeur, 2002)], le postulat faussement « réaliste » selon lequel « le problème de l’insécurité » est une « vraie question » – ce qui nous condamne à ne critiquer que les « réponses » les plus ostensiblement « antirépublicaines » des démagogues qui nous gouvernent. Il faut enfin résister au discours d’intimidation désormais omniprésent selon lequel quiconque met en doute la réalité des diagnostics catastrophistes est nécessairement « angélique », coupé des réalités en général et des classes populaires en particulier.
Le « problème de l’insécurité » est bel et bien un mythe même si, comme tout mythe, il mobilise des éléments de vérité, en particulier des faits divers dramatiques. En effet, la manière dont ces faits divers sont présentés, mis en scène, coupés de leur contexte et réinterprétés, est mensongère. C’est ce que s’efforcent de montrer les sept remarques qui suivent.
1. Le mythe des chiffres qui « parlent d’eux mêmes » ([L’analyse qui suit fait référence aux données chiffrées citées et analysées par Laurent Mucchielli dans Violence et insécurité. Mythes et réalités dans le débat français, La découverte, 2001)].
La thèse selon laquelle la « violence des jeunes » connaît une expansion sans précédent, justifiant une « adaptation » de la réponse politique dans le sens d’une plus grande « fermeté », se fonde en grande partie sur une instrumentalisation des chiffres de la délinquance. Or, les chiffres ne parlent jamais d’eux-mêmes. Ils demandent à être interprétés, et surtout lus de manière critique, en s’interrogeant notamment sur leur mode de fabrication. Car on l’oublie souvent : les chiffres publiés et abondamment commentés chaque année sont des chiffres produits par la police et la Justice, qui reflètent donc au moins autant la réalité de l’activité policière que celle des faits de délinquance. En effet, plus les forces de police sont mobilisées sur une forme particulière de délinquance, plus elles contrôlent, plus elles interpellent, et plus elles enregistrent une part importante de la réalité. Parmi les exemples les plus parlants, on peut évoquer le cas du viol, des violences sexuelles incestueuses ou plus largement des violences sur enfant qui ont lieu essentiellement dans l’espace familial. Si les chiffres ne cessent d’augmenter, c’est avant tout parce que ces formes de violence n’étaient quasiment pas enregistrées il y a quelques décennies, puisque la police – mais aussi l’ensemble de la « société civile » – n’en faisait pas une préoccupation importante.
Il en va de même pour toutes les formes de délinquance : c’est avant tout la focalisation du débat public et de l’activité policière sur la délinquance de rue qui fait augmenter les chiffres de la petite délinquance en général et de la délinquance des mineurs en particulier. un exemple illustre parfaitement cet effet d’optique que peuvent produire les statistiques : celui de l’outrage à agent. Les outrages à agent sont en effet l’une des infractions qui contribue le plus à faire augmenter les chiffres de la délinquance. Il est certes probable que les tensions, les conflits et donc les échanges de « mots » avec les forces de police soient réellement en augmentation (pour des raisons sur lesquelles il faudra revenir), mais il faut également souligner
d’une part que la « susceptibilité » des agents de police augmente elle aussi, et que le seuil au-delà duquel un mot de travers devient un « outrage » semble de plus en plus bas ;
d’autre part que les situations propices au conflit et à « l’outrage » sont artificiellement créées par la multiplication, ces dernières années, des contrôles d’identité ou des opérations « coup de poing » dans des situations où aucune infraction n’a été commise.
Les tribunaux voient de ce fait défiler des jeunes qui n’avaient commis aucun délit avant l’intervention de la police, et que cette intervention a amenés à commettre un « outrage » ([Cf. Laurent Bonelli et Gilles Sainati, La machine à punir, L’esprit frappeur, 2001, et Clément Schouler, Vos papiers ! Que faire face à un contrôle d’identité, L’esprit frappeur, 2001)].
Mais l’exemple le plus frappant est sans doute celui de la « toxicomanie ». Les infractions liées à l’usage, à la cession ou au trafic de stupéfiants sont en effet les infractions qui font le plus gonfler les chiffres de la délinquance. Or, comme le rappelle Laurent Mucchielli, lorsqu’on regarde de près les données enregistrées dont on dispose, on s’aperçoit qu’il s’agit dans la quasi-totalité des cas de faits ayant trait à la consommation ou à la vente de petites quantités de drogues douces (cannabis ou herbe essentiellement). Ces infractions qui font tellement gonfler les chiffres correspondent par conséquent à des comportements dont on sait par ailleurs, par des enquêtes sociologiques, qu’ils sont depuis les dernières décennies en train de se banaliser et qu’ils concernent une minorité de plus en plus importante, et cela dans tous les milieux sociaux.
Or, il est une autre information que nous donne la lecture des chiffres de la délinquance : c’est que les personnes mises en cause pour possession de petites quantités de drogues douces sont quasi-exclusivement des personnes jeunes, de sexe masculin et issues des classes populaires. On le voit : au lieu de « laisser parler d’eux même » les chiffres, au lieu plutôt de leur faire dire ce qu’ils ne disent pas (« les jeunes sont devenus des sauvages »), on peut en tirer quelques enseignements précieux – mais cela suppose qu’on tienne compte des biais et qu’on croise les chiffres de la police ou de la justice avec d’autres données – et ce qu’on découvre alors, dans le cas de la « toxicomanie », c’est qu’un comportement comme la consommation et la revente de drogue douce, également répandu dans tous les milieux sociaux, ne mène devant les tribunaux qu’une petite partie des personnes concernées : les « jeunes des banlieues ». Ce qu’on découvre, en d’autres termes, c’est que nous avons bien affaire, en la matière, à une justice de classe.
S’interroger ainsi sur la genèse des chiffres, et sur les chiffres comme indicateurs d’un choix politique, nous amène finalement à découvrir une autre omission : lorsqu’on assimile la réalité de la délinquance à la seule délinquance enregistrée, on occulte du même coup la partie non-enregistrée ou sous-enregistrée de la délinquance et de la violence. En effet, partout où l’investissement de la police et de la Justice est nul, faible ou en baisse, les chiffres sont par la force des choses nuls, faibles ou en baisse : la [délinquance patronale par exemple (et notamment le non-respect du code du travail) est de moins en moins contrôlée, et moins de 1% des infractions constatées par les inspecteurs du travail aboutissent à des condamnations en justice – avec, qui-plus-est, des condamnations dérisoires.
Il en va de même pour ce qui concerne la discrimination raciste à l’embauche ou au logement : aucune augmentation spectaculaire ne peut être constatée si l’on se réfère aux données du ministère de la Justice (on reste depuis de nombreuses années à moins d’une dizaine de condamnations par an), pour la simple raison qu’aucune volonté politique, et par conséquent aucun investissement policier ou judiciaire, n’existe en la matière. Il existe pourtant une multitude d’indicateurs, autres que policiers ou judiciaires, qui permettent d’affirmer que la discrimination est une forme de délinquance particulièrement répandue (Sur ce point, cf. Pierre Tevanian, La mécanique raciste, Dliecta, 2008.)]. Quant à la violence de la chose, et sa gravité, elle n’est pas à démontrer. Mais de cette violence-là, peu d’élus se préoccupent.
2. « La violence » : une catégorie d’amalgame
Une règle élémentaire de méthode veut qu’on commence toujours par définir les termes qu’on utilise. C’est précisément ce que se gardent bien de faire les journalistes et les élus qui partent en croisade contre les « violences urbaines » et « l’insécurité ». Ces derniers font en effet comme si le sens des mots violence, délinquance et insécurité allait de soi, comme si ces mots étaient interchangeables et comme s’ils étaient tous synonymes de : jeune homme basané vêtu d’une casquette insultant une vieille dame avant de lui voler son sac…
Or, violence n’est pas synonyme de délinquance : il existe des formes de délinquance qui sont peu ou pas du tout violentes, et ce sont justement celles-là qui contribuent à faire augmenter le chiffre global de la délinquance : l’outrage à agent, par exemple, ne peut pas sérieusement être considéré comme un acte très violent. Et la consommation de cannabis encore moins.
Inversement, les formes de délinquance les plus violentes, comme les homicides volontaires, ne sont pas en hausse (ils stagnent autour de 600 cas par an – soit : pas plus que les décès causés par des accidents de travail, et dix à vingt fois moins que les décès par accident de la route ou par suicide). Ni les homicides volontaires commis par des mineurs (autour de trente cas par ans). Ni les homicides commis contre des policiers.
Par ailleurs, il y a des formes diverses de violence, plus ou moins graves, et plus ou moins légitimes. Quoi de commun entre un vol à l’arraché, une injure, une gifle, un meurtre, un viol, et une émeute consécutive à une « bavure » policière ? Quel intérêt, pour la compréhension de ces phénomènes, de les ranger tous sous la même catégorie générique ? Aucun. Le seul intérêt de cette catégorie d’amalgame est qu’elle permet d’imposer sans le dire une thèse implicite : la thèse selon laquelle il existe une réalité homogène, « la violence », qui commence dès le premier mot de travers, dès la première « incivilité », et qui se poursuit inéluctablement, si on n’y prend garde, dans une escalade qui culmine avec la criminalité organisée et l’homicide. En d’autres termes : lorsqu’on se refuse à distinguer entre délinquance et violence, ou entre différents types et degrés de violence, on aboutit très facilement à la « théorie de la vitre cassée » et à la doctrine de la « tolérance zéro ».
3. Le mythe de l’âge d’or
Les discours catastrophistes sur l’explosion de la violence des jeunes reposent également sur une amnésie plus ou moins volontaire : pour pouvoir affirmer que nous vivons une période de déferlement sans précédent de la violence, il faut au préalable avoir bien oublié ce qu’il en était réellement de la violence dans le passé.
Or, si l’on se réfère sérieusement à toutes les sources qui sont à notre disposition sur le passé comme sur le présent, forme de délinquance par forme de délinquance, on s’aperçoit qu’il existe aujourd’hui des formes nouvelles de délinquance et de violence, ou du moins des formes de délinquance et de violence qui semblent actuellement en augmentation (par exemple les caillassages de bus, les outrages à agent et plus largement les conflits avec les institutions, ou encore la consommation de cannabis), mais que ces formes de délinquance sont les moins violentes, et qu’inversement les formes les plus violentes (comme les homicides volontaires, les homicides commis par des mineurs ou les viols collectifs) ne sont pas en augmentation ([Cf. Laurent Mucchielli, Violence et insécurité. Mythes et réalités dans le débat français, La découverte, 2001)]. L’âge d’or dont nous parle le nouveau sens commun sécuritaire fut en réalité une période où le risque de se faire tuer était bien supérieur à ce qu’il est aujourd’hui. À ceux qui nous accusent d’être angéliques, il faut donc répondre que ce sont eux qui ont une vision angélique du passé.
4. La logique du bouc émissaire
Il est un autre mensonge, l’un des plus répandus et des plus pervers, qui consiste à évoquer des faits réels, mais en prétendant, sans la moindre preuve, que les jeunes de banlieue en ont le monopole. C’est ainsi, par exemple, qu’on parle des [« tournantes », et plus largement des formes plus ou moins agressives de sexisme ; c’est ainsi également qu’on parle de l’antisémitisme. Dans tous les cas, le discours dominant a ceci de pervers qu’il pointe du doigt des problèmes bien réels, dont la gravité est indiscutable, mais qu’il oublie de dire que les problèmes en question concernent en réalité l’ensemble de la société française, et qu’aucune donnée empirique ne permet d’affirmer que la jeunesse des banlieues est davantage en cause que le reste de la société (Nonna Mayer a par exemple montré que les enquêtes d’opinion contredisent la thèse de la « nouvelle judéophobie », élaborée par Pierre-André Taguieff et relayée par de nombreux médias : les idées antisémites ne sont pas, comme le prétend Pierre-André Taguieff, dominantes dans les milieux d’extrême gauche et dans la jeunesse issue de l’immigration maghrébine ; elles restent, aujourd’hui comme par le passé, présentes dans l’ensemble de la société française, avec des « pics »à la droite de la droite, dans les franges de l’opinion qui manifestent par ailleurs un très fort rejet de l’immigration maghrébine : en 2000, les sondés qui approuvent l’énoncé « les Juifs sont trop nombreux en France » (soit 20% des sondés) approuvent à 97% l’énoncé « il y a trop d’Arabes ». Cf. N. Mayer, Le Monde, 04/04/2002.).
5. La marque du négatif
Le tableau que la majorité des dirigeants politiques et des grands médias dressent de la banlieue et des jeunes qui y vivent est également mensonger parce qu’un certain nombre de réalités y sont absentes. En effet, si le mot violence renvoie de manière automatique à la banlieue et à ses « jeunes », qui semblent de ce fait en avoir le monopole, la réciproque est vraie : les mots jeunes, banlieue et « jeune de banlieue » renvoient automatiquement au mot « violence », comme si, en banlieue, ou du moins chez ces jeunes, il n’y avait que de la violence.
Or, il se passe beaucoup de choses en banlieue, qui ne se résument pas à l’incendie d’une poubelle, au vol d’une voiture ou au règlement de compte entre cités. Parmi les problèmes que vivent les habitants de la banlieue, et dont les élus et les grands médias parlent moins volontiers que de la « violence des jeunes », il y a aussi des violences autrement plus graves et plus fréquentes, qui sont commises par l’entreprise ou par l’institution, et qui frappent au premier chef ces jeunes qu’on stigmatise et qu’on accuse : chômage, précarité, discriminations, brutalités policières…
Il y a aussi en banlieue un potentiel énorme, rarement reconnu : une vitalité, des solidarités et des formes de vie sociale, culturelle et politique qui s’inventent (Cf. David Lepoutre, Cœur de banlieue, Odile Jacob, 1998, et surtout Saïd Bouamama (dir. ), Contribution à une mémoire des banlieues, Volga éditions, 1994)], dans l’indifférence générale des élus et des grands médias. Il est extrêmement important de le rappeler, car le plus souvent, les mieux intentionnés tentent de défendre les jeunes de banlieue en les réduisant au statut de victimes. Mis à part la violence, admettent-ils d’un commun accord avec leurs adversaires « sécuritaires », « il n’y a rien » ([François Dubet, La galère, Fayard, 1987.)]. Un nouveau sens commun progressiste, alimenté par certains sociologues, décrit la banlieue comme un « désert », un « no man’s land », où vivent des jeunes qui « ne sont unis que par la galère, la désorganisation et la rage » ([François Dubet, La galère, Fayard, 1987.)]. On parle également d’anomie, d’absence de repères et d’absence de conscience politique… Cette vision misérabiliste est non seulement fausse, mais aussi inopérante pour contrer l’offensive sécuritaire que nous affrontons aujourd’hui : tout au plus permet-elle de modérer la peur et la haine ; ce qu’elle laisse en revanche intact, c’est le mépris des « jeunes de banlieue ».
6. L’oubli de l’origine
Ce qui engendre le mépris, et donne une apparence de réalité à l’image du jeune de banlieue comme corps furieux, « sauvage » ou « dé-civilisé », c’est aussi l’oubli, ou plutôt le refoulement de l’origine des phénomènes de délinquance ou de violence. On peut le constater à propos de la petite délinquance : on a assisté, ces dernières années, de manière plus ou moins consciente et délibérée, à la mise à l’écart des enseignements que nous apporte la sociologie sur la corrélation forte existant entre origine sociale et incarcération (la population carcérale est une population plus jeune, plus masculine et d’origine plus pauvre que la moyenne). Dans les grands médias, les sociologues ont peu à peu cédé la place à de nouveaux « experts » : des psychologues qui dépolitisent la question en rattachent « la violence » en général à la nature humaine et au « besoin d’agression » ou au « manque de repères », voire à la « carence d’éducation », ou des entrepreneurs en « sécurité publique » comme le très influent [Alain Bauer, qui a réussi à publier un Que sais-je ? sur les « violences urbaines », et dont le moins qu’on puisse dire est qu’il est juge et partie…
Il en va de même si l’on considère les émeutes urbaines qui se sont succédées depuis le début des années 90, de Vaulx-en-Velin (1990) et Mantes-la-Jolie (1991) à Clichy-sous-Bois (2005), Villiers-le-Bel (2007) et Grenoble. Ces émeutes que la classe politique, les grands médias et les sociologues les plus médiatisés ont quasi-unanimement présenté comme des poussées de fièvre nihiliste, « aveugle, autodestructrice et sans objet » (François Dubet, « Violences urbaines », Cultures et conflits, n°6, 1992)], dépourvues de toute dimension politique, de toute dimension revendicative et de toute rationalité, ces émeutes qu’on présente aujourd’hui comme les preuves irréfutables d’un manque d’éducation ou d’humanité, ont toutes eu pour événement déclencheur la mort violente d’un jeune, le plus souvent issu de l’immigration, le plus souvent au cours d’une intervention policière.
Par conséquent, indépendamment de tout jugement moral ou de toute considération de stratégie politique, force est d’admettre que ces émeutes ont une rationalité et une dimension politique, et qu’elles constituent une forme de résistance. Si, en plus de cette anamnèse quant à l’élément déclencheur des émeutes, on remonte plus loin, si l’on se souvient qu’au début des années 80, des événements du même type (les crimes racistes et sécuritaires) avaient été pour beaucoup dans le déclenchement de la Marche pour l’Égalité ([Rebaptisée « Marche des beurs » dans par la mémoire officielle.)] et de Convergence 84, si l’on se souvient que tous les moyens politiques non-violents avaient alors été mobilisés (la prise de parole publique, la manifestation, la marche pacifique, mais aussi le recours aux tribunaux pour juger les crimes policiers) ([Cf. Bouzid, La Marche, Sinbad, 1983 ; Convergence 84, Ruée vers l’égalité, Mélanges, 1984 ; Saïd Bouamama, Vingt ans de marche des beurs, Desclée de Brouwer, 1994.)], si l’on se souvient qu’alors des promesses avaient été faites par les autorités et si l’on se souvient enfin que durant les années qui ont suivi, rien n’est advenu (hormis [des non-lieux, du sursis ou des acquittements de policiers assassins), alors les « explosions » de Vaulx-en-Velin, Mantes la Jolie, Dammarie-les-Lys, Toulouse, Roubaix, Clichy, Villiers ou Grenoble apparaissent tout à coup bien moins imprévisibles, bien moins irrationnelles et même bien moins illégitimes. Alors, surtout, loin de témoigner d’un ensauvagement de la jeunesse des banlieues, ces émeutes témoignent au contraire de l’existence d’un souci de la vie d’autrui, d’une mémoire et d’une incapacité à se résigner face à l’injustice, qui sont la marque même de l’humain.
7. Le legs colonial
Parmi les ressorts du consensus sécuritaire que nous affrontons aujourd’hui, bien d’autres pistes mériteraient d’être explorées, en particulier du côté du passé colonial et des représentations qui se sont forgées et transmises durant cet épisode « épique ». En effet, tant du point de vue des représentations que des dispositifs politiques et policiers qui se mettent en place aujourd’hui, la filiation est évidente : si l’on parle aussi facilement de « reconquête territoriale », d’espaces « décivilisés », de « sauvageons », de « défaut d’intégration » ou de « défaut d’éducation », si l’on parle aussi facilement de « nécessaire adaptation » de notre dispositif pénal à des populations radicalement différentes des « blousons noirs de jadis », vivant « en dehors de toute rationalité », c’est que ce vocabulaire, et le regard qui le sous-tend, n’ont rien de nouveau. C’est le même vocabulaire et le même regard qui ont eu cours il y a plus d’un siècle lorsqu’il s’est agi d’inventer un discours sur « l’indigène » – dont les « jeunes de banlieue » aujourd’hui incriminés se trouvent être, en grande partie, les descendants.
Et c’est également dans l’héritage colonial qu’il faut aller chercher si l’on veut comprendre la genèse des dispositifs d’exception qui se mettent en place ou se renforcent dans les banlieues : qu’il s’agisse du couvre-feu, de la « guerre préventive » que constituent les contrôles policiers à répétition (ou les dispersions intempestives dans les halls d’immeuble) ou qu’il s’agisse de la pénalisation des parents pour les fautes des enfants, nous avons affaire à des pratiques qui violent un certain nombre de principes fondamentaux (comme le principe de la présomption d’innocence ou celui de la responsabilité individuelle) et qui par conséquent apparaissent comme des anomalies au regard d’une certaine tradition du Droit français, mais qui ne tombent pas du ciel. Si l’on se réfère à l’autre tradition française, à la part d’ombre que constitue le droit d’exception qui s’est inventé et expérimenté dans les colonies françaises, alors la surenchère « sécuritaire » à laquelle nous assistons depuis près de deux décennies perd beaucoup de sa nouveauté ou de son originalité.
En guise de conclusion
Le travail de déconstruction que nous venons d’esquisser est nécessaire, mais pas suffisant. Il laisse en effet de côté d’autres points sur lesquels il faudrait s’interroger, et sur lesquels nous avons proposé ailleurs quelques analyses (Cf. Pierre Tevanian, Le ministère de la peur, L’esprit Frappeur, 2004.)]. En particulier, une fois établi le caractère fondamentalement mythique du discours dominant sur la violence et l’insécurité, il reste à s’interroger sur les raisons de son succès : comment un discours aussi grossièrement mensonger, bête et méchant a-t-il pu s’imposer dans des franges aussi larges de l’opinion ? On se contentera ici de dire qu’à notre sens, le Front national est sans doute l’un des grands bénéficiaires de la dérive sécuritaire, mais qu’il est loin d’en être l’acteur principal : il y a une responsabilité écrasante du reste de la classe politique, de gauche comme de droite, ainsi que des grands médias.
Une autre question qui ne doit pas être perdue de vue est celle des effets concrets de cette dérive sécuritaire. Les discours s’accompagnent en effets d’actes, qu’ils suscitent ou qu’ils légitiment après-coup, et ces actes sont criminels. D’abord parce que les discours et les pratiques sécuritaires produisent une partie des maux qu’ils prétendent déplorer et combattre : ils sèment la méfiance, la peur, le repli sur soi, l’individualisme, la haine et la division, et donc suscitent ou entretiennent les tensions les plus stériles et les plus dangereuses. La prolifération de discours stigmatisant la banlieue entretient non seulement le racisme et le mépris de classe, mais elle sème également la peur, la haine et le mépris au sein même des classes populaires : entre adultes et « jeunes », entre « bons » et « mauvais parents », entre filles et garçons, entre Français « de souche » et « immigrés » ou encore entre « bons » et « mauvais immigrés »…
La logique du bouc-émissaire est aussi dommageable pour l’ensemble de la société : en entretenant l’illusion que l’égoïsme, l’individualisme, la dépolitisation ou encore le sexisme, l’homophobie et l’antisémitisme n’existent qu’en banlieue, le moins que l’on puisse dire est qu’on n’incite pas les classes moyennes et supérieures à traiter ces problèmes qui sont aussi les leurs, et qu’on réserve de ce fait aux femmes, aux homosexuels ou aux Juifs de très déplaisantes surprises.
Mais si le discours et les pratiques sécuritaires pourrissent l’ensemble des rapports sociaux, on ne peut pas nier malgré tout que ceux qui en subissent le plus directement et le plus brutalement les conséquences sont les « jeunes de banlieue », en particulier ceux qu’on qualifie d’ « issus de l’immigration » :
d’abord parce qu’on est en train de briser par milliers des jeunes en les envoyant en prison ou en « centre fermé », en lieu et place de toute réponse sociale ;
ensuite parce que la focalisation sur les « violences et incivilités » dont certains de ces jeunes se rendent coupables constitue une formidable puissance d’occultation et de diversion : occupés à se défendre ou à se faire oublier un peu, il leur est plus difficile que jamais de faire entendre leur voix, leur avis et leurs griefs contre une société qui leur impose le chômage, la précarité, le racisme et la discrimination ;
enfin parce que le consensus sécuritaire se traduit par une légitimation et une banalisation (voire une légalisation de fait) des violences institutionnelles les plus illégitimes (et théoriquement illégales), en particulier les abus policiers : contrôles à répétition, contrôles au faciès, fouilles humiliantes, passages à tabacs, usages abusifs de la procédure d’ « outrage », et même homicides.
Par légalisation de fait, il faut entendre ceci, parmi [bien d’autres exemples possibles : en septembre 2001, le policier Hiblot, qui avait abattu le jeune Youssef Khaif, en fuite à bord d’une voiture, d’une balle dans la nuque tirée à plus de douze mètres, a été purement et simplement acquitté.
Reste enfin une ultime question, la plus urgente : comment résister ?
Pierre Tévanian
SOURCE : LMSI