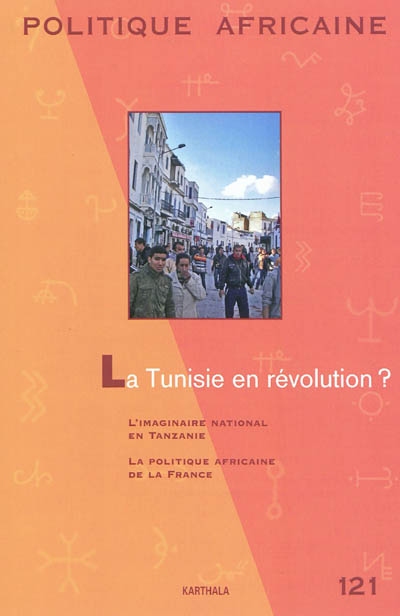Quelle est votre interprétation des événements tunisiens ?
On n’explique pas une révolution populaire. Pas plus qu’on ne peut anticiper le moment où elle advient. Elle apparaît comme une rupture dans la normalité, une accélération brutale des temporalités politiques, une déchirure dans l’histoire qui s’exprime par le surgissement des foules dans le champ central du pouvoir, pour en écarter brutalement les hommes censés les diriger et les représenter. La révolution populaire s’identifie ainsi au moment exceptionnel où la politique se passe de médiations ; la démocratie directe devient réalité, brute, tumultueuse et vivante. À l’occasion des récents événements en Tunisie, de nombreux commentateurs se sont souvenus de la fameuse formule de Lénine : « Une période révolutionnaire se caractérise par l’incapacité de ceux d’en haut de gouverner comme avant et le refus obstiné de ceux d’en bas d’être gouvernés comme avant ». La révolution, de ce point de vue, c’est l’instant où le conflit entre « ceux d’en haut » et « ceux d’en bas » atteint son point d’incandescence. La révolution tunisienne ne fait pas exception. Le suicide tragique de Mohamed Bouazizi a représenté ce point d’incandescence. Mais le stratège de l’Octobre russe parlait de « période révolutionnaire » et non de révolution. Il évoquait le temps incertain où le conflit est là mais n’est point tranché, où les rapports de forces, labiles, libèrent, sans le garantir, l’horizon des possibles. En Tunisie, la puissante mobilisation populaire qui a contraint Ben Ali à prendre la poudre d’escampette est une révolution, moment d’une période révolutionnaire qui n’est évidemment pas close aujourd’hui. Au « pays du jasmin », le vase était donc plein. La question qui se pose de prime abord est : pourquoi n’a-t-on pas vu que le vase était plein ?
Si l’on ne peut expliquer la révolution, peut-on tout de même expliquer pourquoi « on n’a pas vu que le vase était plein » ou, dit autrement, le caractère explosif de la situation ?
Si, dans le monde arabe, un pays paraissait à l’abri d’une révolution, c’est bien la Tunisie. Abreuvée de publicités vantant la tranquillité et les douceurs d’une Tunisie immuablement destinée à produire du sable et des parasols, et aussi quelques serveurs au teint doré, l’opinion publique européenne ne pouvait naturellement imaginer que ce pays puisse être également le lieu de dramatiques conflits politiques. Au singulier comme au pluriel, la Tunisie aurait été un pays sans histoire(s). Il n’est pas dit que cet imaginaire touristique n’imprègne pas également les sphères politiques, médiatiques et intellectuelles, généralement confiantes dans la « stabilité » de la Tunisie. Incontestablement, cependant, leur aveuglement procédait d’un phénomène d’auto-intoxication. On ne voit, en effet, que ce que l’on veut voir et que ce que l’on veut donner à voir. Déterminées à appuyer le régime du président Ben Ali, les grandes puissances (États-Unis, France, Union européenne) ainsi que les institutions financières internationales n’ont cessé depuis vingt ans de promouvoir un discours de la « stabilité » tunisienne : croissance correcte et équilibres macroéconomiques satisfaisants ; intégration lente mais certaine au marché libre mondial ; développement d’une « classe moyenne » destinée à jouer le rôle d’amortisseur social ; politique étrangère raisonnable et pacifique ; enfin, transition démocratique, certes quelque peu freinée par un manque de « transparence » au niveau de la « gouvernance », mais surtout entravée par les impératifs sécuritaires justifiés par la « menace islamiste ». Autrement dit, le seul facteur de déstabilisation éventuelle de la situation politique tunisienne a été situé là où il n’était pas : dans l’intégrisme islamique.
Ce type de discours a été largement relayé par les grands médias internationaux et par nombre de commentateurs et chercheurs en sciences sociales. On ne peut cependant y voir seulement une forme de complaisance intéressée vis-à-vis du régime tunisien. S’y ajoute en effet un mode d’appréhension du social marqué à la fois par son élitisme et par le tropisme de l’État bureaucratique représentatif. On ne s’est ainsi guère soucié d’observer les évolutions réelles des mouvements d’opinion au sein des couches défavorisées de la population tunisienne ; leurs résistances, parfois spectaculaires, n’ont pas attiré, ou fort peu, l’attention ; seule a été prise en compte dans l’analyse de la situation l’action des formations de l’opposition, agissant dans la sphère « rationnelle » de la politique, même si ces formations n’étaient pas reconnues par les autorités, voire étaient sévèrement réprimées. Or, pour actives qu’elles aient été, les organisations politiques et associatives contestataires ne représentaient qu’une frange extrêmement réduite de la population. Consécutive pour partie à la répression, leur marginalité a été bien souvent et à tort interprétée comme indiquant l’absence de contestation effective du régime de Ben Ali. Je pourrais évoquer aussi cette idéologie suspecte selon laquelle le Tunisien est doux et pacifique, porté à la réforme et à la négociation ; cette forme de culturalisme congruente à l’imaginaire touristique qui confond l’obséquiosité professionnelle du garçon d’ascenseur avec un penchant quasi naturel à privilégier la conciliation au conflit. Sans pouvoir m’étendre davantage sur ce point, je voudrais souligner enfin la tendance de nombreux chercheurs à s’intéresser uniquement aux structures, institutions et autres dispositifs de pouvoir sans tenir compte des résistances qu’ils suscitent. La politique, comme rapport de forces, est ainsi complètement évacuée et l’histoire tunisienne y semble condamnée à une éternelle inertie.
Mais n’était-ce qu’une question de partenaires étrangers ? Pourquoi les oppositions internes n’ont-elles rien vu venir, non plus ?
En effet, en Tunisie même, le caractère explosif de la situation politique n’a guère été perçu par les observateurs, généralement engagés dans l’un ou l’autre des mouvements de contestation. Ou plus exactement, si l’éventualité d’une révolte spontanée de grande ampleur, similaire à la « révolte du pain » en 1984, était considérée comme possible, elle n’était pas envisagée comme susceptible de prendre une dimension directement politique ni a fortiori de conduire à la chute du président de la République. En dehors peut-être de certains groupes d’extrême gauche comme le PCOT[1] ou d’une personnalité comme l’ancien dirigeant de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Moncef Marzouki, la perspective d’une large mobilisation populaire n’était aucunement intégrée dans l’horizon stratégique des formations de l’opposition. Il est significatif, de ce point de vue, qu’en 2008, lors de la révolte dans le bassin minier de la région de Gafsa, moment décisif sur lequel je reviendrai, la plupart des forces de l’opposition sont restées en retrait du mouvement pendant plusieurs semaines avant de lui manifester un soutien timide, destiné davantage à souligner la gravité de la situation sociale et l’urgence des réformes à mettre en œuvre plutôt qu’à élargir la sphère de la contestation populaire. On pourrait tenter une analyse sociologique des partis et associations concernés, relever notamment l’appartenance de leurs cadres à des secteurs relativement privilégiés de la société tunisienne, mais une telle approche, sans être dépourvue de toute pertinence, manquerait certainement d’autres facteurs très importants également comme la trajectoire militante qui est celle de beaucoup d’entre eux. Je peux évoquer, à titre d’exemple, le fait que nombre des dirigeants de l’opposition tunisienne sont issus d’un long parcours qui a débuté dans des groupes dont les ambitions révolutionnaires et les appels au peuple ont été systématiquement déçus. De même, les modèles de rupture radicale auxquels ils ont pu se référer dans le passé se sont écroulés ou se sont avérés inopérants, tandis que se répandait le mythe de « transitions démocratiques » douces reposant sur la négociation entre certaines fractions du pouvoir et les courants « raisonnables » de l’opposition. Il me faut souligner également la nécessité où se sont trouvées les oppositions tunisiennes, isolées et persécutées par le régime, de trouver des appuis à l’extérieur du pays et d’en espérer une pression sur le pouvoir. L’un des effets pervers d’une telle politique a été l’adoption de stratégies de lobbying, articulées autour de la question des droits de l’homme, comme substitut à la construction d’un rapport de forces en Tunisie. Ce ne sont là que quelques dimensions du problème mais, quoi qu’il en soit, il est clair que la mobilisation spontanée ou organisée des couches défavorisées de la population tunisienne ne faisait pas partie de l’équation politique envisagée par la majorité des forces d’opposition alors que, sans même avoir recours à un microscope sociologique, les indices d’une crise politique probable ne manquaient pas.
Pourtant, le régime semblait solidement assis…
Cela peut paraître effectivement paradoxal. Permettez-moi de rappeler rapidement, ici, la fragilité des fondements qui ont permis à Ben Ali de garder le pouvoir pendant tout de même 23 ans. Le succès du coup d’État du 7 novembre 1987 s’explique, en premier lieu, par la décomposition profonde des sommets de l’État bourguibien, une crise de succession qui prolonge et aggrave une autre crise : l’inadéquation croissante du pacte sociopolitique mis en place au lendemain de l’Indépendance (1956) et des nouvelles réalités sociales tunisiennes. Largement contestée, l’hégémonie destourienne s’est progressivement transformée en simple autorité, s’appuyant sur la coercition et les mécanismes clientélaires bien plus que sur le consentement, pour utiliser un concept gramscien. En témoignent notamment la mise au pas de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) en 1985 et la répression féroce du parti Ennahdha (islam politique) dans les mois qui ont précédé la prise du pouvoir par Ben Ali. Celui-ci s’installe, ainsi, au Palais de Carthage alors que « ceux d’en haut » paraissaient « incapables de gouverner comme avant » et que « ceux d’en bas », dont le mouvement de contestation était en phase ascendante depuis le milieu des années 1970, venaient de subir une grave défaite à travers la répression de leurs deux principaux canaux d’expression, l’UGTT et Ennahdha. Mince comme une feuille de papier à cigarette, la légitimité de Ben Ali a reposé quelques mois sur l’illusion qu’il allait effacer les dernières années du bourguibisme et réformer le régime en donnant toute leur place aux différentes forces sociales et politiques. Un semblant de « réconciliation syndicale », une ouverture démocratique au compte-gouttes et la tolérance vis-à-vis des activités du mouvement Ennahdha, lui permettront un temps de neutraliser des oppositions. Dès la fin 1989, celles-ci se montreront plus virulentes, mais intervient alors la première guerre du Golfe (1990-1991). Ben Ali refuse de participer à la coalition militaire anti-irakienne, gagnant ainsi un soutien populaire momentané ; il retrouve l’appui de certaines forces de l’opposition démocratique tandis que la direction d’Ennahdha se divise entre les pro-Saddam et les anti-Saddam. Dès lors, la machine policière se met en branle, profitant incontestablement de la crise d’Ennahdha. Déjà ébauché avant la guerre du Golfe, le démantèlement de ce parti s’accélère et prend des formes d’une rare violence, notamment entre 1991 et 1994. La rhétorique « pas de liberté pour les ennemis de la liberté » permettra à Ben Ali de bénéficier pendant une décennie de la complicité passive de l’écrasante majorité du mouvement démocratique tunisien et, jusqu’à sa chute, des principales puissances occidentales. Dans la foulée de la répression d’Ennahdha, sont brutalement réduites au silence les tendances syndicales les plus contestataires ainsi que toutes les formes de protestation démocratique.
Ce bref rappel des premières années du règne de Ben Ali me semble important pour comprendre certaines des raisons fondamentales qui lui ont permis d’instaurer un pouvoir autoritaire durable malgré son incapacité notable à construire une nouvelle légitimité morale et un compromis social rénové. Je m’abstiendrai ici de décrire les dispositifs de répression, d’encadrement et de contrôle qui ont été mis en place dans les années 1990 pour compenser le déficit de légitimité du régime ; par contre, il me paraît essentiel de préciser que les pratiques dites mafieuses des sommets du pouvoir, l’arbitraire policier et administratif, la généralisation du clientélisme et de la corruption, ont contribué, au sein de toutes les couches sociales, à voir le pouvoir comme l’incarnation d’une autorité sans morale. Il se distingue ainsi radicalement du régime de Bourguiba. En effet, même dans les moments où celui-ci a été le plus fortement contesté, la moralité du « combattant suprême » n’a jamais été mise en cause. Personne n’ignorait les privilèges que s’octroyaient les sommets de la bureaucratie politique et administrative mais le système lui-même n’était pas identifié, comme cela a été le cas du régime de Ben Ali, à un système fonctionnant principalement au service de l’enrichissement illicite et du pouvoir absolu d’un réseau familial aux mœurs corrompues.
Mais cette perception, comment s’est-elle diffusée et depuis quand ?
Là encore, le moment important date du tout début des années 2000 avec, entre autres choses, la diffusion sous le manteau de libelles dénonçant le népotisme des « familles » qui entourent Ben Ali, les appropriations illégales de biens, le racket sur les entreprises, l’accumulation suspecte de richesses. Ce type de rumeurs, alors invérifiables, s’est répandu avec d’autant plus de facilité qu’à tous les niveaux de la société, de nombreux responsables du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD)[2], de l’administration ou de la police ne s’embarrassaient guère de scrupules pour tirer profit de leur situation de pouvoir et que, bien souvent, s’y entrelaçaient sans masque les réseaux du pouvoir, de l’argent et de la délinquance (contrebande dans les régions frontalières, par exemple). À titre d’illustration, je peux rappeler aussi la révolte des villes de la région de Gafsa en 2008. Partie de la petite ville de Redeyef, ce mouvement populaire, qui a duré six mois, a gagné les principaux centres miniers de la région avant de se heurter à la machine répressive du pouvoir. Ce qui importe ici pour mon propos, c’est que cette révolte a eu pour détonateur le contournement des résultats d’un concours de recrutement et la collusion de la direction de l’entreprise, des instances administratives de l’État et des représentants locaux de la centrale syndicale. Bien sûr, la question du chômage était éminemment présente en arrière-plan de cette révolte mais l’élément qui a déclenché la colère et lui a donné une telle ampleur, ce sont bien les pratiques du régime, perçues comme contraires à l’éthique sociale. Dans le même ordre d’idées, je dois évoquer également, et peut-être surtout, le rôle grandissant de Leïla Ben Ali, considérée comme une femme de petites mœurs, assoiffée de pouvoir et d’argent. Plus encore que le président, cette femme a symbolisé aux yeux des Tunisiens la corruption morale du système. Ainsi, plus que l’autoritarisme, ce qu’ont reproché les Tunisiens au régime de Ben Ali, c’est son immoralité. Autrement dit, non seulement le régime benaliste n’avait pas d’autorité morale mais il était perçu comme une autorité sans morale. Pour le dire d’une autre manière, un pouvoir doté d’une autorité morale se voit reconnaître le droit de commander même si ses choix sont contestés ; il est perçu comme une émanation de la société et, s’il échoue à servir l’intérêt commun, il peut être écarté. L’autorité sans morale est un pouvoir qui s’impose à la société ; il est perçu comme lui étant en quelque sorte extérieur, et son détenteur est considéré comme un usurpateur mû par son intérêt personnel, qu’il est prêt à satisfaire par tous les moyens. On ne lui reproche pas une politique inadéquate ou injuste mais de menacer l’éthique même qui fait la société. On ne l’écarte pas, on le juge devant les tribunaux. La perception du pouvoir de Ben Ali comme autorité sans morale est sans doute l’une des clés qui permet de saisir certaines particularités de la révolution tunisienne, et notamment le large consensus social qui l’a accompagné.
Contrairement à ce que beaucoup d’observateurs présupposent, pour vous la « question sociale » n’a donc pas été le facteur premier du mouvement.
C’est en effet une question importante. De mon point de vue, une analyse de la révolution tunisienne en termes strictement socio-économiques est impuissante à en cerner la dynamique profonde. Certes, le mouvement a débuté dans les régions les plus déshéritées du pays et, dès le départ, des revendications sociales ont été avancées, formulées bien souvent par des groupes de militants politisés ou par des syndicalistes. Pour autant, ces revendications, dont l’importance n’est cependant pas à négliger, n’ont pas été au centre du processus qui a conduit au départ du Président. Il en va de même de la question démocratique. N’importe quel opposant tunisien doté d’une certaine expérience peut témoigner de la difficulté à traduire les préoccupations des populations défavorisées dans le langage normé de la démocratie qui est celui des partis politiques et des associations de défense des libertés. Et quand ce langage est repris à une échelle de masse, il faut aussi se demander quelles attentes recouvre une telle réappropriation. Ni l’explication socio-économique, ni l’explication démocratique, ni la somme des deux, ne suffisent, me semble-t-il, à expliquer le très large consensus qui s’est opposé à Ben Ali, par-delà les clivages sociaux. Pour comprendre ce consensus, il faut faire appel à une notion, difficile à cerner, souvent négligée mais qui, pourtant, semble au cœur de nombreux mouvements de révolte : la dignité.
J’ai noté plus haut que Ben Ali, son épouse et leurs proches étaient perçus comme l’expression de la corruption morale du régime ; il me faut ajouter maintenant qu’à son niveau, chaque Tunisien a été contraint d’en être d’une certaine manière complice. Un tel phénomène a produit une forme d’auto-dévalorisation collective et individuelle. Autant sinon plus que la peur, le système de répression et de surveillance développé sous Ben Ali a ainsi produit un sentiment d’indignité. Les multiples compromissions, les différentes formes d’allégeance au pouvoir, voire d’insertion active dans ses réseaux, souvent incontournables pour trouver un travail ou avoir une promotion, ouvrir un commerce, permettre une démarche administrative ou tout simplement éviter d’avoir des problèmes dans la vie quotidienne, ont engendré frustrations, humiliations, sentiments d’irrespect pour soi et les autres dans toutes les classes sociales. Aux formes de reconnaissance intersubjectives et institutionnelles, nécessaires à tout type d’hégémonie éthique, le pouvoir en place en Tunisie a substitué l’institutionnalisation du mépris. À la détérioration de l’image de soi individuelle s’est ajoutée la détérioration de l’image de soi comme Tunisien, comme membre d’une collectivité. Devenu le héros de la Révolution, le jeune Mohamed Bouazizi qui s’est immolé par le feu a peut-être suscité un phénomène aussi large d’identification non pas tant parce qu’il vivait dans la misère que parce qu’il a été volontairement humilié par un agent de la municipalité qui l’a giflé après lui avoir confisqué sa marchandise. La révolte qui a suivi son acte de désespoir peut être interprétée en ce sens comme portée par une demande de reconnaissance sociale dont chacun savait que non seulement elle ne pourrait être satisfaite par le régime mais qu’elle exigeait au contraire l’éviction de Ben Ali, artisan de l’indignité généralisée. Même si de nombreux slogans scandés au cours des manifestations renvoyaient à des préoccupations économiques et démocratiques, la révolution tunisienne a surtout exprimé, me semble-t-il, une volonté de retrouver une certaine estime de soi collective et individuelle.
Vous avez écrit Le délitement de la cité. Coercition, consentement, résistance. Il y a donc eu une rupture de l’équilibre entre ces trois composantes, ce qui aurait créé les conditions de possibilité de la révolution ?
Contrairement à certaines représentations superficielles, la Tunisie n’était pas une société inerte et plutôt satisfaite de son sort. Sauf à dire qu’en dehors des périodes de révolte seule existe une intégration plus ou moins poussée des individus aux mécanismes de domination, il faut bien admettre que cette intégration, pour être souvent réelle, n’exclut pas l’insubordination. La docilité, voire la collaboration avec les dispositifs du pouvoir, s’entremêle elle-même à l’indiscipline, à la transgression ou à des formes de résistance, franches ou masquées, la plupart du temps invisibles parce qu’elles sont individuelles et qu’elles ne prennent pas les formes classiques de l’action revendicative ou politique. Si de nombreux Tunisiens se posaient quotidiennement la question « Comment tirer profit du système ? », beaucoup d’autres, souvent les mêmes, se demandaient aussi comment passer entre les mailles du filet, échapper aux injonctions à la collaboration, voire enrayer la machine. Ainsi de tous ceux qui s’abstiennent, malgré les pressions subies, d’adhérer au RCD ou à l’une de ses organisations satellites, qui « oublient » de contribuer à l’une des caisses de solidarité imposée , Fonds de solidarité nationale, tombola de la police, etc.), qui refusent d’avoir recours à certains intermédiaires obligés pour obtenir un quelconque arrangement professionnel, ou ceux qui se délectent en écoutant un opposant sur Al-Jazeera, ceux qui s’acharnent à contourner les dispositifs de censure sur le Net, ceux qui restent chez eux le jour des grandes cérémonies du RCD dans les villes et les quartiers ou le jour des élections, ceux qui, au bureau, en famille ou avec des amis, rapportent les derniers bons mots ou les rumeurs concernant les turpitudes, supposées ou réelles, des « familles » au pouvoir, ceux qui construisent des réseaux de solidarité familiaux, de voisinage ou régionaux, ces jeunes qui prennent le risque de l’immigration clandestine ou ces autres qui affrontent la police dans les stades. La fuite, l’esquive, le contournement, la rébellion individuelle, et toutes ces formes de sédition moléculaire qui accompagnent les ordres autoritaires, ont connu une progression constante les dernières années du règne de Ben Ali. Pour le voir, il suffisait – d’un strict point de vue méthodologique – d’une moindre fascination pour le pouvoir et ses dispositifs et il fallait davantage d’empathie à l’égard de « ceux d’en bas ».
Par ailleurs, à l’instar des résistances individuelles, les formes collectives de protestation n’ont que rarement retenu l’attention des observateurs. Bien que de façon non-linéaire et malgré la répression à laquelle elles se sont heurtées, les résistances collectives, peu ou pas organisées, se sont développées depuis plus de dix ans. C’est en 1999-2001, au terme d’une décennie de répression et de désarroi, que le mouvement démocratique tunisien a retrouvé une nouvelle vigueur. Le premier signe en fut la fondation du Conseil national des libertés en Tunisie, en décembre 1998, suivie très rapidement par la constitution d’autres associations indépendantes du pouvoir, la redynamisation de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, la grève de la faim très médiatisée en France du journaliste Taoufik Ben Brik, l’activisme des avocats – dont on sait le rôle important dans les mobilisations des dernières semaines du régime de Ben Ali –, les remous au sein de la magistrature, l’action plus résolue de deux des partis de l’opposition légale (PDP[3] et Ettajdid[4]) tandis que se constituaient de nouveaux partis comme le CPR[5] ou le FDTL[6] et que le PCOT et Ennahdha tentaient de se restructurer. Si ces initiatives sont relayées en Tunisie par des médias arabes comme Al-Jazeera et qu’elles contribuent à stimuler d’autres formes de résistance, elles sont demeurées principalement cantonnées aux sphères contestatrices traditionnelles, sans pouvoir attirer de nouvelles générations de militants. Mais si l’on a souvent ironisé sur l’impuissance de ces oppositions et sur la faiblesse de leur emprise sur la population, il n’en demeure pas moins que l’étroite marge de liberté qu’elles ont conquise depuis 1999, malgré les persécutions et la répression, a incontestablement permis de diffuser une information critique au sein d’une opinion publique de plus en plus large, comme elle a favorisé la construction d’espaces et de réseaux de résistance, certes brouillons et aux activités irrégulières, mais non dépourvus cependant de toute efficacité, comme l’a montré leur participation à différentes mobilisations, en particulier celles qui se sont développées depuis le début de la révolution tunisienne[7]. Il convient aussi de souligner l’émergence et la rapide expansion, depuis quelques années, d’une contestation via le réseau Internet, combinées à la généralisation de l’usage des téléphones portables. Malgré la sophistication des instruments de contrôle et de censure du pouvoir, ces nouveaux outils de communication ont également contribué à diffuser de l’information, à créer du réseau et des formes d’organisation virtuelle, qui ont été autant de vecteurs de la contestation démocratique, notamment dans la jeunesse. Mentionnons également l’apparition ces dernières années d’une mouvance islamique radicale, en rupture avec le parti Ennahdha, qui exprime à sa manière un rejet des politiques du régime.
Vous parlez de mouvement social et là, vous ne mentionnez que les partis politiques !
Un peu de patience… j’y viens ! Au réveil du mouvement démocratique, il faut ajouter la reconstitution de ce que, faute de mieux, on appellera le mouvement social et qu’il est difficile de cerner tant les informations concernant ses manifestations sont éparses, voire inaccessibles. Il me semble, pour ma part, que la résurgence des résistances sociales s’est opérée en deux temps. Révoltes de lycéens et de chômeurs dans de nombreuses villes au début des années 2000, grèves organisées dans la fonction publique et dans des entreprises, grèves sauvages et autres mouvements de contestation, notamment dans le textile et dans le secteur touristique, me paraissent être l’expression d’un premier changement par rapport à la décennie précédente. Ce renouveau s’est manifesté de manière particulièrement flagrante à partir de 2008 avec la longue lutte des habitants du bassin minier de Gafsa qui a commencé à s’étendre avant d’être brutalement réprimée. C’est sans doute le tournant majeur. Depuis, en effet, la Tunisie a connu d’autres mouvements de protestation d’une ampleur plus limitée, à Skhira, Feriana, Jebeniana et, durant l’été 2010, à Ben Guerdane, autant de petites villes des régions les plus défavorisées du pays. Enfin, bien sûr, il y a eu Sidi Bouzid. La suite, nous la connaissons… Malgré leur caractère sporadique, la médiatisation faible (voire nulle) dont ils ont fait l’objet, la répression, les défaites ou les compromis boiteux auxquels ils ont abouti, malgré également l’inexistence apparente de liens entre eux, les mouvements sociaux qu’a connus la Tunisie au cours de la dernière décennie ont pourtant participé à la cristallisation d’une ambiance protestataire, à une accumulation d’expériences et à la construction de réseaux ou de liens militants informels dont la révolution tunisienne est le produit.
Ce tableau du mouvement social serait encore plus incomplet qu’il ne l’est sans doute déjà si je ne mentionnais pas les batailles menées au sein de l’UGTT contre l’emprise bureaucratique de son Secrétaire général, Abdessalam Jrad, et contre la subordination de la centrale syndicale au pouvoir. Ces batailles ont permis aux militants les plus combatifs du mouvement syndical de renforcer leur influence dans certains secteurs (postes, enseignement, etc.) ainsi que dans des instances locales et régionales, ce qui a donné la possibilité aux structures de l’UGTT de jouer un rôle important dans la révolution, à l’encontre des positions exprimées par le Secrétaire général, surtout au cours de la dernière semaine de mobilisation. Comme on le sait, la Commission administrative de l’UGTT a fini par apporter son appui aux revendications populaires et des grèves générales décisives pour l’issue du processus révolutionnaire ont été enclenchées, notamment à Tunis et à Sfax.
Est-ce que l’on voit déjà s’ébaucher les lignes de force des évolutions futures ?
S’il est probable que quelques responsables du RCD et de l’armée, peut-être encouragés par des « conseillers » étrangers, aient écrit le scénario des dernières heures de Ben Ali à Tunis et organisé son départ, il ne fait guère de doute cependant que ce scénario n’a été envisagé que sous la pression des mobilisations populaires. Celle-ci a été en mesure également d’imposer le départ des ministres du RCD du premier gouvernement de transition mis en place au lendemain de la fuite de l’ancien président et, plus récemment, la démission du Premier ministre et d’autres membres du gouvernement. Il est prématuré aujourd’hui d’évaluer l’ampleur des bouleversements politiques internes auxquels pourrait conduire la révolution tunisienne, alors que depuis la chute de Moubarak en Égypte et la mobilisation révolutionnaire en Libye, sa portée ne peut plus se mesurer dans les limites des frontières de l’État tunisien. Il me paraît certain, en revanche, qu’une appréhension relativement satisfaisante des évolutions en cours impose de questionner les grilles de lecture qui ont conditionné le regard porté sur la situation tunisienne. Elle impose notamment de porter une attention plus soutenue à ce que l’on pourrait appeler la « politique par le bas », les formes de résistance non-institutionnalisées et, plus généralement, les dynamiques plus ou moins souterraines à l’œuvre au sein des différentes couches de la population. Enfin, s’il ne saurait être question d’isoler chacun des multiples facteurs qui ont déterminé l’explosion populaire en Tunisie ou d’en privilégier un au détriment des autres (difficultés économiques croissantes, poids de l’autoritarisme, etc.), il semble pertinent d’accorder, dans l’étude des processus politiques et des mouvements de contestation, un intérêt plus soutenu à ce facteur insaisissable qu’est le besoin de reconnaissance et de dignité.
[1]. Parti communiste des ouvriers tunisiens, dirigé par Hamma Hammami.
[2]. Ancien Parti socialiste destourien de Bourguiba, récupéré par le régime de Ben Ali.
[3]. Parti démocratique progressiste, dirigé par l’avocat Ahmed Néjib Chebbi, aujourd’hui membre du gouvernement.
[4]. Nouveau nom du Parti communiste tunisien après l’ouverture de ses rangs à des opposants démocrates et laïques
[5]. Congrès pour la république, parti non reconnu par les autorités, fondé en 2001 par l’ancien président de la Ligue tunisienne des droits de l’homme, Moncef Marzouki.
[6]. Forum démocratique pour le travail et les libertés, parti légal fondé en 1994 par Mustapha Ben Jaafar, un ancien dirigeant du Mouvement des démocrates socialistes, issu d’une scission du parti de Bourguiba. Le FDTL est membre de l’Internationale socialiste.
[7]. Les réseaux sociaux ont été investis par des groupes d’action qui ont pu échanger, discuter et coordonner leurs actions au moment de la révolution.