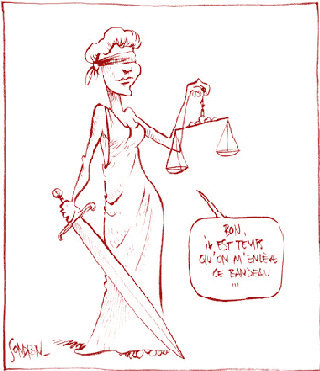La votation suisse interdisant la construction des minarets et la persévérance des élus français dans leur volonté d’interdire le voile intégral dans les lieux publics, sur fond de débat sur l’identité nationale, sont, sans aucun doute, les données d’une campagne menée contre une catégorie de la société que l’on ne définit plus que comme des Musulmans.
Mais je ne pense pas que ces derniers, désignés comme tels dans une acception extensive et pour une bonne part allégorique du terme, aient le moindre intérêt à se défendre en cette qualité. Ils s’exposeraient à jouer à chaque fois perdant. Dans l’affaire des caricatures du prophète, déjà, c’était se fourvoyer que de dénoncer le blasphème alors que l’injure visait des hommes et des femmes et participait de l’incitation à la haine raciale.
Peu nous importe donc que le port du voile intégral découle ou non d’une interprétation correcte du Coran, que le minaret remonte à l’Etat médinois ou à l’époque des Omeyyades.Qu’y aurait-il à tirer de controverses de jurisconsultes ? L’histoire de l’islam nous prouve qu’elles ont toujours tourné à l’avantage des pouvoirs en place. L’Etat français, rompu de longue date à la promotion des élites coloniales, a lui-même ses dignitaires religieux prêts à lui fournir toutes les cautions « savantes » qu’il leur demandera. Il faut rejeter en bloc la référence à un « islam de France », produit dérivé de l’identité nationale française, qui n’annonce que la légitimation des mesures d’interdiction passées et à venir.
La nation pour redéfinir les termes de la représentation
Par ailleurs, il est trop évident que cette nouvelle approche de l’immigration par l’islam est une manœuvre de l’idéologie. Elle s’est trop facilement imposée : il a suffi qu’on ouvre un débat sur l’identité nationale pour qu’il ne soit plus question que de cette religion. Preuve que la nation n’a jamais produit de définition positive d’elle-même et a de tous temps été au service de la désignation d’ennemis. Cette manœuvre vise à n’en point douter à nier des contradictions sensibles de la société et à leur ôter toute charge politique – en les rendant justiciables d’un consensus national/religieux.
Nous sommes dans le prolongement de la thématique de campagne qui a porté Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et qu’il a imposée en martelant des formules telles que « Vive la République et par-dessus tout vive la France ». C’était une combinaison du discours national originel et du plus actuel nationalisme, le premier conférant au second sa légitimité. La nation, définie par « ceux qui se lèvent tôt », ce n’était rien d’autre que l’instrumentalisation anachronique et réactionnaire du discours révolutionnaire. Des formules de Sieyès étaient paraphrasées à contre-emploi :
“Une classe entière de citoyens (…) saurait consumer la meilleure part du produit, sans avoir concouru en rien à le faire naître. Une telle classe est assurément étrangère à la nation par sa fainéantise.”
L’équation assisté/étranger, chère au Front national, était ainsi rationalisée par la référence au mérite et moralisée par la revendication de l’égalité. Dissocié, au premier degré, de toute xénophobie et dédié à la contestation des « privilèges », ce discours pouvait compter sur la perspicacité élémentaire des électeurs : « Ceux qui ne se lèvent pas tôt » étaient ceux-là même qui « n’aiment pas la France ».
La campagne de Sarkozy a été considérée par les « analystes » comme un chef-d’œuvre de cohérence. Quoi de plus républicain que de solliciter le suffrage des citoyens en ne s’adressant jamais qu’à la nation ? Celle-ci n’est-elle pas très exactement la collectivité des citoyens ? En fait, la nation était interpellée dans son acception sélective et les termes du mandat représentatif s’en trouvaient reformulés. Or, c’est la vérité première de la représentation que le mandant ne délègue que pour lui-même. La nation que Sarkozy convoquait aux urnes, celle dont il serait le président, était celle de l’hymne national et du drapeau tricolore, celle du consensus. Les banlieues n’y avaient aucune part car elles ont ce défaut majeur de soulever des thématiques rebelles au consensus que la totalisation nationale ne peut appréhender que comme une pathologie exogène. A peine avaient-elles, aux dires des statistiques électorales, embarqué quelques renforts dans le train de la citoyenneté que celui-ci était désaffecté. Elles étaient vouées à n’être qu’un solde inutilisable de la représentation.
Quelle conception du politique pour quelle articulation sur le droit ?
C’est dire que les données et les enjeux du débat sur l’identité nationale sont avant tout politiques. Mais nous savons bien que le politique est une notion polysémique. Excluons d’emblée ce paradigme idéal qui fait les délices des théoriciens de la science politique entichés de la démocratie grecque. Il se réfère à un espace construit de délibération entre égaux dans lequel les rapports de domination n’auraient pas cours.
Plus probablement, faisons-nous référence au système institutionnalisé par les régimes pluralistes comme le régime français ? Le politique est dans ce cas le mode spécifique de refoulement des rapports de domination qui les déguise en oppositions arbitrables.
A moins qu’il ne s’agisse du politique défini comme relation d’inimitié tel que l’énonce Carl Schmitt, et dans lequel les adversaires deviennent des ennemis entre lesquels aucun arbitrage n’est possible.
Ces deux dernières acceptions du politique se différencient en particulier par leur articulation au droit. Et cela nous ramène à notre premier propos puisque cette irruption de l’identité nationale a actuellement pour manifestation des projets de législation.
L’Etat politique pluraliste a pour fonction historique de rationaliser la domination de classe en proposant à toutes les classes sociales la citoyenneté universelle et l’égalité des individus en droit. C’est l’Etat de droit, qui se dit en France laïc et républicain, et qui se fonde sur « l’opposition entre les spécificités de l’homme privé, membre de la société civile, et l’universalisme du citoyen » (Dominique Schnapper). Bâti à la mesure des oppositions qu’il entend rationaliser, il dispose, dans son fonctionnement le plus équitable possible, dans son respect le plus scrupuleux du droit, de toutes les ressources nécessaires à sa fonction de domination. Libre aux classes assujetties de s’y donner pour horizon des objectifs légaux de réforme (quand elles ne recourent pas à des objectifs de dépassement par la révolution, ce qui est un autre problème).
Cet Etat politique ne peut, dans son essence, se faire l’instrument de la domination de minorités ethniques ou religieuses qu’en la reconvertissant aux données de la domination sociale. A défaut de quoi, dans l’hypothèse où il s’abandonne aux phobies ethniques ou culturalistes, il donnera immanquablement des signes visibles d’atteintes au droit et de dysfonctionnements institutionnels.
Ce qui nous rappelle à l’actualité. La France, et à des degrés divers l’Europe, est animée de la volonté désormais avouée de parer à la menace (imaginaire) de l’islam et nous voyons à l’œuvre deux stratégies : celle que prône la gauche et qui s’appuie sur une vigilance laïque maladive et celle que met en œuvre la droite sarkozienne qui appelle en renfort l’idée nationale – laquelle, ne l’oublions pas, tient sa genèse historique de la guerre des races.
La règle de droit réduite à un accessoire utilitaire
Pour illustrer la différence entre les deux stratégies, je dirai que le spectacle de femmes voilées dans la rue suscitera une réprobation verbalisée à gauche comme le refus de la soumission de la femme et à droite comme la preuve que la France n’est plus ce qu’elle fut. Mais le sentiment profond sera le même dans les deux camps : à travers ces femmes, tous verront se profiler la charia, l’armée des Sarrasins et le califat.
Voilà pourquoi aucune de ces deux stratégies ne s’accomplit sans qu’apparaissent des dysfonctionnements dans le droit. Encore faut-il l’acuité du regard et la radicalité du jugement nécessaires pour les apercevoir. En particulier lorsque la gauche est à la manœuvre.
Car j’entends bien que le souci, que je vais développer, d’une stricte application de la loi ne signifie pas une approbation des slogans de cette gauche ni qu’il faille aller bêler son adhésion à l’Etat laïque et républicain sur toutes les tribunes. Je ne veux m’intéresser aux atteintes au droit qu’en tant que révélateur d’un glissement vers des formes tyranniques. Et je sais que l’alibi laïc et républicain peut, autant que celui de l’identité nationale, constituer un vecteur de ce glissement. C’est d’ailleurs lui qui a justifié l’interdiction du voile à l’école. Quant au débat actuel sur le port du voile intégral, devrait-on applaudir à son interdiction pour un motif de gauche, fondé, comme on a pu l’entendre, sur le précédent de l’interdiction du lancer de nains, pour la seule raison qu’on aurait de ce fait échappé à son interdiction pour un motif de droite, par exemple les traditions de la civilisation européenne ou toute autre stupidité ?
Que l’on considère ce titre du Monde du 12 novembre : « Les obstacles juridiques à l’interdiction du port de la burqa dans l’espace public ». Il suggère que le droit en vigueur n’aurait rien à redire d’un phénomène qui est le simple exercice d’une liberté. Mais il présage de ce qu’on est décidé à lui faire violence pour qu’il en aille désormais autrement. L’article rend compte des objections à l’interdiction telles que les ont formulées des juristes de renom auditionnés par la mission d’information sur « la pratique du port du voile intégral sur le territoire national » : les motifs préconisés ont généralement été réfutés. Un seul juriste, Guy Carcassonne, a proposé que le législateur pose pour principe qu’ « on n’a pas à se dissimuler quand on est en public » parce qu’on doit pouvoir être identifié. Eh bien, c’est par ce trou de sourire qu’on va sans doute faire passer une loi attentatoire à la liberté ! Et on peut parier que, sortis de l’enceinte de l’audition, les collègues de M. Carcassonne remiseront leurs objections par révérence pour ce qui pourrait devenir une « loi de la République ».
Le droit est devenu utilitaire. On s’empare d’un phénomène, d’un comportement ou d’une pratique, dont la légalité n’est pas contestée mais qui offense le regard. On suscite à son propos un débat en le popularisant à coups de sondages. On en fait une question d’appréciation et on interroge les politiques, les stars du cinéma et des variétés : Etes-vous pour l’interdiction de la burqa ? Pensez-vous qu’il faut la limiter aux locaux publics ou l’étendre à la rue ? Alors même que les aspects juridiques du phénomène sont occultés ou confinés dans une stricte confidentialité, on le présente comme anomique au regard des considérations idéologiques les plus diverses et les plus confuses. Et une fois le consensus assuré, car c’est une affaire d’opinion et non de légalité, le législateur est investi de la tâche de le matérialiser en mesure radicale et sans appel.
C’est cette démarche qui avait été adoptée pour interdire le port du voile à l’école. Lorsque le phénomène fut pointé du doigt en France dans les années 1980, on s’empressa de le requalifier : ce qui n’était que l’application individuelle d’une prescription religieuse devint le port d’un signe religieux. Or, arborer un signe, c’est communiquer un message. Dès lors, il ne pouvait relever que de la sémiotique de l’espace public laïc qui a ses experts patentés : on ne vit plus jamais dans les adolescentes voilées que les sémaphores de l’islamisme prosélyte. Contre une liberté religieuse garantie, était née une présomption d’illégalité définitive : lorsque le conseil d’Etat a rappelé en 1989 que le port du voile à l’école était, par référence aux textes les plus fondamentaux de l’Etat laïc (en particulier l’article 10 de la déclaration de 1789 et l’article 9 de la convention européenne), une liberté reconnue aux élèves des écoles publiques, il n’a suscité que réprobation et contrariété. Le droit était révoqué. La prévention que les postulats idéologiques du débat ont fait peser a priori sur cette pratique l’a emporté sur le diagnostic de conformité posé par l’exégète attitré. La qualification juridique appropriée du problème était rejetée comme une complication malvenue et la solution qui en découlait reconvertie en impasse du droit.
Le dérèglement de l’Etat de droit
J’arrive à ce constat simple que le débat juridique est impraticable pour deux raisons :
– Le cadre en est perverti : les lois proposées sont invariablement des interdictions, les mesures de réglementation, fruit du pragmatisme et de la circonspection du droit, ne sont jamais envisagées ; les initiateurs des lois et leurs opposants politiques font cause commune ; les critiques et les exégètes du droit protestent mollement quand ils n’entérinent pas, sous peine d’être désavoués.
– Les catégories de référence sont redéfinies : les lieux publics sont confondus à dessein avec l’espace public ; la « dignité humaine » est mobilisée contre la liberté publique, l’ordre public prétend intégrer les convenances du « vivre ensemble ».
Quant à l’orthodoxie de l’Etat de droit laïc et républicain, celle qui sépare les spécificités de l’homme privé de l’universalisme citoyen, elle subit les effets dévastateurs de deux hérésies entrecroisées puisque l’on fait la chasse aux spécificités dans la société civile au moment où les clivages de l’identité nationale sont ressuscités dans les palais de la République.
Nous sommes bien en présence de dysfonctionnements graves affectant l’Etat de droit dans lequel les normes juridiques ne jouent plus pleinement leur rôle de régulateur et d’arbitre. C’est l’indice que le rapport politique qui se dessine est du type de la relation ami/ennemi. Cependant, ce rapport est délibérément voulu comme inégal puisque l’Etat désigne comme ennemis une religion et ses adeptes dont les différents statuts et libertés n’existent que sous sa juridiction. Or, le rapport politique, dans toutes les acceptions du politique que nous avons dénombrées, est un rapport entre égaux : une égalité de statut entre « pairs » dans le modèle de l’isonomie grecque, une égalité formelle reconnue par la loi dans l’Etat politique pluraliste, une reconnaissance mutuelle des acteurs en tant qu’ennemis dans la relation amis/ennemis.
Le type de sujétion politique qui se dessine ainsi entre la nation et une entité minoritaire définie en termes religieux est donc un rapport unilatéral d’intimidation dans lequel le droit devient violence : les libertés individuelles et collectives de la minorité y sont appelées à subir des formes discriminatoires de coercition. Cependant, la minorité religieuse n’étant désignée qu’en tant que substitut expiatoire des catégories sociales ciblées (constituées par l’ensemble de l’immigration post-coloniale), la requalification du conflit et le rééquilibrage des forces dépendront de la volonté et de la combativité de ces catégories(Qu’y aurait-il à tirer de controverses de jurisconsultes ? L’histoire de l’islam nous prouve qu’elles ont toujours tourné à l’avantage des pouvoirs en place. L’Etat français, rompu de longue date à la promotion des élites coloniales, a lui-même ses dignitaires religieux prêts à lui fournir toutes les cautions « savantes » qu’il leur demandera. Il faut rejeter en bloc la référence à un « islam de France », produit dérivé de l’identité nationale française, qui n’annonce que la légitimation des mesures d’interdiction passées et à venir.
La nation pour redéfinir les termes de la représentation
Par ailleurs, il est trop évident que cette nouvelle approche de l’immigration par l’islam est une manœuvre de l’idéologie. Elle s’est trop facilement imposée : il a suffi qu’on ouvre un débat sur l’identité nationale pour qu’il ne soit plus question que de cette religion. Preuve que la nation n’a jamais produit de définition positive d’elle-même et a de tous temps été au service de la désignation d’ennemis. Cette manœuvre vise à n’en point douter à nier des contradictions sensibles de la société et à leur ôter toute charge politique – en les rendant justiciables d’un consensus national/religieux.
Nous sommes dans le prolongement de la thématique de campagne qui a porté Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et qu’il a imposée en martelant des formules telles que « Vive la République et par-dessus tout vive la France ». C’était une combinaison du discours national originel et du plus actuel nationalisme, le premier conférant au second sa légitimité. La nation, définie par « ceux qui se lèvent tôt », ce n’était rien d’autre que l’instrumentalisation anachronique et réactionnaire du discours révolutionnaire. Des formules de Sieyès étaient paraphrasées à contre-emploi :
Une classe entière de citoyens (…) saurait consumer la meilleure part du produit, sans avoir concouru en rien à le faire naître. Une telle classe est assurément étrangère à la nation par sa fainéantise.
L’équation assisté/étranger, chère au Front national, était ainsi rationalisée par la référence au mérite et moralisée par la revendication de l’égalité. Dissocié, au premier degré, de toute xénophobie et dédié à la contestation des « privilèges », ce discours pouvait compter sur la perspicacité élémentaire des électeurs : « Ceux qui ne se lèvent pas tôt » étaient ceux-là même qui « n’aiment pas la France ».
La campagne de Sarkozy a été considérée par les « analystes » comme un chef-d’œuvre de cohérence. Quoi de plus républicain que de solliciter le suffrage des citoyens en ne s’adressant jamais qu’à la nation ? Celle-ci n’est-elle pas très exactement la collectivité des citoyens ? En fait, la nation était interpellée dans son acception sélective et les termes du mandat représentatif s’en trouvaient reformulés. Or, c’est la vérité première de la représentation que le mandant ne délègue que pour lui-même. La nation que Sarkozy convoquait aux urnes, celle dont il serait le président, était celle de l’hymne national et du drapeau tricolore, celle du consensus. Les banlieues n’y avaient aucune part car elles ont ce défaut majeur de soulever des thématiques rebelles au consensus que la totalisation nationale ne peut appréhender que comme une pathologie exogène. A peine avaient-elles, aux dires des statistiques électorales, embarqué quelques renforts dans le train de la citoyenneté que celui-ci était désaffecté. Elles étaient vouées à n’être qu’un solde inutilisable de la représentation.
Quelle conception du politique pour quelle articulation sur le droit ?
C’est dire que les données et les enjeux du débat sur l’identité nationale sont avant tout politiques. Mais nous savons bien que le politique est une notion polysémique. Excluons d’emblée ce paradigme idéal qui fait les délices des théoriciens de la science politique entichés de la démocratie grecque. Il se réfère à un espace construit de délibération entre égaux dans lequel les rapports de domination n’auraient pas cours.
Plus probablement, faisons-nous référence au système institutionnalisé par les régimes pluralistes comme le régime français ? Le politique est dans ce cas le mode spécifique de refoulement des rapports de domination qui les déguise en oppositions arbitrables.
A moins qu’il ne s’agisse du politique défini comme relation d’inimitié tel que l’énonce Carl Schmitt, et dans lequel les adversaires deviennent des ennemis entre lesquels aucun arbitrage n’est possible.
Ces deux dernières acceptions du politique se différencient en particulier par leur articulation au droit. Et cela nous ramène à notre premier propos puisque cette irruption de l’identité nationale a actuellement pour manifestation des projets de législation.
L’Etat politique pluraliste a pour fonction historique de rationaliser la domination de classe en proposant à toutes les classes sociales la citoyenneté universelle et l’égalité des individus en droit. C’est l’Etat de droit, qui se dit en France laïc et républicain, et qui se fonde sur « l’opposition entre les spécificités de l’homme privé, membre de la société civile, et l’universalisme du citoyen » (Dominique Schnapper). Bâti à la mesure des oppositions qu’il entend rationaliser, il dispose, dans son fonctionnement le plus équitable possible, dans son respect le plus scrupuleux du droit, de toutes les ressources nécessaires à sa fonction de domination. Libre aux classes assujetties de s’y donner pour horizon des objectifs légaux de réforme (quand elles ne recourent pas à des objectifs de dépassement par la révolution, ce qui est un autre problème).
Cet Etat politique ne peut, dans son essence, se faire l’instrument de la domination de minorités ethniques ou religieuses qu’en la reconvertissant aux données de la domination sociale. A défaut de quoi, dans l’hypothèse où il s’abandonne aux phobies ethniques ou culturalistes, il donnera immanquablement des signes visibles d’atteintes au droit et de dysfonctionnements institutionnels.
Ce qui nous rappelle à l’actualité. La France, et à des degrés divers l’Europe, est animée de la volonté désormais avouée de parer à la menace (imaginaire) de l’islam et nous voyons à l’œuvre deux stratégies : celle que prône la gauche et qui s’appuie sur une vigilance laïque maladive et celle que met en œuvre la droite sarkozienne qui appelle en renfort l’idée nationale – laquelle, ne l’oublions pas, tient sa genèse historique de la guerre des races.
La règle de droit réduite à un accessoire utilitaire
Pour illustrer la différence entre les deux stratégies, je dirai que le spectacle de femmes voilées dans la rue suscitera une réprobation verbalisée à gauche comme le refus de la soumission de la femme et à droite comme la preuve que la France n’est plus ce qu’elle fut. Mais le sentiment profond sera le même dans les deux camps : à travers ces femmes, tous verront se profiler la charia, l’armée des Sarrasins et le califat.
Voilà pourquoi aucune de ces deux stratégies ne s’accomplit sans qu’apparaissent des dysfonctionnements dans le droit. Encore faut-il l’acuité du regard et la radicalité du jugement nécessaires pour les apercevoir. En particulier lorsque la gauche est à la manœuvre.
Car j’entends bien que le souci, que je vais développer, d’une stricte application de la loi ne signifie pas une approbation des slogans de cette gauche ni qu’il faille aller bêler son adhésion à l’Etat laïque et républicain sur toutes les tribunes. Je ne veux m’intéresser aux atteintes au droit qu’en tant que révélateur d’un glissement vers des formes tyranniques. Et je sais que l’alibi laïc et républicain peut, autant que celui de l’identité nationale, constituer un vecteur de ce glissement. C’est d’ailleurs lui qui a justifié l’interdiction du voile à l’école. Quant au débat actuel sur le port du voile intégral, devrait-on applaudir à son interdiction pour un motif de gauche, fondé, comme on a pu l’entendre, sur le précédent de l’interdiction du lancer de nains, pour la seule raison qu’on aurait de ce fait échappé à son interdiction pour un motif de droite, par exemple les traditions de la civilisation européenne ou toute autre stupidité ?
Que l’on considère ce titre du Monde du 12 novembre : « Les obstacles juridiques à l’interdiction du port de la burqa dans l’espace public ». Il suggère que le droit en vigueur n’aurait rien à redire d’un phénomène qui est le simple exercice d’une liberté. Mais il présage de ce qu’on est décidé à lui faire violence pour qu’il en aille désormais autrement. L’article rend compte des objections à l’interdiction telles que les ont formulées des juristes de renom auditionnés par la mission d’information sur « la pratique du port du voile intégral sur le territoire national » : les motifs préconisés ont généralement été réfutés. Un seul juriste, Guy Carcassonne, a proposé que le législateur pose pour principe qu’ « on n’a pas à se dissimuler quand on est en public » parce qu’on doit pouvoir être identifié. Eh bien, c’est par ce trou de sourire qu’on va sans doute faire passer une loi attentatoire à la liberté ! Et on peut parier que, sortis de l’enceinte de l’audition, les collègues de M. Carcassonne remiseront leurs objections par révérence pour ce qui pourrait devenir une « loi de la République ».
Le droit est devenu utilitaire. On s’empare d’un phénomène, d’un comportement ou d’une pratique, dont la légalité n’est pas contestée mais qui offense le regard. On suscite à son propos un débat en le popularisant à coups de sondages. On en fait une question d’appréciation et on interroge les politiques, les stars du cinéma et des variétés : Etes-vous pour l’interdiction de la burqa ? Pensez-vous qu’il faut la limiter aux locaux publics ou l’étendre à la rue ? Alors même que les aspects juridiques du phénomène sont occultés ou confinés dans une stricte confidentialité, on le présente comme anomique au regard des considérations idéologiques les plus diverses et les plus confuses. Et une fois le consensus assuré, car c’est une affaire d’opinion et non de légalité, le législateur est investi de la tâche de le matérialiser en mesure radicale et sans appel.
C’est cette démarche qui avait été adoptée pour interdire le port du voile à l’école. Lorsque le phénomène fut pointé du doigt en France dans les années 1980, on s’empressa de le requalifier : ce qui n’était que l’application individuelle d’une prescription religieuse devint le port d’un signe religieux. Or, arborer un signe, c’est communiquer un message. Dès lors, il ne pouvait relever que de la sémiotique de l’espace public laïc qui a ses experts patentés : on ne vit plus jamais dans les adolescentes voilées que les sémaphores de l’islamisme prosélyte. Contre une liberté religieuse garantie, était née une présomption d’illégalité définitive : lorsque le conseil d’Etat a rappelé en 1989 que le port du voile à l’école était, par référence aux textes les plus fondamentaux de l’Etat laïc (en particulier l’article 10 de la déclaration de 1789 et l’article 9 de la convention européenne), une liberté reconnue aux élèves des écoles publiques, il n’a suscité que réprobation et contrariété. Le droit était révoqué. La prévention que les postulats idéologiques du débat ont fait peser a priori sur cette pratique l’a emporté sur le diagnostic de conformité posé par l’exégète attitré. La qualification juridique appropriée du problème était rejetée comme une complication malvenue et la solution qui en découlait reconvertie en impasse du droit.
Le dérèglement de l’Etat de droit
J’arrive à ce constat simple que le débat juridique est impraticable pour deux raisons :
– Le cadre en est perverti : les lois proposées sont invariablement des interdictions, les mesures de réglementation, fruit du pragmatisme et de la circonspection du droit, ne sont jamais envisagées ; les initiateurs des lois et leurs opposants politiques font cause commune ; les critiques et les exégètes du droit protestent mollement quand ils n’entérinent pas, sous peine d’être désavoués.
– Les catégories de référence sont redéfinies : les lieux publics sont confondus à dessein avec l’espace public ; la « dignité humaine » est mobilisée contre la liberté publique, l’ordre public prétend intégrer les convenances du « vivre ensemble ».
Quant à l’orthodoxie de l’Etat de droit laïc et républicain, celle qui sépare les spécificités de l’homme privé de l’universalisme citoyen, elle subit les effets dévastateurs de deux hérésies entrecroisées puisque l’on fait la chasse aux spécificités dans la société civile au moment où les clivages de l’identité nationale sont ressuscités dans les palais de la République.
Nous sommes bien en présence de dysfonctionnements graves affectant l’Etat de droit dans lequel les normes juridiques ne jouent plus pleinement leur rôle de régulateur et d’arbitre. C’est l’indice que le rapport politique qui se dessine est du type de la relation ami/ennemi. Cependant, ce rapport est délibérément voulu comme inégal puisque l’Etat désigne comme ennemis une religion et ses adeptes dont les différents statuts et libertés n’existent que sous sa juridiction. Or, le rapport politique, dans toutes les acceptions du politique que nous avons dénombrées, est un rapport entre égaux : une égalité de statut entre « pairs » dans le modèle de l’isonomie grecque, une égalité formelle reconnue par la loi dans l’Etat politique pluraliste, une reconnaissance mutuelle des acteurs en tant qu’ennemis dans la relation amis/ennemis.
Le type de sujétion politique qui se dessine ainsi entre la nation et une entité minoritaire définie en termes religieux est donc un rapport unilatéral d’intimidation dans lequel le droit devient violence : les libertés individuelles et collectives de la minorité y sont appelées à subir des formes discriminatoires de coercition. Cependant, la minorité religieuse n’étant désignée qu’en tant que substitut expiatoire des catégories sociales ciblées (constituées par l’ensemble de l’immigration post-coloniale), la requalification du conflit et le rééquilibrage des forces dépendront de la volonté et de la combativité de ces catégories*.
Il reste à dégager un critère d’identification des dysfonctionnements de l’Etat de droit provoqués par ce rapport unilatéral d’intimidation instauré par l’Etat à l’égard de la minorité qu’il désigne comme des Musulmans.
« La situation élémentaire du bandit »
Pour ce faire, je m’inspirerai de l’exemple extrême de la votation suisse du 29 novembre interdisant la construction des minarets. On a eu beau jeu de la condamner en France et de s’en démarquer. En réalité, l’opinion publique, formée à la toute récente révélation de son identité nationale, l’a approuvée. D’autre part, entre les entraves mises par les municipalités, les pétitions de voisins et les surenchères électorales de l’extrême-droite, la construction d’une mosquée en France, avec ou sans minarets, demeure une entreprise qui requiert quelques décennies, de l’abnégation et une certaine insensibilité aux humiliations.
Il n’en reste pas moins que la votation suisse est l’image forte, caricaturale de ce nouveau rapport unilatéral d’intimidation que certains Etats européens imposent aux Musulmans.
S’exprimant dans une telle brutalité du rapport de forces, elle évoque la métaphore de l’ « ordre du bandit » dont des théoriciens du droit, Kelsen et surtout Hart, se sont inspirés pour caractériser a contrario la norme juridique.
L’Anglais Hart est parti de ce qu’il appelle « la situation élémentaire du bandit », dans laquelle un malfaiteur prend un groupe de personnes sous sa coupe et les contraint à exécuter ses injonctions. Par touches successives, il a ensuite modifié cette situation pour aboutir à ce que doit être le rapport juridique. Il a observé qu’il ne suffisait pas qu’un commandement émane d’une autorité supérieure et indépendante pour constituer une norme juridique car « une bande de brigands » bien organisée se caractérise, autant qu’un Etat, par une telle suprématie.
C’est son caractère général et permanent qui fait la règle de droit. La permanence est cette qualité de la loi générale établie qui appréhende les cas particuliers comme des faits ou des situations accomplis auxquels elle doit s’appliquer sans que soit requis le renfort d’une loi dérogatoire potentiellement discriminatoire.
La métaphore du gangster est bien sûr utilisée par Hart comme une prémisse purement théorique de son raisonnement. J’entends pour ma part m’en saisir comme le modèle théorique de référence vers lequel tend le fonctionnement de l’Etat de droit au fur et à mesure qu’il retire, de façon discriminatoire, ses garanties aux droits et libertés. Et la votation suisse du 29 novembre, qui interdit pour l’avenir la construction de minarets, alors même qu’elle laisse la possibilité de dresser par exemple de nouveaux clochers, est une régression du droit vers « la situation élémentaire du bandit » décrite par Hart. Elle signale un retour de l’Etat de droit vers les formes primitives de la tyrannie.
Cette votation est un acte de démocratie directe qui dénature la démocratie, un exercice de citoyenneté qui anéantit l’égalité entre les citoyens. Marx écrivait que « l’homme s’émancip(ait) politiquement de la religion en la rejetant du droit public dans le droit privé » et que, ce faisant, il constituait la séparation du politique et du civil, du public et du privé comme une « sophistique de l’Etat politique ». Nous avons là un signe spectaculaire de la dissipation de ces faux-semblants de l’Etat politique et laïc qu’il avait analysés. Lorsque la communauté des citoyens utilise les ressources institutionnelles d’un Etat contre une minorité religieuse qui vit en son sein, elle ruine les fondements de l’organisation politique. Car elle ne peut stigmatiser cette minorité en tant qu’entité religieuse sans se définir elle-même comme telle.
Certains ont soutenu que l’interdiction des minarets n’attentait pas à la liberté religieuse, liberté fondamentale attachée aux individus et considérée comme inviolable par la doctrine de l’Etat de droit. Voulaient-ils par là minimiser une atteinte à la liberté du culte, au prétexte qu’elle ne serait qu’une liberté collective de second ordre ? Et ne voyaient-ils pas que les slogans brandis par le parti initiateur de la votation populaire, rebaptisant l’exercice du culte musulman « revendication politico-religieuse du pouvoir » dont le minaret serait le « symbole apparent », trahissaient le rejet de toute une communauté ?
Nous tenons là un motif à redoubler la métaphore du bandit : cette votation populaire qui s’en prend aux minarets en ciblant en fait une religion qu’ils symbolisent s’apparente dans sa démarche à l’action d’une bande de gangsters qui brisent la devanture d’un magasin pour signifier au commerçant qu’il est indésirable dans le quartier.
On objectera : un référendum d’initiative populaire, quintessence de la procédure démocratique, peut-il sérieusement être ainsi qualifié ? Je répondrai sans hésiter par l’affirmative. Le peuple soi-même, en corps et en majesté, ne peut s’affranchir du respect des droits fondamentaux. Il ne peut provoquer un pareil court-circuit dans la mécanique complexe de la légalité au prétexte qu’il dispose des moyens de se substituer à ses représentants à tous les échelons de l’édifice fédéral et de dicter sa volonté au niveau où aucun recours n’est possible : la constitution. Je me mets docilement, ce disant, à l’école des précurseurs de l’Etat de droit. Ce sont eux qui ont posé que la loi qui s’applique aux libertés ne saurait être une volonté absolutiste, car le législateur, fût-il le peuple souverain, est tenu par ses propres lois, à défaut de quoi il devient aussi despotique qu’un monarque. D’ailleurs, le plus illustre des citoyens suisses, J.J. Rousseau, entendait que la volonté générale limite son expression aux normes à caractère général. Il avait prévenu :
Il n’est pas bon (…) que le corps du peuple détourne son attention des vues générales, pour la donner aux objets particuliers. Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques.
On aura constaté que la votation suisse a suscité une large réprobation. Un référendum d’initiative populaire est un procédé si ostentatoire. Le bandit a dicté son ordre à visage découvert et le coup de main avait été monté par un parti soigneusement étiqueté d’extrême-droite. Laïcs et républicains avaient beau jeu de s’arroger l’honneur et le devoir de le dénoncer. Mais ont-ils réagi aussi vivement à la récente annonce de l’interdiction du voile intégral par un autre parti d’extrême-droite dans les espaces publics de la municipalité italienne de Montegrotto Terme, pour ce même motif d’ « identification » qui semble avoir la préférence des élus français ?
Au regard de la brutalité de la méthode suisse, la « situation élémentaire du bandit » s’est subtilement ramifiée en France et les ordres que celui-ci y donne, bien que tout aussi impérieux, sont absous par des réseaux de légitimation au-dessus de tout soupçon. La dérive du droit s’en trouve confortée par le plus sûr des complices : l’indifférence.).
Il reste à dégager un critère d’identification des dysfonctionnements de l’Etat de droit provoqués par ce rapport unilatéral d’intimidation instauré par l’Etat à l’égard de la minorité qu’il désigne comme des Musulmans.
« La situation élémentaire du bandit »
Pour ce faire, je m’inspirerai de l’exemple extrême de la votation suisse du 29 novembre interdisant la construction des minarets. On a eu beau jeu de la condamner en France et de s’en démarquer. En réalité, l’opinion publique, formée à la toute récente révélation de son identité nationale, l’a approuvée. D’autre part, entre les entraves mises par les municipalités, les pétitions de voisins et les surenchères électorales de l’extrême-droite, la construction d’une mosquée en France, avec ou sans minarets, demeure une entreprise qui requiert quelques décennies, de l’abnégation et une certaine insensibilité aux humiliations.
Il n’en reste pas moins que la votation suisse est l’image forte, caricaturale de ce nouveau rapport unilatéral d’intimidation que certains Etats européens imposent aux Musulmans.
S’exprimant dans une telle brutalité du rapport de forces, elle évoque la métaphore de l’ « ordre du bandit » dont des théoriciens du droit, Kelsen et surtout Hart, se sont inspirés pour caractériser a contrario la norme juridique.
L’Anglais Hart est parti de ce qu’il appelle « la situation élémentaire du bandit », dans laquelle un malfaiteur prend un groupe de personnes sous sa coupe et les contraint à exécuter ses injonctions. Par touches successives, il a ensuite modifié cette situation pour aboutir à ce que doit être le rapport juridique. Il a observé qu’il ne suffisait pas qu’un commandement émane d’une autorité supérieure et indépendante pour constituer une norme juridique car « une bande de brigands » bien organisée se caractérise, autant qu’un Etat, par une telle suprématie.
C’est son caractère général et permanent qui fait la règle de droit. La permanence est cette qualité de la loi générale établie qui appréhende les cas particuliers comme des faits ou des situations accomplis auxquels elle doit s’appliquer sans que soit requis le renfort d’une loi dérogatoire potentiellement discriminatoire.
La métaphore du gangster est bien sûr utilisée par Hart comme une prémisse purement théorique de son raisonnement. J’entends pour ma part m’en saisir comme le modèle théorique de référence vers lequel tend le fonctionnement de l’Etat de droit au fur et à mesure qu’il retire, de façon discriminatoire, ses garanties aux droits et libertés. Et la votation suisse du 29 novembre, qui interdit pour l’avenir la construction de minarets, alors même qu’elle laisse la possibilité de dresser par exemple de nouveaux clochers, est une régression du droit vers « la situation élémentaire du bandit » décrite par Hart. Elle signale un retour de l’Etat de droit vers les formes primitives de la tyrannie.
Cette votation est un acte de démocratie directe qui dénature la démocratie, un exercice de citoyenneté qui anéantit l’égalité entre les citoyens. Marx écrivait que « l’homme s’émancip(ait) politiquement de la religion en la rejetant du droit public dans le droit privé » et que, ce faisant, il constituait la séparation du politique et du civil, du public et du privé comme une « sophistique de l’Etat politique ». Nous avons là un signe spectaculaire de la dissipation de ces faux-semblants de l’Etat politique et laïc qu’il avait analysés. Lorsque la communauté des citoyens utilise les ressources institutionnelles d’un Etat contre une minorité religieuse qui vit en son sein, elle ruine les fondements de l’organisation politique. Car elle ne peut stigmatiser cette minorité en tant qu’entité religieuse sans se définir elle-même comme telle.
Certains ont soutenu que l’interdiction des minarets n’attentait pas à la liberté religieuse, liberté fondamentale attachée aux individus et considérée comme inviolable par la doctrine de l’Etat de droit. Voulaient-ils par là minimiser une atteinte à la liberté du culte, au prétexte qu’elle ne serait qu’une liberté collective de second ordre ? Et ne voyaient-ils pas que les slogans brandis par le parti initiateur de la votation populaire, rebaptisant l’exercice du culte musulman « revendication politico-religieuse du pouvoir » dont le minaret serait le « symbole apparent », trahissaient le rejet de toute une communauté ?
Nous tenons là un motif à redoubler la métaphore du bandit : cette votation populaire qui s’en prend aux minarets en ciblant en fait une religion qu’ils symbolisent s’apparente dans sa démarche à l’action d’une bande de gangsters qui brisent la devanture d’un magasin pour signifier au commerçant qu’il est indésirable dans le quartier.
On objectera : un référendum d’initiative populaire, quintessence de la procédure démocratique, peut-il sérieusement être ainsi qualifié ? Je répondrai sans hésiter par l’affirmative. Le peuple soi-même, en corps et en majesté, ne peut s’affranchir du respect des droits fondamentaux. Il ne peut provoquer un pareil court-circuit dans la mécanique complexe de la légalité au prétexte qu’il dispose des moyens de se substituer à ses représentants à tous les échelons de l’édifice fédéral et de dicter sa volonté au niveau où aucun recours n’est possible : la constitution. Je me mets docilement, ce disant, à l’école des précurseurs de l’Etat de droit. Ce sont eux qui ont posé que la loi qui s’applique aux libertés ne saurait être une volonté absolutiste, car le législateur, fût-il le peuple souverain, est tenu par ses propres lois, à défaut de quoi il devient aussi despotique qu’un monarque. D’ailleurs, le plus illustre des citoyens suisses, J.J. Rousseau, entendait que la volonté générale limite son expression aux normes à caractère général. Il avait prévenu :
“Il n’est pas bon (…) que le corps du peuple détourne son attention des vues générales, pour la donner aux objets particuliers. Rien n’est plus dangereux que l’influence des intérêts privés dans les affaires publiques.”
On aura constaté que la votation suisse a suscité une large réprobation. Un référendum d’initiative populaire est un procédé si ostentatoire. Le bandit a dicté son ordre à visage découvert et le coup de main avait été monté par un parti soigneusement étiqueté d’extrême-droite. Laïcs et républicains avaient beau jeu de s’arroger l’honneur et le devoir de le dénoncer. Mais ont-ils réagi aussi vivement à la récente annonce de l’interdiction du voile intégral par un autre parti d’extrême-droite dans les espaces publics de la municipalité italienne de Montegrotto Terme, pour ce même motif d’ « identification » qui semble avoir la préférence des élus français ?
Au regard de la brutalité de la méthode suisse, la « situation élémentaire du bandit » s’est subtilement ramifiée en France et les ordres que celui-ci y donne, bien que tout aussi impérieux, sont absous par des réseaux de légitimation au-dessus de tout soupçon. La dérive du droit s’en trouve confortée par le plus sûr des complices : l’indifférence.
Khaled Satour
Auteurs cités :
H.L.A. Hart, Le concept de droit, FU De St Louis, 1976, pp. 31-38.
Dominique Schnapper, Qu’est-ce que la citoyenneté, Gallimard, 2000, p. 27.
J.J. Rousseau, Du contrat social, livre III, chapitre IV.
K. Marx, La question juive, Edition électronique, (bibliothèque.uqac.uquebec.ca)
p. 16.
E. Sieyès, Qu’est-ce que le tiers état, 1789.
SOURCE : Contredit