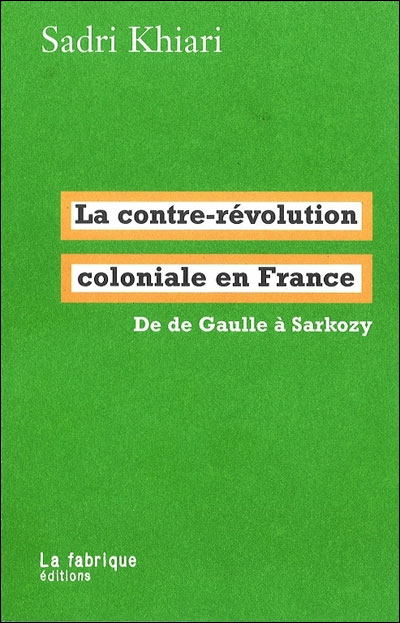Dans ces conditions, la contrariété des élus communistes face à l’afflux d’immigrés (surtout algériens et marocains, à cette époque) dans leurs communes n’a rien de surprenant. Car la présence des immigrés fait baisser la valeur sociale et symbolique de la ville. Ils sont non seulement arabes mais, de surcroît, condamnés à faire partie des couches subalternes de la classe ouvrière, dont se désintéressent largement le PCF et son bras syndical, la CGT. J’ai écrit « contrariété » un peu par politesse. En fait, j’aurais dû dire: ils sont fous de rage! Tous ces bougnoules, misérables, qui vivent n’importe comment, tirent la commune vers le bas. Et il y a d’autant moins de raisons de les accueillir qu’ils vont coûter plein de fric. En plus, il n’y a rien à attendre d’eux sur le plan électoral puisqu’ils n’ont pas le droit de vote! C’est ce que pense alors un élu communiste avant de fermer la porte au nez d’un ménage immigré qui souhaite être relogé dans un HLM. Dès le début des années 1960, relayée par le PCF, la résistance blanche s’exprime déjà par la volonté d’écarter et de distribuer dans l’ensemble de l’espace urbain tous ceux dont la présence, trop visible, souille la ville. A la fin de la décennie et dans le courant des années suivantes, tandis que le gouvernement multiplie les décisions destinées à faire porter sur les communes de gauche le poids financier des logements sociaux et la charge de l’accueil des étrangers, la question de l’immigration et, plus particulièrement, des indigènes obsède les élus communistes. Ceux-ci mènent alors campagne pour s’opposer à l’installation sur leurs communes d’immigrés dont ils réclament la dispersion. Sans employer le terme, ils revendiquent, en 1969, la « préférence nationale »: « A l’heure où des centaines de milliers de familles françaises attendent un logement, le financement du relogement des travailleurs immigrés ne peut et ne doit en aucun cas être à la charge du budget communal. » Le fardeau symbolique, politique et budgétaire que représentent les immigrés est ainsi un enjeu de la lutte entre gouvernement de droite et élus communistes, entre villes rouges et villes bourgeoises. A juste titre, il est vrai, les responsables du PCF appréhendent les immigrés comme un boulet que la droite leur balance dans les pattes. Et le prolétariat blanc s’en défend.
Sous le couvert de prétextes sociaux, d’alibis « antiracistes » ou au nom de la « défense des travailleurs immigrés contre les marchands de sommeil», eux-mêmes souvent immigrés, les communistes veulent purger leurs villes du « surplus» d’indigènes. Un tract diffusé à Gennevilliers en 1973 ne fait d’ailleurs pas mystère de la volonté de mobiliser les « bons Français » contre l’immigration: «Nous appelons la population tout entière à soutenir l’action du conseil municipal pour stopper d’abord et réduire ensuite le pourcentage de l’immigration dans notre ville. » Le PCF adoptera graduellement un langage moins explicite, mais il ne changera guère de politique au cours des décennies suivantes. Il perdra ses principaux bastions urbains, mais ses successeurs de la droite ou du PS, qui rivaliseront d’efforts pour miner la « conscience ouvrière » et disloquer les espaces de résistance, se feront également les porte-parole des couches populaires blanches paniquées par leur déclassement social et statutaire, aggravé par les bouleversements économiques et les métamorphoses du champ politique. Car, avec la décomposition de la puissance politique indépendante de la classe ouvrière et des organes qui la représentent, ce qui se joue, ce n’est pas seulement le démantèlement des acquis sociaux, c’est en même temps leur statut de citoyen. Citoyenneté sociale dans l’entreprise, citoyenneté « urbaine », enracinée dans les municipalités, citoyenneté politique à travers leurs représentations parlementaires, les travailleurs perdent peu à peu la plupart des médiations qu’ils ont conquises et qui leur permettaient de n’être pas simple «force de travail» mais plus que cela: corps politique indépendant, nation dans la nation, avenir de la nation. Le suffrage universel lui-même perd sa signification. En d’autres termes, ce qui se délite avec la fin de l’État-providence et que s’effiloche une citoyenneté médiée à la fois par l’État et les institutions propres à la classe ouvrière, ce sont deux choses: d’une part leur intégration dans l’Etat-national et, d’autre part, leur dignité en tant que communauté de travailleurs. La nationalité se vide de tout contenu social et citoyen, sinon par rapport à ceux qui ne sont pas nationaux ou considérés comme tels; elle n’a plus, ou plutôt elle tend à ne plus avoir pour seule dimension que la « francité », mélange instable des mythes historiques confectionnés par la IIIe République et d’une ferme croyance en la supériorité européenne, chrétienne et blanche. La nationalité décitoyennisée fait alors voir son noyau racial; la « blanchitude » est le dernier privilège accordé par la République aux classes populaires blanches. Et ce privilège d’être « bien français» et « bien blanc» doit absolument être protégé contre les hordes indigènes qui s’emparent de la France.
Cet enjeu devient d’autant plus crucial dans les zones urbaines périphériques que s’en échapper tient de plus en plus souvent du rêve inaccessible. Pauvreté, chômage, précarité, hausse générale des loyers et du foncier interdisent à de nombreux habitants des quartiers populaires, y compris aux couches supérieures de la classe ouvrière, tout espoir de relogement ou d’accession à la propriété dans des espaces résidentiels mieux lotis. Plus: des secteurs qui avaient autrefois les moyens de dédaigner les logements sociaux sont désormais contraints d’y avoir recours. L’aggravation des différenciations internes au monde du travail et des différenciations au sein du parc social, consécutive notamment au désengagement graduel de l’État et à l’adoption de normes managériales de gestions du logement social, contribue à confiner les couches les plus vulnérables du prolétariat blanc dans les segments urbains les plus défavorisés, caractérisés par une présence de plus en plus massive d’indigènes. La fuite n’étant plus guère possible, il ne reste plus au prolétariat blanc qu’à défendre mordicus sa supériorité statutaire.
Olivier Masclet a publié un long ouvrage, particulièrement révélateur, où il analyse les processus urbains à travers lesquels certaines couches des classes populaires s’engagent dans la résistance blanche. Je suis tenté d’en citer un long passage: « L’éventualité que certains ménages français quittent ces immeubles au cas où leur « aspect arabe » s’accentuerait ne constitue qu’un aspect de la pression qui s’exerce sur les responsables de l’Office. Elle se manifeste aussi et peut-être surtout sur le terrain électoral. Les bâtiments Lénine et Diderot sont de ceux qui à Gennevilliers fournissent au Front national le plus de suffrages (avec les immeubles en accession à la copropriété). Ces électeurs ne sont pas seulement perdus pour la municipalité, ils sont aussi les portes-parole de « la cause sécuritaire » qui s’est peu à peu imposée à l’ensemble des locataires. Contraints de vivre à proximité de bâtiments peuplés de familles immigrées, se sentant menacés par des jeunes qui « traînent » près de chez eux, les locataires français des bâtiments municipaux font en permanence état de leur peur et de leur ressentiment. Le maintien des ménages français dotés de revenus moyens et le tri des locataires ont en effet pour autre conséquence d’accroître le sentiment de vulnérabilité, voire les dispositions répressives des Français captifs. Le rassemblement de retraités, de femmes seules, de ménages ouvriers pauvres, de Français aux revenus moyens qui n’ont pas pu suivre la trajectoire collective de sortie des HLM aboutit à coaliser en une même expression de rejet des Arabes les ressentiments engendrés par le vieillissement, la précarisation de la condition salariale, le dénuement familial, l’élévation des normes de consommation en matière d’habitat, la solitude. A la manière d’un « effet pervers », ce durcissement des opinions résulte d’une politique de sélection des ménages qui tente de préserver la valeur sociale du quartier. Il oblige alors la municipalité à transformer ces immeubles en de véritables ‘bunkers » pour protéger leurs occupants des « risques » de l’environnement. » On aura compris que « l’environnement », ce sont les indigènes!
Les classes populaires blanches vivent ainsi la présence des immigrés dans leur « environnement » comme un déclassement statutaire, d’autant plus difficile à vivre qu’elles ont multiplié les sacrifices dans l’espoir vain de ressembler aux classes moyennes. Olivier Masclet note encore que «les habitants (des quartiers) qui se sentent à la fois relégués socialement, dépossédés territorialement et menacés dans leur avenir sont disposés à compenser leur déclassement en valorisant le fait qu’ils sont français». Mais, comme le signale Abdelmalek Sayad, le fait que de nombreux immigrés et leurs enfants sont désormais français déprécie, en quelque sorte, la nationalité française. Celle-ci devient une nationalité « au rabais ». Pour défendre son statut symbolique, le souchien se trouve alors dans l’obligation de défendre la « qualité » de la nationalité française : être un « vrai Français » signifie désormais être blanc, européen et d’origine chrétienne. Le prolétaire blanc ne fait pas partie de la classe dominante, mais il fait partie de la communauté dominante. Une gratification assurément loin d’être négligeable.
La résistance populaire blanche apparaît dans ce cas comme un effet pervers de la lutte des classes. Ainsi la fameuse « mixité sociale », qui figure au centre de l’offensive raciale contre la Puissance indigène, est-elle également, écrit Sylvie Tissot, « l’arme pauvre des communes pauvres ». Elle constitue « l’un des rares outils laissés à disposition de ces villes, quand leurs voisines plus riches peuvent fermer de manière extrêmement efficace leurs territoires aux populations « indésirables », sans l’aide de dispositifs d’action publique, voire en les contournant si nécessaire ». Défendre son statut de Blanc, c’est aussi, dans ce contexte particulier, une forme de la lutte prolétarienne contre la déchéance qu’entraînent les politiques patronales et néolibérales; une forme, certes vaine, à la fois antagonique et complémentaire de la résistance blanche bourgeoise, mais néanmoins réelle. Il parait ainsi particulièrement simpliste, voire naïf, de parler d’« articulation » entre la lutte antiraciste ou décoloniale et la lutte des classes populaires sans prendre en compte que cette dernière s’articule déjà avec la lutte statutaire blanche. C’est leur double condition – dominés socialement et dominants statutairement – qui fait des classes populaires blanches à la fois une médiation et un enjeu capital pour la stratégie du Pouvoir blanc. Il ne s’agit pas simplement de « diviser » la classe ouvrière ou de détourner les travailleurs français contre le « bouc émissaire » que seraient les immigrés. Mais, plus encore, alors que progresse le démantèlement de l’État social et que le nationalisme français coïncide de moins en moins avec les intérêts des classes dominantes, il s’agit d’unifier les Blancs, par-delà leurs oppositions sociales, au sein d’un Pacte républicain recomposé autour de sa dimension raciale.
La catégorie de « quartiers sensibles », qui dit et contribue à faire la territorialisation des clivages sociaux, représente un moment privilégié de cette stratégie. Les quartiers populaires sont, en effet, la traduction dans l’espace d’un rapport de forces politique. «La ville du colon, écrivait Frantz Fanon, est une ville en dur, toute de pierre et de fer. C’est une ville illuminée, asphaltée, où les poubelles regorgent toujours de restes inconnus, jamais vus, même pas rêvés (…). La ville du colon est une ville de blancs, d’étrangers. La ville du colonisé, ou du moins la ville indigène, le village nègre, la médina, la réserve est un lieu mal famé, peuplé d’hommes mal famés. On y nait n’importe où, n’importe comment. On y meurt n’importe où, de n’importe quoi. C’est un monde sans intervalles, les hommes y sont les uns sur les autres (…). La ville du colonisé est une ville affamée, affamée de pain, de viande de chaussures, de charbon, de lumière. La ville du colonisé est une ville accroupie, une ville à genoux, une ville vautrée. C’est une ville de nègres, une ville de bicots. »
L’auteur des Damnés de la terre ne décrit pas ici une fracture territoriale mais bien la transposition de la fracture coloniale dans la configuration urbaine. De même que, à l’époque glorieuse des « banlieues rouges », les luttes menées à partir et au sein de ces territoires constituaient une extension spatiale de la lutte des classes au niveau des entreprises, un moment de la lutte des classes, de même, aujourd’hui, les luttes menées dans les quartiers ne doivent pas être comprises comme liées à des problèmes essentiellement urbains mais comme le cadre spatial d’une lutte raciale globale. Il n’en résulte pas pour autant que les « communautés imaginées» à l’échelle des cités soient simplement imaginaires. Elles sont à la fois imaginaires et réelles. Le « quartiérisme », qui en est l’une des figures politiques, n’est pas seulement le reflet d’une fausse conscience mais aussi l’expression de la connaissance d’une réalité tout à fait réelle: celle de la distribution et de la hiérarchisation des populations au sein d’espaces résidentiels différenciés. Le quartiérisme ne voit pas que ces hiérarchies recouvrent la matérialisation dans le processus urbain de conflits sociopolitiques dont la logique se construit en dehors des quartiers. Le quartiérisme apparaît comme le frère jumeau du syndicalisme le plus étroit qui confine la lutte des classes au cadre de l’entreprise.
Sadri Khiari
Extrait de son livre : La contre-révolution coloniale en France. De de Gaulle à Sarkozy, 2009, La fabrique éditions